PROMESSES
La situation de l’église à Rome
À partir d’éléments du livre des Actes et de l’Épître aux Romains, il est possible de reconstituer l’histoire de l’église à Rome.
On peut penser qu’elle a été fondée par des convertis du jour de la Pentecôte vers l’an 33 : plusieurs Juifs ou prosélytes habitant Rome y séjournaient pour la fête (Act 2.10) et ont été touchés par la prédication de Pierre.La première phase de l’église est donc sans doute judéo-chrétienne.
En 49, l’empereur Claude décide d’expulser les Juifs de Rome (Act 18.2)1. L’église à Rome devient majoritairement pagano-chrétienne. La longue liste des salutations envoyées par Paul (16.3-16) suggère que plusieurs païens convertis par Paul (directement ou non) se sont établis dans la ville.
À partir de 54, les Juifs sont autorisés à revenir à Rome et le retour de chrétiens d’arrière-plan juif a pu créer quelques tensions avec les chrétiens d’origine païenne, même si ces derniers restent majoritaires (cf.« vous, païens », 11.13,28)
C’est dans ce contexte que Paul, en 58, rédige de Corinthe cette lettre. Contrairement à plusieurs de ses Épîtres, Paul n’écrit pas pour contrer un danger imminent : l’église est globalement prospère et dynamique : leur « foi est renommée dans le monde entier » (1.8) ; ils sont « pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de [s’]exhorter les uns les autres » (15.14).
Paul, quant à lui, estime son travail autour de la mer Égée arrivé à sa fin (15.23a) et désire porter l’évangile jusqu’en Espagne (15.24,28) en s’arrêtant à Rome au passage. Il profite donc du voyage de Phoebé pour envoyer cette lettre à Rome (16.1). L’Épître aura des résultats positifs si on en juge à l’accueil chaleureux que Paul, prisonnier, recevra de la part des frères de Rome, trois années plus tard (Act 28.15). Et l’église à Rome va continuer à se développer, tout en souffrant le martyre sous Néron. Elle produira une génération d’écrivains doués, tels Clément de Rome2.
Une lettre pour nous affermir
Dans son introduction, Paul donne le but premier de sa lettre: puisqu’il ne peut pas encore rendre visite physiquement aux chrétiens de Rome, il va leur écrire pour les « affermir » (1.11). Et dans ce but, il va leur prêcher l’Évangile, dans le plein sens du mot (1.15-17 ; 15.15-16) — cet Évangile qui va bien au-delà de la seule prédication du salut « initial » et qui englobe tout le développement ultérieur de la vie chrétienne.
Affermir va aussi pour Paul avec réfuter : il semble que des opposants de l’apôtre lui aient attribué indûment des propos (3.8) ou aient tordu certaines de ses affirmations (d’où ses « Loin de là ! », 6.2,15 ; 7.7,13 ; 9.14 ; 11.1,11).
Affermir passe avant tout pour Paul par un exposé clair et ordonné de la vérité chrétienne. L’Épître aux Romains est sans doute la plus systématique de ses lettres, développant de façon logique l’état de perdition de l’homme devant Dieu (1.18-3.20), puis l’œuvre de justification de Dieu en notre faveur par l’œuvre de son Fils à la croix (3.21-5.11), ensuite l’œuvre de sanctification et de libération par l’Esprit (5.12-8.39). Il poursuit en examinant les liens entre l’œuvre de Dieu pour les Juifs et pour les nations (9.1-11.36), avant de s’attarder sur les applications pratiques de ces doctrines dans notre vie personnelle, d’église, publique ou fraternelle (12.1-15.13).
Notre foi se doit d’être intelligente. Même si le péché a obscurci les pensées de l’homme (1.20-21), la foi s’appuie sur ce que Dieu expose de façon claire et adaptée à l’intelligence qu’il nous a donnée, éclairée par le Saint Esprit.
L’Épître n’est pourtant pas un traité juridique ou un manuel de théologie. C’est un exposé « en situation », où l’on ressent la fraîcheur de la vie de l’auteur et des destinataires.
Romains aborde des thèmes bibliques fondamentaux, comme — dans le désordre — la justice de Dieu, le péché, le salut, la colère de Dieu, la sanctification, l’élection, l’œuvre du Saint Esprit, les plans de Dieu quant à Israël, etc. L’Épître aux Romains mérite donc sa place en tête des 21 lettres du canon3. Toutefois des thèmes importants ne sont pas touchés, ou à peine esquissés, dont plusieurs chers à Paul comme l’Église (il en parlera dans Éphésiens ou 1 Corinthiens), l’eschatologie (cf. 1 & 2 Thessaloniciens) ou la personne de Christ (plus développée en Colossiens).
Néanmoins, relisons fréquemment à cette riche lettre, car, même après des années de vie chrétienne, nous avons toujours besoin de revenir aux fondements et d’être mieux affermis dans la position où Dieu nous a mis, dans la liberté où l’Esprit nous introduit, dans la grandeur des plans de Dieu dans lesquels nous sommes inclus. Un commentateur encourageait à « se prêcher l’évangile chaque jour » — c’est sans doute un secret de la maturité chrétienne et du bonheur au quotidien. Redisons-nous :« Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ! » (4.7) Relire cette lettre nous aidera également à savoir présenter l’Évangile de façon claire, dans toute l’étendue de la portée de ce terme.
Une lettre pour nous aider à vivre ensemble
Le N.T. se fait l’écho de tensions dans les églises du 1ersiècle. Cohabitaient des Juifs encore attachés à la loi de Moïse et à tous leurs privilèges (3.1-2 ; 9.3-5) et des païens encore influencés par leur ancien mode de vie laxiste (cf. la description de 1.18-32).
C’est pourquoi Paul fait de fréquents parallèles entre Juifs et Grecs :
– Tous sont également coupables : « Nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché. » (3.9)
– Tous sont également sauvés : « Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (10.12-13)
Le salut n’est pas une question d’origine religieuse ou ethnique ! « Il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. » (3.30)
Ainsi les chapitres 9 à 11, loin d’être une parenthèse, participent pleinement au développement de l’Épître. Et on peut voir la section 12.1 à 13.13 comme une préparation au dernier sujet majeur que Paul a devant lui : améliorer la cohabitation entre chrétiens de convictions différentes sur des sujets pratiques (14.1-15.13).
Les tensions se traduisaient par des dissensions entre « faibles » et « forts » : certains se permettaient des choses que d’autres condamnaient. Paul enjoint qu’il n’y ait :
– ni jugement : « Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli » (14.3) ;
– ni mépris : « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas » (14.3)
Au contraire, nous sommes invités à nous accueillir « les uns les autres, comme Christ [nous] a accueillis, pour la gloire de Dieu » (15.7). Chacun a sa place dans l’Église, vue sous l’image d’un corps dont les membres sont interdépendants (12.3).
Même si les opinions divergentes aujourd’hui ne portent plus sur les viandes sacrifiées au temple ou sur les jours de la semaine, les différences d’origine géographique, ethnique, de rang social, d’habitudes, de styles familiaux, etc., peuvent facilement créer des incompréhensions, voire des dissensions, au pire des divisions dans les églises locales (cf. 16.17-19). Aussi apprenons de cette lettre à voir d’abord l’unité que crée entre nous notre commun salut et accueillons la diversité des modes de vie sur les questions secondaires.
Une lettre pour nous réveiller
Un troisième but peut être perçu dans l’exhortation vigoureuse que Paul adresse à la fin du chapitre 13 : « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » (13.11-14)
Même si les chrétiens de Rome avaient une foi plutôt vivante, ils sont invités à ne pas se relâcher dans leur vie pratique.
Paul les exhorte aussi indirectement (10.14-17) et directement (15.24) à réveiller leur zèle missionnaire. Il désire faire de l’église de Rome sa nouvelle tête de pont dans le but d’évangéliser la partie occidentale du bassin méditerranéen.
Les projets ont été partiellement compromis et le N.T. n’indique nulle part s’il a pu aller plus à l’ouest que Rome ou si le zèle missionnaire des Romains a été réveillé, mais il est certain que l’Épître aux Romains a suscité ou provoqué de nombreux réveils au cours de l’histoire de l’Église :
– Vers 386, Augustin se convertit en entendant une voix lui dire : « Prends et lis ! » Il ouvre Romains 13.13-14 et cède. Quelques années plus tard, vers 411, c’est la controverse pélagienne :Pélageaffirme que l’homme est innocent et bon à sa naissance et ne devient pécheur que par imitation. Augustin réfute fermement cette erreur et développe la doctrine du péché originel et de la nécessité de la grâce, à partir de l’Épître aux Romains.
– Au début du XVIe siècle, Luther se convertit à partir de Romains 1.16-17 qu’il était en train d’exposer. L’Épître aux Romains est au cœur de ses écrits et du début de la Réforme.
– Wesley, insatisfait de ses exercices spirituels, se convertit en 1738 en entendant lire la préface du commentaire de Luther sur l’Épître aux Romains. La doctrine du salut et surtout de la sanctification qu’il prêche ensuite est l’occasion d’un réveil extraordinaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
– Le prédicateur écossais Haldane est à l’origine du réveil de Genève (1817). C’est l’exposé systématique fait dans sa chambre d’hôtel par ce chrétien qui fut à l’origine de la conversion ou de l’affermissement des pionniers du réveil en Europe continentale (Empeytaz, Malan, Monod).
Alors que nous fêtons le 500e anniversaire de la Réforme et le 200e anniversaire de ce dernier réveil, la même Épître vient nous stimuler pour nous réveiller de notre matérialisme, de notre conformisme, de notre légalisme ou de notre laxisme. Au milieu des difficultés inhérentes à la condition intermédiaire dans laquelle nous sommes (8.18-25), elle vient nous proposer une vie dans la puissance du Saint Esprit qui peut faire abonder dans chacun de nous la justice, la paix et la joie (14.17) pour la gloire de Dieu.
Un plan détaillé de l’Épître aux ROMAINS
Introduction 1.1-17
Salutations 1.1-7
Actions de grâces et annonce de sa visite 1.8-15
Le thème de l’Épître : l’Évangile 1.16-17
Condamnation : la culpabilité de l’homme 1.18 – 3.20
La culpabilité des païens 1.18-32
La culpabilité des païens éduqués 2.1-16
La culpabilité des Juifs 2.17 – 3.8
La culpabilité de tous les hommes devant Dieu 3.9-20
Justification : l’œuvre de Dieu pour nous 3.21 – 5.11
La justice de Dieu pour tous les hommes par l’œuvre de Christ 3.21-30
Les exemples d’Abraham et de David 4.1-25
Abraham et David justifiés sans les œuvres 4.1-8
Abraham justifié sans la circoncision 4.9-12
Abraham justifié sans la loi 4.13-16
Abraham justifié par sa foi en une promesse 4.17-22
Application à ceux qui ont la même foi qu’Abraham 4.23-25
La certitude de la justification et ses effets 5.1-11
Sanctification : l’œuvre de Dieu en nous 5.12 – 8.39
Le règne de la grâce par la justice 5.12-21
La sanctification quant au péché 6.1-23
Unis avec Christ dans sa mort et sa vie 6.1-11
Libérés pour servir volontairement Dieu 6.12-23
La sanctification quant à la loi 7.1-25
L’autorité de la loi 7.1-6
Le rôle de la loi 7.7-13
L’impuissance de la loi pour la sanctification 7.14-25
La sanctification par la puissance de l’Esprit 8.1-17
Le but de la sanctification au travers des épreuves 8.18-39
Les souffrances actuelles et l’espérance 8.18-28
Le dessein de Dieu 8.29-30
L’assurance de l’amour de Dieu 8.31-39
Dispensation : l’œuvre de Dieu pour Israël et les nations 9.1 – 11.36
La souveraine élection de Dieu dans le passé 9.1-33
Les sentiments de Paul pour les Israélites 9.1-6
Le libre choix de Dieu dans l’histoire d’Israël 9.7-19
Le libre choix de Dieu dans l’élection 9.19-33
L’égalité du salut pour Juifs et païens dans le présent 10.1-21
Le salut obtenu par la foi confessée 10.1-13
L’annonce du salut 10.14-21
Le rejet temporaire d’Israël et son rétablissement dans le futur 11.1-36
Le rejet n’est pas complet 11.1-10
Le rejet n’est pas final 11.11-24
Le rétablissement futur d’Israël 11.25-32
Doxologie : louange à la sagesse de Dieu 11.33-36
Application : l’œuvre de Dieu par nous 12.1 – 15.13
Dans notre vie personnelle 12.1-2
Dans la vie de l’Église 12.3-16
Quant à l’usage des dons spirituels 12.3-8
Quant à l’amour en pratique 12.9-21
Dans la vie publique 12.17 – 13.14
Par rapport à nos ennemis 12.17-21
Par rapport aux autorités 13.1-7
Par rapport à notre prochain 13.8-10
Se réveiller dans la perspective du retour de Christ 13.11-14
Dans nos relations fraternelles avec les « faibles » 14.1 – 15.13
Le principe de liberté : ne pas juger 14.1-12
Le principe de fraternité : chercher le bien de l’autre 14.13-23
L’accueil réciproque à l’exemple de Christ 15.1-13
Conclusion et salutations 15.14 – 16.27
Le service et les projets de Paul 15.14-33
Salutations aux chrétiens de Rome 16.1-16
Épilogue et louange finale 16.17-27
Avertissement sur les diviseurs 16.17-20
Salutations des chrétiens présents avec Paul 16.21-24
Louange finale 16.25-27
- Voir pour plus de détails l’excursus de Ben Witherington III, The Acts of the Apostles, a Social-RhetoricalCommentary, p. 539-545.
- Un des principaux « pères apostoliques », probablement mort martyr en 98 et auteur d’une Épître aux Corinthiens qui était tellement appréciée qu’elle avait été intégrée un moment dans le canon du N.T. avant d’en être retirée.
- En fait, elle figure en premier lieu car c’est la plus longue. Les lettres de Paul sont en effet classées par ordre décroissant de longueur, sans logique ou signification particulière.
On date le début du mouvement dit de la réforme protestante de ce jour de 1517, il y a 500 ans, où Martin Luther placarda ses 95 thèses sur l’église de Wittenberg. Rapidement, le mouvement de la Réforme s’est développé, marqué par sa diversité. Dès le XVIe siècle, luthériens (plutôt en Allemagne) et calvinistes (plutôt en pays francophones) ont marqué leur unité sur l’essentiel et leur diversité sur le secondaire.
Dans les siècles qui ont suivi, le mouvement de la Réforme s’est assoupi et le besoin d’un renouveau — d’une nouvelle réforme — s’est fait sentir ici ou là. C’est pourquoi les siècles suivants ont été marqués par des phases successives de réveils. Chacun de ces réveils a généralement donné lieu à l’établissement d’un nouveau mouvement d’églises, qui porte la plupart du temps un nom qui rappelle le point clef sur lequel ce mouvement met l’accent[1].
Ces différentes dénominations s’inscrivent dans la filiation de la réforme protestante et souscrivent généralement aux cinq points fondamentaux sur lesquels la Réforme du XVIe siècle s’était basée, qu’on appelle les 5 « solas »[2].
Mais, dans l’esprit des pionniers de la Réforme et de tous ceux qui, après eux, ont œuvré dans le même esprit, la Réforme est avant tout un processus dynamique, à revivre constamment. C’est pourquoi, parmi les Protestants, l’Église est dite « reformata semper reformanda », c’est-à-dire : « l’Église réformée qui se réforme toujours »[3].
Que ce soit dans notre vie personnelle de chrétien qui fait partie de l’Église, ou dans la vie collective de nos églises locales, nous avons encore et toujours besoin d’être « re-formés » selon la pensée et l’action du Dieu vivant. Déclinons le sens de cette formule en relation avec chacun de ces 5 solas pour essayer de voir comment vivre cette réforme continue à laquelle nous sommes appelés[4].
1. Sola scriptura
Notre seule référence, en matière de doctrine et de pratique, est la Bible, la Parole de Dieu. C’est là que nous trouvons les principes qui doivent présider à notre vie de foi personnelle et aussi à notre fonctionnement collectif. Même si sa rédaction remonte entre 3500 et 2000 ans de distance, la Bible garde sa pleine pertinence, en 2017 comme en 1517. Nous croyons que Dieu a donné une révélation écrite intangible et finie, contenue dans les 66 livres canoniques.
Mais le danger demeure de rajouter à la Bible ou d’en supprimer ce qui nous y gêne. Jésus reprochait aux pharisiens de son temps d’avoir entouré la Parole du Dieu vivant d’une gangue de traditions qui faisait négliger « ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité » au profit de règles strictes sur des points de détail (Mat 23.23).
À titre personnel, combien vite nous surprenons-nous, quand un texte biblique nous dérange, ne rentre pas dans nos schémas intellectuels ou théologiques, semble contrevenir à nos habitudes, à le mettre de côté. Le si courant « à mon avis » remplace ainsi le « que dit l’Écriture ? ».
Collectivement aussi, il est indispensable de revisiter régulièrement nos façons de faire à la lumière des principes de l’immuable Parole de Dieu, de façon à distinguer entre la substance non négociable de nos convictions d’une part et les traditions plus ou moins nécessaires que nous y ajoutons forcément. Faire ce tri régulier permet d’avoir la liberté d’abandonner des habitudes pour revenir à l’Écriture et à son actualité dans un contexte qui change de plus en plus vite. C’est ainsi qu’on est appelé à se réformer.
2. Solus Christ
Nous nous basons sur la Bible, mais avant tout parce qu’elle nous révèle Dieu et Jésus Christ. Le terme « christianisme »est souvent associé dans le langage courant à une religion ; or c’est avant tout une relation, une relation avec une personne vivante, le Christ ressuscité. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous le savons par la foi à nos côtés tous les jours (Mat 28.20) et au centre de notre rassemblement quand nous venons en église. C’est lui, le Seigneur, qui a l’autorité sur chacun de nous et sur son Église.
Nous souhaitons que Christ grandisse et soit toujours davantage vu dans nos vies individuelles et dans notre vie collective. Si nous nous disons « chrétiens », c’est-à-dire « petits christs », cela doit se voir, dans une imitation toujours plus fidèle du Maître.
Que voient ceux qui nous entourent ? Des moralistes, prêts à enfourcher des combats pour telle ou telle valeur ? Des gens tout à fait comme les autres, hormis une pratique devenue rare de se lever le dimanche matin alors que les autres dorment ? Ou bien des hommes et des femmes qui montrent une passion pour leur Seigneur et en reflètent quelques traits.
3. Sola gratia
Nous croyons que, si nous sommes sauvés, cela n’a rien à voir avec nos mérites personnels, avec nos prétendues bonnes œuvres, mais c’est uniquement en raison de la pure grâce de Dieu, qui nous a donné de façon surabondante ce que nous ne méritions aucunement.
Cette grâce, nous sommes invités à en être, pour reprendre les termes de l’apôtre Pierre, de « bons dispensateurs » (1 Pi 4.10).
Mais combien vite peuvent monter dans notre cœur des prétentions qui nous éloignent de la grâce : parce que nous nous pensons plus fidèles que d’autres, parce que nous sommes plus dynamiques que d’autres, parce que nous croyons avoir mieux compris telle vérité, etc. Constamment, nous avons besoin d’un sentiment, plus que cela, d’une conviction, renouvelée — réformée ! — de la vraie grâce de Dieu dans laquelle nous sommes.
4. Sola fide
Dieu nous a offert son salut par pure grâce et la seule réponse qu’il demande de l’homme, c’est la foi qui saisit la grâce proposée. Cette foi est formée d’une compréhension du salut, de sentiments appropriés devant le prix payé par le Sauveur et d’un élan volontaire vers lui. Cette foi qui ouvre les portes du royaume de Dieu se continue tout au cours de la vie chrétienne, au travers des joies et des peines dont elle est empreinte. Elle est mise en œuvre dans la vie de chaque croyant mais aussi dans la vie collective de chaque église.
Et là aussi chaque église locale a besoin de se réformer continuellement : la vie d’un groupe n’est pas un long fleuve tranquille et toute église a connu, connaît et connaîtra des secousses qui conduisent à devoir mettre en œuvre cette foi. Que cette foi en l’action puissante de Dieu dans nos vies continue, pour soutenir ceux qui parmi nous traversent des épreuves, pour nous inciter à aller plus loin dans notre témoignage, pour nous stimuler à creuser davantage les trésors de la foi ouverts dans la Bible.
5. Soli Deo gloria !
Rendre gloire à Dieu est au cœur de l’adoration chrétienne. Nous sommes invités à la pratiquer individuellement tous les jours (« sans cesse », Héb 13.15) et de façon particulière ensemble lors de nos moments de partage fraternel. Par nos chants, nos prières, nos lectures et notre participation à la cène du Seigneur, nous rendons à notre Dieu la gloire qui lui revient pour son si grand salut, pour sa personne infinie.
Rendre gloire à Dieu, c’est aussi lui consacrer nos vies comme un sacrifice vivant, un « culte raisonnable » (Rom 12.1).
Mais combien vite nous pouvons être centrés sur nous-mêmes et non plus sur Dieu. Que la réforme nous atteigne également dans cette dimension :
– pour renouveler notre louange, sincère et vraie,
– pour ne pas nous attribuer des mérites indus alors que « c’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir » (Phil 2.13),
– pour faire grandir toujours plus notre amour fraternel dans le souci du bien de notre frère et de notre sœur,
– pour chercher avant tout le royaume de Dieu et non pas notre propre intérêt (Mat 6.33).
* * *
Plusieurs parmi nous gardent le souvenir de ce jour de « réveil » personnel où ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai. Si nous avons grandi dans un mouvement d’églises, peut-être nous a-t-on transmis la mémoire des temps où l’Esprit de Dieu a agi avec puissance pour susciter un réveil collectif qui a donné lieu à la création de cette dénomination. Et la nostalgie de ces moments peut nous envahir. Nous aspirons, nous demandons — presque, nous exigeons de Dieu — un réveil puissant. Il peut l’accorder ; son Esprit demeure aussi puissant aujourd’hui qu’aux débuts de l’Église.
Mais Dieu œuvre, aussi et surtout, « en continu ». « La recherche constante du réveil pourrait éloigner de ce qui est le plus important : la fidélité ici et maintenant, dans un contexte qui bien souvent n’a rien d’extraordinaire ni de spectaculaire, mais qui est notre contexte. […] Soyons donc de ceux qui savent discerner, de ceux qui cherchent à être fidèles, à vivre l’Évangile ici et maintenant dans notre contexte, dans la durée, en étant attentifs à ceux qui nous ont précédés. Ainsi, l’Église pourrait être l’ecclesia semper reformanda. »[5]
[1]Par exemple, les baptistes réservent le baptême aux seules personnes qui font profession d’une foi personnelle ; les pentecôtistes mettront l’accent sur les dons de l’Esprit qui est descendu sur l’Église primitive le jour de la Pentecôte, etc.
[2]Bien qu’ils aient été formalisés au XVIe siècle, ces cinq mêmes points figuraient déjà au XIIe siècle dans le Traité de l’Antichrist, écrit polémique rédigé par les Vaudois (cf. https://www.info-bible.org/livres/annexes.vaudois/3.traite-antichrist.htm). Le réveil puise toujours à la même source !
[3]Cette citation est malheureusement utilisée parfois pour justifier des réinterprétations qui vont à l’encontre du Texte révélé pour s’adapter à la mentalité contemporaine. Or le processus de changement, en lui-même, ne garantit ni le salut ni la fidélité pratique à l’Évangile.
[4]Pour des développements plus complets sur les cinq solas, nous renvoyons à la série d’articles rédigés par Frank Horton dans Promesses n° 137 à 141 (voir sur le site www.promesses.org).
[5]Neil Blough, « Réveil ou ecclesia semper reformanda ? », Théologie évangélique, 7-1, 2008.
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ;entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. (Éph 5.18-21)
Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. (Col 3.16)
Dès le début de l’histoire de l’Église, le chant a tenu une grande importance. 1 Corinthiens 14.26 en donne une preuve biblique : Paul suppose que chaque participant à une rencontre de l’église locale est susceptible de proposer un cantique. La célèbre lettre de l’écrivain romain Pline le jeune à l’empereur Trajan, datée de 112, en donne une preuve extra-biblique ; il écrit, à propos des chrétiens :« À jour fixe, ils s’assemblent avant le lever du soleil et chantent des hymnes antiphonés à la louange de Christ, comme s’il était dieu. »
Le N.T. comporte plusieurs sections dont tout laisse à penser qu’elles sont des hymnes (cf. 1 Tim 3.16 ; Éph 5.14 ; peut-être Phil 2.5-11, etc.). Plus encore, les écrivains sacrés encouragent les croyants à chanter. Jacques voit le chant comme la conséquence naturelle de la joie (Jac 5.13) et Paul, par les deux textes en entête, insiste sur l’importance du chant. Cherchons-y des stimulants pour renouveler notre envie de chanter.
Chanter… pourquoi ?
Parce que le croyant est rempli de l’Esprit
Paul oppose la plénitude de l’Esprit à l’ivresse. Or les deux se marquent… par le chant ! Mais les « chansons à boire » n’ont rien à voir avec les cantiques que l’Esprit nous pousse à chanter !
La plénitude de l’Esprit ne se manifeste pas par des actions spectaculaires de guérison ou par des révélations prophétiques particulières, mais, beaucoup plus simplement, par quatre conséquences marquées par quatre participes présents : s’exhortant mutuellement, louant Dieu, étant reconnaissant, étant soumis aux autres. Voulez-vous savoir qui est rempli de l’Esprit ? Cherchez un croyant chantant, reconnaissant et soumis !
Réciproquement, chanter nous aidera à être remplis de l’Esprit. Il est souvent noté que le verbe « remplir » est à l’impératif passif continu pluriel :« laissez-vous toujours remplir du Saint-Esprit », pourrait-on traduire littéralement. Chanter régulièrement est donc un moyen privilégié pour mettre en œuvre cette exhortation. En élevant notre âme, le chant va permettre à l’Esprit de Dieu de remplir notre propre esprit de pensées de louange, de reconnaissance, d’engagement envers le Seigneur.
Parce que la parole du Christ habite dans le croyant
La « parole du Christ » est à la fois la parole prononcée par le Christ (essentiellement dans les Évangiles) et la parole à propos du Christ (dont toute la Bible témoigne). Celui en qui elle « demeure » — c’est-à-dire celui qui s’en nourrit, dont elle forme les pensées, dont elle modèle le comportement — sera naturellement poussé à la louange : sa vision de la personne et de l’œuvre de Jésus Christ le conduira à exprimer sa reconnaissance et à la partager par des chants. Lecture et louange vont de pair.
On comprend donc l’importance d’avoir des cantiques qui soient bibliquement fondés, cohérents avec l’enseignement de l’Écriture. N’allons cependant pas trop loin : un chant n’est pas un traité de doctrine et sa brièveté ne lui permet pas d’envisager tous les aspects d’un sujet donné. De plus, la poésie peut conduire à des simplifications ou des illustrations tout à fait recevables. Évitons donc les chants qui contredisent directement une doctrine biblique et encourageons-nous à un état d’esprit positif.
Réciproquement, le chant nous aidera à nous approprier la Parole. Des textes bibliques mis en musique peuvent nous les faire (re-)découvrir ou en approfondir le sens. Des thèmes de cantiques nous conduiront à vouloir creuser le sujet dans l’Écriture.4 Et, comme pour la plénitude de l’Esprit, un cercle vertueux se développe : chanter démontre que l’Esprit agit en nous et que nous demeurons dans la Parole et par ces chants, l’Esprit nous remplit et la Parole nous habite toujours plus.
Chanter… pour qui ?
Pour Dieu
Beaucoup de chants s’adressent directement à Dieu, soit comme louange pour ce qu’il est, soit comme action de grâce pour ce qu’il a fait, soit comme prière pour ce que nous lui demandons. Nous chantons avant tout « à Dieu », « au Seigneur ». Des mélodies trop souvent fredonnées peuvent nous faire oublier que nous prononçons des paroles profondes. Pensons que nous nous adressons au Créateur de l’univers, au Dieu tout-puissant !
Pour les autres
Toutefois le contexte des deux versets en entête met l’accent sur la dimension horizontale du chant : il est un moyen de « s’exhorter » et de « s’entretenir ». C’est bien sûr le privilège de celui (ou de celle)5 qui compose le chant. Mais pas seulement : proposer un cantique dont les paroles correspondent aux circonstances du moment peut apporter un grand encouragement ou donner une instruction indirecte qui sera d’autant mieux reçue qu’elle viendra des paroles composées par un tiers.
Les Psaumes illustrent ces divers aspects : beaucoup s’adressent directement à Dieu ; d’autres sont des invitations mutuelles (cf. Ps 95) ; d’autres, encore, sont des instructions de sagesse (cf. Ps 34.12-23). Nos recueils de chants doivent refléter cette variété !
Chanter… où ?
En église
Le rassemblement communautaire est le lieu privilégié pour le chant collectif. Outre les témoignages évoqués en introduction, les multiples mentions des chants dans l’Apocalypse indiquent que chanter en église anticipe la louange éternelle des rachetés.
En famille
Toutefois, ici encore, le contexte de ces deux versets n’est pas directement la réunion d’église mais la vie chrétienne au sens large, et en particulier la vie de famille. Encourageons-nous donc à chanter le plus souvent possible en famille, avec ou sans instrument, lors du culte familial quotidien, lors de trajets en voiture, pendant des promenades, etc. Les chants que nos enfants auront appris les accompagneront pendant toute leur vie.
Entre amis chrétiens
Lors de rencontre entre amis chrétiens, une pudeur inappropriée nous empêche parfois d’aborder des sujets spirituels. Proposer de chanter peut constituer une introduction facile à un moment de partage. Saisissons ces occasions !
En tout temps
« Je bénirai l’Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », disait David (Ps 34.2). Chantons en faisant le ménage, en travaillant (si cela ne nuit pas à son exécution !), en nous promenant… Je connais une famille qui a été convertie par le témoignage de voisins de vacances qui chantaient toute la journée !
De plus, nous disposons aujourd’hui de moyens techniques qui nous permettent d’écouter des chants à tout moment. Combien de mp3 de cantiques avez-vous sur votre smartphone ?
Chanter… comment ?
Avec variété
Nos deux textes mentionnent « des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». La distinction précise de ces trois types de chants n’est pas très facile à tracer aujourd’hui. À tout le moins, elle témoigne de la variété des styles de chants en usage du temps de Paul, variété que nos recueils de cantiques doivent aussi avoir : gardons-nous de sacraliser une catégorie particulière et laissons-nous édifier par des cantiques d’origine et de style les plus divers possibles.
La mention des Psaumes mérite une attention particulière : loin de reléguer ceux-ci dans le passé de l’ancienne alliance, Paul les cite en premier lieu : ils ont donc un rôle capital dans l’édification chrétienne, en complément avec d’autres aspects du christianisme développés dans le N.T.6. Ils sont « parole du Christ » par les échos que nous y trouvons des sentiments de Christ ; ils le sont aussi par les multiples mentions de sa royauté actuelle et de l’attente de son triomphe futur. Ils nous aident à vivre la plénitude de l’Esprit en canalisant l’expression de nos sentiments qui y sont exprimés à Dieu dans toute leur diversité. Les Psaumes étaient souvent accompagnés par des instruments (relisons le Ps 150) et ils peuvent nous paraître parfois répétitifs dans leurs expressions (pensons au Ps 136) — deux remarques qui peuvent aider à modérer les critiques sur les instruments dans l’église ou sur les chants où la répétition d’un refrain lasse.
Avec sagesse et intelligence
La sagesse doit présider au choix d’un chant. Elle nous montrera quand et quoi chanter (cf. Prov 25.20). « Je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence », confirme Paul ailleurs (1 Cor 14.15).
Avec soumission
La quatrième marque de la plénitude de l’Esprit, rappelons-le, est la soumission mutuelle. Le chant collectif est une excellente occasion de la pratiquer : au lieu de critiquer les options du chef de chœur ou du responsable de la louange, respectons ses choix et encourageons-le dans son service !
Avec cœur
La qualité primordiale d’un chant ne viendra jamais de la perfection de son exécution, mais de la sincérité de cœur que le Seigneur y lit. Le sentiment de la grâce de Dieu est l’atmosphère nécessaire d’un chant vraiment spirituel. Un cœur touché par l’amour divin sera naturellement plein de grâce envers ceux qui chantent avec lui, quelles que soient leurs faiblesses musicales.
* * *
Les théologiens listent souvent les trois « moyens de grâce » : la lecture de la Bible, la prière et la communion avec les autres chrétiens. Le chant me semble être au confluent de ces moyens de grâce : la spiritualité du chant se nourrit de la Bible, s’élève souvent sous forme de prière et son exécution collective, en famille, entre amis ou en église, me met en communion avec mes frères et sœurs.
De plus, il met en œuvre mon être entier : les paroles stimulent mon esprit, la musique touche mon âme et l’exécution du chant utilise mon corps. C’est donc toute mon humanité qui est impliquée.
Par le chant, j’anticipe donc une des activités essentielles du ciel, quand, dans un corps glorifié, dans la perfection de mon humanité, j’exalterai avec la multitude des rachetés les gloires de l’Agneau immolé.
- Pour ma part, un cantique (« Dieu est là ») m’a conduit à méditer sur l’immanence de Dieu et un chant basé sur le dernier verset du Ps 52 m’a fait découvrir la richesse de ce texte.
- De très nombreux cantiques ont été composés par des chrétiennes. C’est un beau moyen pour elles de mettre en œuvre leurs dons, en particulier de « prophétie », par lequel elles peuvent « édifier », « exhorter » et « consoler » (cf. 1 Cor 14.3).
- Peut-être est-ce pour cette raison que plusieurs éditions du N.T. y adjoignent les Psaumes.
Être chrétien et douter ? Ces deux verbes apparaissent a priori contradictoires. Pourtant, se déclarer chrétien tout en éprouvant des doutes fut l’expérience de plusieurs (de beaucoup ?). En témoignent par exemple des paroles de cantiques :
« Tel que je suis, bien vacillant,
En proie au doute à chaque instant,
Lutte au dehors, crainte au dedans… » (Charlotte Eliott)
ou :
« Et si parfois dans mon cœur vient le doute… » (auteur inconnu)
De tels accents permettent déjà de prendre conscience que, si je doute, je ne suis pas le seul !
Pourquoi est-ce que je doute ?
Les raisons peuvent être multiples, d’origine et d’importance variées. En voici quelques-unes :
– Parce que la foi est un sujet important : Si je base ma vie présente et mon avenir après la mort sur une croyance, il est naturel que j’attache une importance particulière à ce sujet et que je me pose sérieusement des questions sur son fondement.
– Parce que j’ai un tempérament « à douter » : Nous ne sommes pas égaux dans notre fonctionnement psychologique. Certains reçoivent simplement ce qu’on leur dit ; d’autres, plus méfiants, remettent vite en cause la véracité de ce qu’ils lisent ou entendent.
– Parce que je n’ai pas de solides principes bibliques : Je douterai d’autant plus facilement que je connais peu la Bible ou que j’ai cultivé une vision déformée de Dieu, peut-être liée à mon histoire personnelle ou à la culture dans laquelle je baigne.
– Parce que cela me permet d’éviter d’obéir à Dieu : Le « je ne sais pas » déguise en fait un « je ne veux pas ». On pense au célèbre aphorisme de Mark Twain : « Ce ne sont pas les parties de la Bible que je ne comprends pas qui me gênent, ce sont les parties que je comprends. » Douter, c’est alors esquiver l’exigence divine.
– Parce que cela « fait bien » de douter : Notre génération récuse les absolus et absolutise le relativisme. Gare à celui qui prétend avoir trouvé « la » vérité ! « Réinterroger les textes », « revisiter les doctrines », « découvrir une nouvelle perspective », … — les euphémismes abondent pour désigner au fond une posture systématique de remise en cause permanente et de soupçon envers ce qui nous est présenté comme la vérité.
Le doute fondamental : faire douter de la Parole de Dieu
Dans un Éden où tout était paix, le mal surgit brusquement, rompant l’harmonie initiale. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Gen 3.1) Une traduction plus littérale pourrait donner : « Ben alors ! Dieu a dit ça ? » — avec une nuance d’ironie et de moquerie7.
Le doute qu’instille le tentateur s’attaque d’abord à ce que Dieu a « dit », à sa Parole. Il sait que, s’il arrive à remettre en cause ce fondement, la partie est bien entamée pour lui : il n’aura qu’à « tirer sur la pelote » pour petit à petit éloigner le croyant désormais suspicieux du Dieu dont il vient de lire les paroles.
Le doute est le contraire de la foi, qui « vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Rom 10.17). Si je doute de la Parole de Dieu, je n’ai plus de base objective à ma foi, qui devient alors une croyance subjective et mouvante ; je perds tout fondement solide et je deviens « semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre » (Jac 1.6).
Ce doute initial, au jardin, se marque par plusieurs détails significatifs :
– Tout d’abord, il est une distorsion de la parole véritable de Dieu, par exemple en extrayant un verset de son contexte. Une contrevérité patente est bien plus facile à discerner qu’une remise en cause « en biais », partielle, mais néanmoins réelle de ce que Dieu a dit. Aussi revenons avec humilité au texte tel que Dieu nous l’a transmis et non pas tel que d’autres l’ont compris.
– Il ironise sur ce que Dieu dit. Des incrédules qui raillent les soi-disant incohérences de l’Écriture peuvent instiller en moi un doute d’autant plus difficile à contrer que j’aurais peur de me ridiculiser si j’essaie de prendre sa défense.
– Il met l’accent sur le négatif. Implicitement, Dieu est celui qui « empêche », qui « frustre ». Alors que le Créateur avait tout fait « bon », le diable instille l’idée qu’il a privé le premier couple d’un bienfait — qu’au fond, ce Dieu n’est pas bon. Douter, c’est souvent imaginer autre chose sur Dieu que ce qu’il nous révèle de lui-même. Alors, laissons de côté nos idées préconçues et cherchons à voir Dieu « tel qu’il est, vraiment ».
– Dans une seconde étape, le tentateur s’oppose frontalement à la Parole divine : « Vous ne mourrez point. » (Gen 3.4) Au fil des siècles, cette opposition a pris des formes variées. Mais chaque fois, c’est l’orgueil de l’homme (la « faute du diable » !) qui place sa pensée au-dessus de la révélation de Dieu. On juge ce que Dieu dit et on estime si c’est vrai ou non, au lieu de le recevoir avec humilité et reconnaissance. Reconnaissons notre orgueil et « soumettons-nous à Dieu » : c’est ainsi que nous résisterons au diable (Jac 4.7).
Comment en sortir ?
Sur un plan plus pratique, que faire pour retrouver une pleine confiance dans la Parole de Dieu ? Voici quelques pistes :
– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que Dieu a donné des preuves externes nombreuses, pertinentes et vérifiables de sa véracité. Quelques exemples : l’abondance des prophéties déjà réalisées, le miracle de sa transmission au cours des siècles, la concordance toujours croissante entre les découvertes archéologiques et l’histoire biblique, etc.
– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que Dieu a donné des preuves internes de sa véracité. La cohérence de son message au travers des 15 siècles de sa rédaction et de la multiplicité de ses auteurs humains frappe de façon croissante le lecteur non prévenu. L’honnêteté de son propos qui « parle vrai », loin de mythes enjolivés, contraste avec tout autre livre fondateur de religion.
– Je peux avoir confiance dans la Bible parce que, par elle, je vois Dieu transformer des hommes et des femmes. Que ce soit au travers de biographies historiques, de témoignages actuels ou de constatations personnelles chez des proches, la Parole de Dieu a montré et continue à montrer sa puissance. À moi de me laisser aussi transformer par elle.
Je décide alors de faire face à mon doute : au lieu de chercher à le camoufler, il vaut bien mieux se l’avouer à soi-même et en parler à d’autres. Ma foi chancelante pourra se fortifier au contact de plus solides que moi. Je dois aussi éviter de me complaire dans mon doute et d’y trouver un plaisir malsain : la foi est aussi « vertu » et décision. Comme ce père de l’Évangile, je crierai : « Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité ! » (Marc 9.24)
Et pour éviter de retomber dans le doute, je vais affermir ma foi :
– en la détachant de mes sentiments subjectifs, si fluctuants au gré des circonstances et de mes humeurs,
– en évitant certains contacts nocifs (personnes, écrits, etc.) qui m’éloignent de Dieu et de sa Parole,
– en m’abreuvant d’une lecture régulière et sans a priori de l’Écriture pour que ma foi soit toujours plus fondée sur l’objectivité du texte,
– en cherchant la face du Seigneur par la prière et la louange : les deux chants cités en introduction ne se terminent-ils pas par ces invitations : « Agneau de Dieu, je viens » et « Si tu lèves vers Jésus les yeux » ?
Le livre de Jérémie est un des plus longs livres de la Bible : en nombre de mots, il égale presque les 150 Psaumes. Il est nettement plus long que les deux autres « grands prophètes », Ésaïe et Ézéchiel. Il est 60 fois plus long que le plus court livre de l’A.T., le prophète Abdias. On comprend pourquoi il est ardu de lire Jérémie en entier.
De plus, Jérémie n’a pas la même poésie et la même richesse messianique d’Ésaïe, ni l’ampleur visionnaire et la rigueur chronologique d’Ézéchiel, et ses oracles nous semblent bien répétitifs. Mais c’est à dessein que Dieu nous a donné cette prophétie sous une forme aussi longue, car son message, pas toujours très agréable à entendre, a besoin d’être répété pour que nous y soyons attentifs. Raison de plus pour essayer d’y voir plus clair sur sa structure.
Trois difficultés préalables
Certains auteurs contemporains renoncent à trouver toute cohérence à la structure du livre. Ils attribuent cette difficulté à trois raisons.
Un texte à l’histoire compliquée
Avant d’être disponible sous sa forme actuelle, le livre du prophète Jérémie a connu plusieurs avatars, avec des éditions intermédiaires :
– Un premier recueil fut rédigé par Baruc sous la dictée de Jérémie : « Prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t’ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t’ai parlé, au temps de Josias, jusqu’à ce jour. » (36.2). Mais la suite du chapitre 36 relate comment ce premier ouvrage, après avoir été lu à plusieurs hauts dignitaires du royaume, fut brûlé par le roi impie Jojakim.
– Un deuxième recueil, encore plus fourni, fut alors réécrit par Baruc : « Jérémie prit un autre livre, et le donna à Baruc, fils de Nérija, le secrétaire. Baruc y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu’avait brûlé au feu Jojakim, roi de Juda. Beaucoup d’autres paroles semblables y furent encore ajoutées. » (36.32)
– Des compléments ultérieurs furent ensuite ajoutés : Les événements du chapitre 36 se situaient vers l’an 604-602. Or Jérémie continua de prophétiser et le livre rapporte nombre d’événements postérieurs : les prophéties et les événements sous Sédécias, la chute de Jérusalem, la descente du reste du peuple en Égypte, etc.
Mais réécrire un texte contribue souvent à améliorer sa qualité. Jérémie eut l’occasion de prêcher ses oracles, puis de les écrire plusieurs fois avant la version finale. La qualité et la cohérence ont augmenté avec le temps — preuve en est la structure finale harmonieuse.
Une traduction en grec avec des différences significatives
Au IIIe siècle avant J.-C., l’A.T. a été traduit en grec. Cette version, dite des Septante, est généralement assez proche du texte massorétique sur lequel sont basées la plupart des versions modernes. Jérémie est un des livres qui fait exception : la traduction des Septante est plus courte d’un huitième environ, avec la suppression de nombreux doublets[1] et dispose les chapitres dans un ordre différent. Ces écarts n’altèrent pas le contenu théologique du livre qui reste le même en hébreu et en grec.
Nonobstant les perplexités qui ont été engendrées par ces différences, il nous semble plus pertinent de continuer à suivre l’ordre du texte hébraïque pour analyser le plan du livre[2].
Un livre qui ne suit pas l’ordre chronologique
Une autre difficulté inhérente à l’analyse du livre vient de la chronologie. Jérémie a prophétisé entre 627 avant J.-C. et 580 environ ; le dernier paragraphe du chapitre 52 évoque la réhabilitation de Jojakin qui eut lieu en 561. Mais l’ordre des chapitres ne suit pas le déroulement historique.
Par exemple, dans la suite des chapitres 34 à 37, le chapitre 34 se situe au début du siège de Jérusalem (vers –588), le chapitre 35 vers –600, le chapitre 36 ramène vers –604 et le chapitre 37 revient vers –588. Le seul chapitre 22 évoque des situations éloignées de plus de 10 ans.
Cette irrégularité nous déroute un peu. D’autres prophètes ont une organisation plus linéaire et notre esprit cartésien privilégie une organisation plus immédiatement rationnelle. Mais l’Esprit de Dieu a conduit l’éditeur du livre à adopter cette disposition plus thématique pour faire ressortir des significations morales importantes.
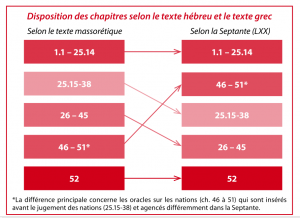
Une proposition de plan
Même si les articulations sont plus difficiles à cerner que pour d’autres livres bibliques et si la longueur du texte rajoute un obstacle, il nous semble qu’il est néanmoins possible d’établir un plan à partir des indications mêmes du texte biblique — un plan qui contribue à notre compréhension du message clef du livre.
De 3 à 7 grandes parties
La nature littéraire du texte fait ressortir trois grands blocs :
– Les chapitres 2 à 25 comportent une forte proportion de textes en poésie[3], ils n’indiquent pas de dates précises et ont pour thème des jugements généraux sur le royaume de Juda.
– Les chapitres 46 à 51 sont eux aussi majoritairement en poésie, sans date indiquée et ont pour thème des jugements généraux sur les nations.
– Entre ces deux blocs, la partie centrale des chapitres 26 à 45 est majoritairement en prose, avec de nombreuses dates précises ; elle retrace l’histoire personnelle du prophète et des derniers jours de Jérusalem.
En détaillant un peu plus la partie centrale, la plus hétérogène des trois, il est possible de distinguer 7 parties au total :
– les chapitres 26 à 29 présentent les conflits de Jérémie,
– les chapitres 34 à 45 racontent toute la suite des épreuves de Jérémie,
– au centre, les chapitres 30 à 33 ont un ton particulier, beaucoup plus positif que le reste du livre — d’où le nom qui leur a été donné de « livre de la consolation » ou « livre de l’espérance ».
L’introduction (ch. 1, avec l’appel de Jérémie) et la conclusion du livre (ch. 52, avec la fin de Jérusalem) forment deux appendices historiques.
La structure du livre en « chiasme »[4] mise ainsi en évidence fait ressortir la place centrale des chapitres 30 à 33 : le centre du propos de Dieu dans ce livre de Jérémie est de donner une espérance à son peuple, par l’annonce d’une nouvelle alliance. Si la tonalité générale du livre est plutôt sombre, sa construction littéraire aboutit à un point central ô combien positif.
Vue d’ensemble de la structure du livre
1-L’appel de Jérémie
2-25 Les oracles contre Judas (10)
26-29 Les conflits de Jérémie (4)
30-33 Les livres de consolations et d’epérance (3)
34-45 Les épreuves de Jérémie (10)
46-51 Les oracles de Jérémie (10)
52 La fin e Jérusalem et le relèvement de Jojakin
Quelques indications pour un plan plus détaillé
Au-delà de cette « macro-structure » du livre, il est possible de mettre en évidence trois cycles de dix parties chacun.
Dans la première longue portion (ch. 2 à 25), dix parties sont marquées par des expressions similaires à celle du début du ch. 2 : « La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots. » (2.1) De plus, ces dix oracles se répartissent de façon symétrique en trois groupes :
– les trois premiers se concentrent sur un panorama général du jugement du peuple (2.1-10.25) ;
– les quatre oracles centraux (11.1-20.18) entremêlent jugements et propos de Jérémie sur lui-même : au cœur de ces 24 chapitres se trouvent les passages appelés les « confessions de Jérémie », ces cris du cœur du prophète, affligé par l’endurcissement de son peuple ;
– les trois derniers (21.1-25.38) reprennent des thèmes généraux et moins personnels.
Les chapitres 26 à 29 décrivent les conflits de Jérémie avec le peuple, les faux prophètes, un faux prophète particulier (Hanania) et un autre faux prophète (Schemaeja) qui avait écrit une lettre aux exilés que Jérémie est obligé de contrer. Les quatre parties commencent par des indications chronologiques.
Le cœur du livre (ch. 30-33) comporte deux annonces prophétiques encourageantes : une nouvelle alliance (30-31) et un nouveau David (33). Entre les deux s’intercale une illustration à travers le rachat du champ d’Hanameel (32).
La deuxième longue portion (ch. 34 à 45) peut elle aussi se diviser en dix parties (même si ce découpage est un peu moins net que celui des ch. 2 à 25). On y retrouve l’expression : « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots… ». Là encore, ces dix parties se répartissent en trois groupes (3 + 4 + 3) :
– les trois premières parties sont des annonces de la captivité (34), rançon de l’infidélité du peuple qui contraste avec la fidélité des Récabites (35) ;
– les quatre suivantes sont directement historiques, avec les confrontations du prophète avec Jojakim (36) puis Sédécias (37-39), en contraste avec l’espoir donné à Ebed-Melec, suivi des conséquences de la destruction de Jérusalem jusqu’à l’arrivée de Jérémie avec le reste du peuple en Égypte (43.7) ;
– les trois dernières sont deux dénonciations de l’idolâtrie du peuple en Égypte (44), suivies du message d’espoir à Baruc (45), bien antérieur historiquement, mais qui trouve son accomplissement en Égypte puisque le secrétaire de Jérémie y a la vie sauve.
Enfin, la troisième longue portion (ch. 46 à 51) est elle aussi divisée très nettement en dix : neuf nations sont mentionnées, mais Babylone reçoit un oracle supplémentaire (51.59-64) confié à Seraja, le frère de Baruc.
La dernière partie du livre (le ch. 52) peut sembler une répétition inutile. Mais ce chapitre joue un rôle essentiel. Ce que dit un vrai prophète s’accomplit. Jérémie avait moult fois annoncé le siège et la chute de Jérusalem — et ils eurent lieu ! De plus ce chapitre ne mentionne pas le nom de Jérémie : l’Esprit de Dieu ne juge pas utile d’insister en ajoutant : « comme cela avait été annoncé par Jérémie le prophète ». À nous d’apprécier la cohérence extraordinaire entre l’annonce divine et sa réalisation. Mais de façon très touchante, le livre ne se termine pas là : quatre petits versets évoquent la réhabilitation de Jojakin (52.31-34). Jérémie avait certes annoncé arrachements et ruines (1.10), mais aussi édification et plantation. Le relèvement de Jojakin préfigure la parole de grâce sous Cyrus qui ramènera le peuple dans son pays ; il annonce la poursuite de la lignée messianique et il ouvre la voie vers celui qui allait être en lui-même le porteur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ (Mat 1.11-16).
De l’intérêt d’un plan
S’intéresser au plan d’un livre biblique, surtout aussi long que Jérémie, a donc au moins un double intérêt :
– Avoir un plan en tête permet, lorsqu’on lit un verset de Jérémie, de comprendre à quelle place il s’inscrit dans le développement théologique du livre, pour mieux saisir sa signification.
– Surtout, Dieu a mis une intention spirituelle dans la façon dont sont agencées les paroles qu’il a communiquées. Jérémie en est une magnifique illustration : loin d’être un accolage disparate de prophéties, ce livre est construit pour mettre en évidence son message central : si le peuple a failli à garder l’alliance mosaïque, à laquelle la déportation va mettre un premier terme, Dieu va lui-même introduire une nouvelle alliance (31.31-34), tellement meilleure (cf. Héb 8.6), à laquelle il nous fait participer !
[1] Phrases, versets ou groupes de versets qui se retrouvent à l’identique (ou presque) à plusieurs reprises dans le livre.
[2] D’une manière générale, les traducteurs de la Septante se sont efforcés de gommer les prétendues « difficultés » du texte massorétique, mais en touchant au texte sacré, ils n’ont fait que multiplier les difficultés, notamment en détruisant des structures en chiasme manifestes dans le texte hébreu.
[3] La poésie hébraïque est de nature différente de la poésie française. Elle n’est malheureusement pas mise en évidence par certaines versions qui présentent le texte en continu, alors que d’autres font mieux ressortir les vers.
[4] Le chiasme est un procédé littéraire très fréquent dans les textes bibliques qui fait répondre des parties d’un texte en « miroir ». Par exemple, dans une structure A1-B1-C-B2-A2, les parties A1 et A2, puis B1 et B2 ont des caractéristiques communes, la partie centrale C étant généralement la plus importante.
Plan du livre du prophète Jérémie
A1. Introduction : L’appel de Jérémie 1
B1. Les oracles contre Juda 2-25
- La complainte sur Israël, épouse infidèle de Dieu 2.1-3.5
- Les appels à revenir, sous peine d’une invasion 3.6-6.30
- Le sermon au temple sur l’hypocrisie cultuelle 7.1-10.25
- La rupture de l’alliance et ses conséquences 11.1-13.27
- La sécheresse sans remède 14.1-15.21
- Le péché et ses conséquences 16.1-17.27
- La visite à la maison du potier 18.1-20.18
- Le jugement des rois infidèles et des faux prophètes 21.1-23.40
- Les deux paniers de figues 24.1-10
- L’hégémonie de Babylone, puis sa chute après la captivité de Juda 25.1-38
C1. Les conflits de Jérémie 26-29
- Le conflit avec le peuple 26.1-24
- Le conflit avec les faux prophètes 27.1-22
- Le conflit avec Hanania 28.1-17
- La lettre aux exilés et le conflit avec Schemaja 29.1-32
- Le livre de la consolation et de l’espérance 30-33
- Le rétablissement du peuple et la nouvelle alliance 30.1-31.40
- Le rachat du champ d’Hanameel et le rétablissement des captifs 32.1-44
- Le rétablissement du peuple et le nouveau David 33.1-26
C2. Les épreuves de Jérémie 34-45
- L’annonce de la captivité de Sédécias 34.1-7
- L’annonce de la captivité du peuple infidèle à son alliance 34.8-22
- Le signe de la fidélité des Récabites 35.1-19
- La destruction du 1er rouleau de Jérémie et la protection du prophète 36.1-32
- L’emprisonnement du prophète et la destruction de Jérusalem 37.1-39.14
- Le message à Ebed-Melec 39.15-18
- Le complot contre Guedalia et la descente en Égypte 40.1-43.7
- Le signe des grosses pierres 43.8-13
- La dénonciation de l’idolâtrie en Égypte 44.1-30
- Le message à Baruc 45.1-5
B2. Les oracles contre les nations 46-51
- L’oracle contre l’Égypte 46.1-28
- L’oracle contre la Philistie 47.1-7
- L’oracle contre Moab 48.1-47
- L’oracle contre Ammon 49.1-6
- L’oracle contre Édom 49.7-22
- L’oracle contre Damas 49.23-27
- L’oracle contre Kedar et Hatsor 49.28-33
- L’oracle contre Élam 49.34-39
- L’oracle contre Babylone 50.1-51.58
- L’oracle contre Babylone confié à Seraja 51.59-64
A2. Conclusion : La fin de Jérusalem et le relèvement de Jojakin 52
La simple consultation d’une concordance, papier ou électronique, suffira pour montrer que c’est dans l’Épître aux Romains que le mot « espérance » (ou ses dérivés) se trouve le plus grand nombre de fois, parmi tous les écrits du N.T8.
Pourtant, cette Épître commence par un total désespoir (1.18-3.20) : l’humanité déchue y est décrite comme elle est aux yeux de Dieu : s’enfonçant toujours plus dans le péché, incapable de faire le bien. Qui plus est, la juste colère de Dieu envers l’homme révolté contre lui est révélée d’entrée (1.18). Aucune espérance ne semble ouverte devant l’homme. Seul l’attend un juste jugement : le jour de la colère est à la porte (2.5). Quelle espérance pourrait-il avoir ?
Cette condition humaine dramatique a été entrevue par plusieurs auteurs ou artistes profanes, de Nietzsche à Sartre : face à la condition humaine, face à la certitude de la mort, face à un Dieu dont on prétend qu’il n’existe pas, il ne reste que le désespoir. Sans espérance, à quoi bon vivre ? Pour quoi vivre ? Quel sens donner à la vie ? Mais notre Épître va ouvrir une porte…
L’espérance de la gloire de Dieu (5.1-11)
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. (5.1-2)
Dans ces deux versets, l’apôtre résume l’enseignement qui précède (3.21-4.25). Par pure grâce, Dieu offre à l’homme une porte de sortie au désespoir de sa condition :
– Quant à son passé, il est justifié par la foi en Jésus Christ : Dieu ne lui met plus son péché sur son compte, mais il le crédite de sa propre justice en Christ.
– Quant au présent, il est dans la grâce de Dieu, dans sa faveur.
– Quant au futur, il a désormais une espérance. Sa situation actuelle n’est pas définitive : si la justification qui est la sienne est déjà totale, si la faveur divine ne lui sera jamais retirée, il n’en jouit pas encore à 100 % aujourd’hui. Dieu crée en lui une envie « de quelque chose de plus », d’une plénitude.
C’est cela, l’espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, a-t-on dit, ce sont les attributs de Dieu manifestés, l’éclat de ses perfections. Notre condition actuelle ne nous permet pas de la saisir dans toute son étendue. Mais un jour le Dieu qui nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire (1 Thes 2.12) nous illuminera de tout son être glorieux et nous serons définitivement comblés. Combien nous languissons après ce temps éternel du définitif et du complet !
Pour autant, Paul reste réaliste. En attendant cette gloire, nous connaissons tous plus ou moins des épreuves (5.3) et nous pouvons même nous en « glorifier » ! Non pas que Paul fasse l’éloge du masochisme, loin s’en faut, mais nous savons que les afflictions ont un but, à terme (Jac 1.2-3). Et deux aides nous sont proposées pour persévérer dans ces épreuves :
– la première est subjective : c’est l’amour de Dieu ressenti dans le présent dans le secret de notre cœur par le Saint Esprit (5.5), qui nous dit : « Dieu t’aime toujours autant, malgré les difficultés que tu traverses » ;
– la seconde est objective : le rappel du sacrifice de Christ dans le passé pour des hommes indignes, nous assure que cet amour n’est pas une illusion, mais a été démontré de la manière la plus claire possible (5.6-8).
Paul peut alors conclure par un raisonnement a fortiori (5.9-10) : si Dieu nous a déjà justifiés, il n’y a désormais plus aucune raison de craindre sa colère. En effet, les épreuves que nous traversons n’ont rien à voir avec cette colère ; elles nous conduisent au contraire à une relation plus directe et plus vivante avec Dieu (5.11).
L’espérance de la vie éternelle (6.22-23)
Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. (6.22-23)
Tout homme se voit proposer deux chemins. Le premier conduit vers la mort — la mort éternelle. Fondamentalement, un croyant l’a quitté en acceptant Christ comme Sauveur, mais il doit au quotidien actualiser ce choix en refusant de se livrer au péché. Le second chemin conduit vers la vie — la vie éternelle. Cette vie en est le but ultime et il espère avec certitude l’atteindre.
Mais dès aujourd’hui, le chrétien, justifié devant Dieu se livre volontairement comme esclave à Dieu pour le servir en sainteté. Chaque petite décision concrète de sa vie pour obéir librement à Dieu renforce cette espérance qu’un jour, cette vie qui est déjà en lui comme cadeau divin aura son plein développement, dans le service céleste éternel.
L’espérance de la gloire des enfants de Dieu (8.18-30)
J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité — non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise — avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. (8.18-25)
Dans ce développement, Paul fait un parallèle frappant entre la situation de la création et la situation des croyants, en employant les même termes : elle soupire (8.22) et nous aussi (8.23) ; elle attend (8.19), nous aussi (8.23a) ; elle sera libérée (8.21) et nous le serons aussi (8.23). Ce parallèle montre l’interaction qui existe entre la création et l’humanité : la chute de l’homme a eu des conséquences sur le monde physique que nous habitons (Gen 3.18) et elle continue à en avoir. Le Lévitique avertissait qu’une inconduite morale persistante pouvait conduire un pays à « vomir » ses habitants (Lév 18.28). Ainsi, l’état moral de nos contemporains pèse sur notre pays, qui attend sa libération.
Les soupirs et les souffrances de la création sont certainement mieux compris aujourd’hui, avec l’émergence des préoccupations écologiques. Comme chrétiens, nous ne pouvons qu’approuver ce désir de préserver notre environnement et y participer dans notre mesure. Mais nous savons par avance que ces efforts louables resteront toujours insuffisants9. Notre espérance n’est pas dans les bienfaits d’un Grenelle I ou II10, mais dans la « liberté de la gloire des enfants de Dieu », dans le jour où simultanément le péché sera éradiqué et la création libérée.
Sur le plan personnel, nous attendons « la rédemption de notre corps ». Le salut de notre âme est déjà acquis ; celui de notre corps, lui, est encore futur. Nous le constatons bien sous deux aspects : d’une part, notre corps est « faible », allant vers la décadence, susceptible de souffrir, d’être malade ; d’autre part, notre corps est aussi, hélas, l’instrument par lequel nous péchons (6.11-13). Nous attendons d’être libérés de ces deux « souffrances du temps présent » (8.18) : libérés d’une enveloppe mortelle pour revêtir une immortelle (1 Cor 15.51-54), et libérés de la présence du péché.
Face à un tel futur, notre attente est certainement vive : quand enfin jouirons-nous pleinement de cette liberté ? Mais cette attente se doit également d’être « persévérante ». Le cri est sur nos lèvres : « Viens ! », mais nous laissons au Dieu sage le choix du moment. Quoi qu’il en soit, l’issue est certaine et Paul peut conclure ce paragraphe en affirmant que nous sommes déjà (au passé !) glorifiés (8.30).
L’espérance joyeuse (12.12)
Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. (12.11c-12b)
À partir du chapitre 12, Paul passe à une partie plus exhortative. Parmi les 20 à 30 courts impératifs des versets 9 à 21, il demande aux Romains de se réjouir en relation avec leur espérance. La joie est déjà nôtre ici-bas (Jean 15.11 ; 17.13 ; Phil 4.4), mais elle reste partielle et entachée de tristesses (2 Cor 6.10). Alors il vient un jour où nous ne serons « que joyeux » (Deut 16.15 ; És 35.10 ; Apoc 21.4).
Comme il l’a déjà ébauché plus haut, Paul encadre cette joie de l’espérance par l’exhortation au service (voir 6.22-23) et l’encouragement à la patience dans l’épreuve (voir 5.3). Le service tout comme l’endurance dans les peines auront leur contrepartie dans la joie éternelle du Maître et du Sauveur du corps.
L’espérance du jour (13.11-14)
Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. (13.11-14)
Dans ce paragraphe, Paul présente le salut non pas comme déjà acquis (sens qu’il a par ailleurs, cf. 1.16 ou 10.9-10), mais comme à venir. Le champ ouvert par ce mot de « salut » est extrêmement vaste, même si nous le limitons trop souvent au salut « initial » : il va jusqu’à notre espérance qui est le parachèvement de ce salut. Il nous est déjà acquis (Éph 1.13), nous y travaillons (Phil 2.12) et il sera complet demain (1 Pi 1.9).
Paul utilise l’image du « jour » et de la « nuit » pour décrire notre condition et demander notre vigilance. Nous sommes « du jour », des « enfants de lumière ». Même si c’est encore la nuit de l’absence de Jésus Christ, nous sommes exhortés à nous conduire comme s’il était déjà là. Il est facile de saisir ce que cela implique concrètement : le « monde de la nuit » n’est que bien rarement en concordance avec les principes de l’Évangile ! Qu’il s’agisse de corruption ou de violence, la majeure partie des inconduites ont lieu de nuit, l’obscurité faisant peut-être croire inconsciemment que le Dieu de lumière n’y voit rien… Notre conduite doit trancher et être transparente, « comme en plein jour ».
Paul n’hésite pas à donner des exemples. Essayons de les transposer à notre siècle : les orgies (ou « excès ») font penser à toutes les drogues, légales ou non, dont on abuse ; l’ivrognerie fait penser au le binge drinking qui ravage les adolescents ; la luxure, à la pornographie omniprésente ; la débauche, à la généralisation de la sexualité hors mariage ; les querelles, à la violence de nos cités, en paroles ou en actes ; les jalousies, au consumérisme qui pousse à envier le gadget de l’autre. Nous qui avons une espérance, disons fermement halte à toutes ces addictions !
Le Dieu d’espérance (15.4,13)
Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. (15.4) Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! (15.13)
Dieu reçoit ici ce titre unique de « Dieu de l’espérance ». Il est, lui, personnellement, la source de l’espérance. En effet, lui qui connaît tous les temps, lui qui est hors du temps, maîtrise l’avenir comme le passé. Si notre espérance n’est pas fondée sur sa personne elle-même, elle est vaine.
Dieu est la base de notre espérance et, pour nous la rendre vivante, abondante, il veut nous remplir de joie et de paix. Avec la justice, ce sont les trois caractères du royaume de Dieu actuellement (14.17). Vivre chaque jour joyeusement et paisiblement, c’est donc anticiper sur terre le temps espéré du royaume en gloire.
Pour alimenter notre joie et notre paix, pour fonder notre espérance, nous avons une ressource : des exemples bibliques à méditer, en particulier dans les récits de l’A.T. La vie d’un Noé, d’un Abraham, d’un Job, d’un Jérémie, etc., sont des leçons d’espérance. Quelle source d’encouragement pour nous !
L’espérance concrète pour l’année (15.24)
Ayant depuis plusieurs années le désir d’aller vers vous, j’espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j’aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. (15.23b-24)
Avant de donner de nombreuses salutations, Paul évoque à la fin de sa lettre ses projets de voyage en Espagne via Rome. Nous connaissons la suite… Paul est bien allé à Rome, mais pas comme il l’avait prévu !
Il est légitime de faire des projets en ce début d’année, de planifier des rendez-vous, des voyages, des occasions de service, etc. Mais sachons aussi accepter les contretemps, renoncer à des projets qui remplissaient le cœur (Job 17.11).
Paul sera prisonnier à Rome plusieurs années, et ce sera l’occasion pour lui d’écrire quatre lettres qui resteront pour l’édification des chrétiens de tous les temps. La « pleine bénédiction de Christ » (15.29) sera là, bien réelle, mais elle sera différente de celle qu’il avait anticipée. Aussi soyons assurés que, même si notre chemin n’est pas tout à fait conforme dans le détail à nos espérances, il concourt à notre bien (8.28).
L’espérance de la fin du mal (16.20)
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! (16.20)
Même si le terme « espérance » n’y est pas, il semble approprié de terminer par cette promesse qui forme une première conclusion à cette lettre. Il est aujourd’hui ici-bas des mystères non élucidés — et la chute de Satan, ainsi que son action actuelle, n’en est pas le moindre. Mais un jour, la puissance maléfique qui agit encore et qui parfois nous voile l’espérance en nous gâchant le présent et en obscurcissant l’avenir, sera définitivement mise hors d’état de nuire. Quelle attente !
Le souhait final, donné deux fois (16.20b,24), fait écho à celui qui clôt l’ensemble de la révélation (Apoc 22.21). Dans ce temps de l’espérance qui nous sépare de la venue de notre Sauveur et Seigneur, sa grâce est là, chaque jour, et cela nous suffit.
- Dix-sept fois. Rapporté au nombre de mots du livre, il en va différemment : des Épîtres comme 1 Thessaloniciens ou 1 Pierre ont proportionnellement plus de mentions.
- Il est au demeurant étonnant de constater que les partis écologistes sont souvent les plus en pointe pour promouvoir le laxisme moral — en totale incohérence avec l’interdépendance signalée.
- Les « Grenelle de l’environnement » (I et II) rassemblent des engagements en faveur de l’environnement et de l’écologie, élaborés en France par le gouvernement et des ONG en 2007 et 2008.
Le Psaume 119 est une hymne magnifique qui exalte la grandeur de la Parole de Dieu. Dieu a permis que le plus long chapitre de la Bible soit celui qui encourage le plus à lire cette Parole, à la méditer et à la mettre en pratique.
Dans ce Psaume 119, comme dans d’autres Psaumes et plus encore dans les Proverbes, il n’est pas toujours aisé de saisir le lien entre les versets successifs. Cet apparent désordre fait écho à la diversité de notre vie, où nous passons d’une circonstance à une autre, d’une occupation à une autre, d’un état d’âme à un autre — et, dans chaque situation, la Parole est là, pertinente, guide sûr auquel nous pouvons nous référer.
Rappelons que le Psaume 119 constitue un acrostiche élaboré, composé de 22 strophes de 8 versets chacune, chaque verset d’une même strophe commençant par la même lettre de l’alphabet hébraïque, dans l’ordre de cet alphabet. Cet agencement suggère que la Parole de Dieu est complète et couvre tous les domaines (de A à Z, dirions-nous aujourd’hui).
Dans cet article, nous allons chercher à glaner quelques enseignements sur l’importance de la Parole dans nos vies, au fil de trois des 22 strophes de ce Psaume11.
89 A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux.
90 De génération en génération ta fidélité subsiste ; Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.
91 C’est d’après tes lois que tout subsiste aujourd’hui, Car toutes choses te sont assujetties.
92 Si ta loi n’avait fait mes délices, J’aurais alors péri dans ma misère.
93 Je n’oublierai jamais tes ordonnances, Car c’est par elles que tu me rends la vie.
94 Je suis à toi : sauve-moi ! Car je recherche tes ordonnances.
95 Des méchants m’attendent pour me faire périr ; Je suis attentif à tes préceptes.
96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait : Tes commandements n’ont point de limite.
Les trois premiers versets magnifient la grandeur et l’éternité de la Parole : elle est à la fois établie dans les cieux (v. 89) et agissante sur la terre (v. 90)12.
C’est grâce à elle que les lois de la création restent valables. Le N.T. s’en fait l’écho quand l’auteur de l’Épître aux Hébreux affirme que la création, surgie à la parole du Créateur, est maintenue par sa même « parole puissante » (Héb 1.3). Et c’est le Fils, Parole vivante, artisan de la création, qui continue d’agir pour maintenir la cohérence de notre univers : sans lui et sa parole providentielle, il serait impossible de parler de “lois de la physique” !
« À toujours », dit le psalmiste : la fermeté éternelle de cette Parole a été attestée par Jésus lui-même : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » (Mat 24.35) Nous pouvons donc avoir une pleine confiance dans cette Parole, objective et permanente. Dieu s’est engagé par écrit — il ne reniera pas et ne se contredira jamais.
Cette Parole créatrice est aussi rédemptrice (v. 92). Comment échapper à notre « misère » fondamentale d’êtres marqués indélébilement par le péché, sinon en accordant foi à la Parole de Dieu (Rom 10.17) ? Dans sa grande diversité, elle possède la puissance de communiquer la vie (v. 93) et l’Esprit de Dieu a pu utiliser les textes les plus variés de l’Écriture comme moyen de salut.
Désormais j’appartiens à Dieu (v. 94). Pour autant, le salut initial reçu se prolonge par un salut au quotidien ; d’où l’exclamation : « Sauve-moi ! » Non parce que je pourrais perdre mon salut éternel, mais parce que j’ai chaque jour à mettre en œuvre ce salut, en particulier pour être délivré des ennemis du chrétien, les « méchants » (v. 95) — tout ce qui s’oppose à ma croissance chrétienne (cf. Éph 6.10-18). Et le moyen reste le même : rechercher les ordonnances, être attentifs aux préceptes de Dieu. J’ai donc un besoin vital de trouver dans la Parole le moyen d’être délivré et protégé, avant tout dans mes pensées.
Le v. 96 conclut cette strophe par une description magnifique mais paradoxale de la Parole de Dieu :
– D’un côté, la Parole, « parfaite », sans erreur, sans faute dans chacun de ses détails et toute ensemble, est « bornée » : elle contient un nombre fini (quoiqu’imposant !) de mots et des avertissements très sévères sont donnés à celui qui voudrait dépasser ces bornes en y rajoutant (cf. Apoc 22.18 ; Marc 1.1-13). Aussi ne nous laissons jamais imposer comme « parole de Dieu » ce qui ne s’y trouve pas.
– D’un autre côté, les commandements divins « n’ont pas de limite » : ces mots finis dans leur nombre sont susceptibles d’une infinité d’application dans leur faculté de répondre aux besoins de chaque croyant, au milieu de la diversité de ses circonstances propres. Laissons la Parole, toujours pertinente et vivante, nous parler, ici et maintenant ; laissons-nous saisir par tel verset, peut-être lu et relu déjà maintes fois, mais qui va prendre un relief nouveau.
97 Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.
98 Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, Car je les ai toujours avec moi.
99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l’objet de ma méditation.
100 J’ai plus d’intelligence que les vieillards, Car j’observe tes ordonnances.
101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin de garder ta parole.
102 Je ne m’écarte pas de tes lois, Car c’est toi qui m’enseignes.
103 Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche !
104 Par tes ordonnances je deviens intelligent, Aussi je hais toute voie de mensonge.
Cette strophe commence par un élan d’amour du psalmiste pour la loi de Dieu. Cette expression résonne de façon étrange pour la plupart d’entre nous pour qui la « loi » est plus synonyme de contrainte, de texte aride, d’interdits, que de délices littéraires. Il est peu probable que les textes du Lévitique ou du Deutéronome fassent partie des lectures bibliques qui nous transportent le plus… Mais « c’est le langage d’un homme ravi par une beauté morale » car les lois de l’Éternel sont « les directions réelles, valides ou irréfutables ; elles sont fondées sur l’essence même des choses et sur la nature de Dieu »13.
Le paradoxe de la liberté chrétienne est d’aimer ce qui nous contraint car la loi de Dieu me libère du péché pour être soumis volontairement au Seigneur (Jac 1.22 ; Rom 6.17 ; 8.1-4). Ouvrir la Bible n’est alors plus un pensum mais une immense joie, un délice meilleur encore que le miel (v. 103 ; cf. Jér 15.16).
Cet amour pour la Parole n’est pas de la bibliolâtrie, mais l’expression de notre amour pour son Auteur. Comment prétendre aimer le Seigneur sans jamais ouvrir la lettre d’amour qu’il nous a envoyée ? Cette lettre nous permettra de le connaître, et de le connaître vraiment, non pas selon notre imagination ; car notre seule source de connaissance objective est l’Écriture sainte.
Cet amour du psalmiste se traduit par une méditation continuelle (v. 97b). Comme pour l’exhortation « priez sans cesse », nous avons de la peine à comprendre ce que les auteurs bibliques veulent dire par ces expressions qui nous paraissent excessives. Comment concilier nos occupations légitimes à une méditation ou une prière ininterrompues ? Cependant, même les plus occupés d’entre nous ont des « temps morts », des moments creux (trajets, attentes dans une file, etc.), qui peuvent être mis à profit pour « ruminer » un texte lu le matin… Méditer est différent d’étudier. Méditer, c’est laisser la Parole pénétrer profondément dans notre être intérieur ; c’est appliquer les mots du texte sacré à notre vie ; c’est laisser la Parole demeurer en nous dans toute sa richesse (Col 3.16) pour modeler nos actions, nos paroles, nos sentiments.
Les conséquences développées dans les v. 98 à 100 surprennent : le psalmiste semble avoir « pris la grosse tête » et être plus enflé qu’édifié dans l’humilité (1 Cor 8.1) ! Il s’agit en fait d’un raisonnement a fortiori : posséder la Parole donne un « plus » que même les gens les plus instruits (les « maîtres », v. 99), même les gens les plus expérimentés (les « vieillards », v. 100), même les gens les plus opposés (les « ennemis », v. 98) n’ont pas. Nous pouvons ainsi à juste titre nous glorifier dans cette Parole de Dieu qui nous a été révélée et, par elle, poser la seule base valable d’une vraie connaissance (cf. Prov 1.7 ; 9.10).
Les v. 101 et 104 se complètent : d’un côté, la Parole nous aide à ne pas nous égarer (v. 104) ; d’un autre côté, c’est celui qui s’éloigne du mal qui peut garder la Parole (v. 101), car la connaissance est « selon la piété » (Tite 1.2). La causalité va dans les deux sens et engendre un cercle vertueux.
L’enseignement dispensé par la Parole est directement attribué à Dieu (v. 102) : quelle motivation pour la garder « dans la foi et dans l’amour » (2 Tim 1.13) ! L’autorité de la Parole vient de son origine, de celui qui parle par elle.
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.
106 Je jure, et je le tiendrai, D’observer les lois de ta justice.
107 Je suis bien humilié : Éternel, rends-moi la vie selon ta parole !
108 Agrée, ô Éternel ! les sentiments que ma bouche exprime, Et enseigne-moi tes lois !
109 Ma vie est continuellement exposée, Et je n’oublie point ta loi.
110 Des méchants me tendent des pièges, Et je ne m’égare pas loin de tes ordonnances.
111 Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, Car ils sont la joie de mon cœur.
112 J’incline mon cœur à pratiquer tes statuts, Toujours, jusqu’à la fin.
Le v. 105 est peut-être le plus connu (et le plus chanté !) des 176 versets du Psaume. La Parole est là, tant pour nous donner les indications très concrètes pour le détail immédiat de la journée (« à mes pieds »), que pour nous tracer des perspectives de vie à long terme (« sur mon sentier »). Elle est là tant pour les jours d’ombre (la « lampe ») que pour illuminer toute notre existence (Jean 8.12).
Les v. 106 et 112 marquent de forts engagements du psalmiste. Il a pris la ferme résolution dans son « cœur » de consacrer du temps à étudier la Parole et, surtout, à la mettre en pratique, dans la durée, avec constance. Voulons-nous les faire nôtres ? Décider de mettre à part du temps chaque jour pour la Bible, en dépit de toutes les occupations et les “pièges à temps” de notre vie moderne ?
Le v. 108 rapproche les « sentiments » des « lois ». Nos sentiments sont à passer au crible de la Parole de Dieu dans toute sa rigueur pour être approuvés par Dieu. Le croyant ne se laisse pas envahir par ses sentiments mais laisse l’Écriture les canaliser, car elle a la capacité de pénétrer entre âme et esprit (Héb 4.12).
Les deux derniers versets ouvrent une perspective vers l’avenir, marquée par la répétition de « toujours ». L’ « héritage » que Dieu nous a préparé est déjà là, présent dans le texte inspiré, qui en est pour ainsi dire l’acompte (v. 111). La Bible ranime en nous l’espérance d’un futur éternel. En dépit des oppositions (v. 110) et des circonstances de vie difficiles (v. 107, 109), elle suscite en nous une joie actuelle et qui un jour sera parfaite. Et pour fortifier cette attente, rien de tel que de mettre en pratique la Parole entendue (v. 112).
* * *
Dans ces 24 versets, nous avons vu :
– l’origine de la Parole : elle vient de Dieu ; par son moyen, nous sommes mis en relation avec lui, comme l’indiquent tous les « tu » de ces textes ;
– la nature de la Parole, à la fois finie et infinie ;
– les effets de la Parole, à la fois objectifs (la vie, la délivrance, la direction) et subjectifs (la joie, l’amour, la louange) ;
– l’exigence de la Parole, qui doit être méditée et mise en pratique.
L’expérience décrite par le Psaume 119 est avant tout personnelle (le psalmiste parle à la première personne du singulier). Si utiles que soient les aides apportées par la communion fraternelle autour de la Bible ou par l’enseignement dans l’église, le Seigneur nous demande un engagement personnel pour sa Parole, pour l’aimer et la vivre.
- Le choix de ces 3 strophes parmi les 22 est un peu arbitraire. Toutefois, elles débutent la 2de moitié du Psaume et sont particulièrement riches d’expressions diverses sur la Parole. De plus, plutôt qu’une étude thématique de ce Psaume, plus fréquente, il est utile de se laisser enseigner aussi par les enchaînements des versets.
- Le v. 90 est un des 7 versets parmi les 176 du Psaume qui ne mentionne pas explicitement la Parole sous une forme ou une autre (cf. v. 3,37,84,121,122,132).
- C.S. Lewis, Réflexions sur les Psaumes, p. 89.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Jean 3.16
On raconte qu’au XIXe siècle un prédicateur avait été invité pour une série de 7 soirées d’évangélisation. Le premier soir, il choisit pour texte Jean 3.16. Le deuxième soir, il reprit le même passage. À la surprise des organisateurs, il revint sur ce seul verset pendant les 7 soirées, sans pour autant répéter le même message !
Ce verset est un des plus connus (le plus connu ?) de toute la Bible. Peut-être même est-il celui qui a été à l’origine du plus grand nombre de conversions. Mais c’est aussi l’un des plus riches de l’Écriture. En quelques mots, il balaye les principaux thèmes bibliques, en donnant des éléments essentiels sur Dieu, l’homme, Christ, le salut et l’avenir.
Ce verset est parfois cité ou chanté sans omettre le « car » du début. En effet, il vient au milieu d’un échange entre Jésus et Nicodème1. À ce docteur de la loi, Jésus annonce les rudiments de la foi, avec la nécessité de la nouvelle naissance. Si avancées que puissent être nos connaissances bibliques, nous avons toujours besoin de revenir à la base, puiser aux profondeurs insondables de ce texte unique.
Théologie : ce que Jean 3.16 dit sur Dieu
Dans la Bible, Dieu ne commence pas parse présenterou par se décrire, mais il impose d’emblée sa réalité et sa présence. « Au commencement, Dieu… »,affirme la première page du texte sacré. Quoi qu’en disent les athées, l’idée de Dieu est innée au cœur de tout homme.
L’action de Dieu en création dévoile à qui veut bien le reconnaître sa puissance et sa sagesse (Rom 1.19-20). Mais son être profond, amour et lumière, n’est connu que par ceux à qui il se révèle.
Car qui est ce Dieu dont l’être humain pressent l’existence ? Quelle est sa vraie nature ? Adolphe Monod imagina qu’un jour, onavait découvert à Pompéi un fragment de manuscrit sur lequel était inscrit un extrait de 1 Jean 4. On arriva avec peine à déchiffrer d’abord : « Dieu est… » Quelle attente pour savoir la suite ! Enfin le mot crucial se découvre : « amour ». « Dieu est amour. » Monod s’exclame : « Oh ! Révélation bienheureuse qui met fin à toutes nos anxiétés 2 ! »
Mais pour autant on ne peut pas dire que l’amour est Dieu — contrairement à ce que prétend notre civilisation post-moderne qui idéalise et idolâtre « l’amour » (ce qui est fait « par amour » serait forcément bon, justifiable et inattaquable). Or Dieu est tout autant lumière qu’amour. Cependant on a pu dire avec justesse que l’amour est « premier » en Dieu, car il est à l’origine de son plan éternel (Éph 1.5) 3.
L’amour divin recouvre des facettes très diverses4. Notre verset en met une en exergue : l’amour selon Dieu est action, et Dieu « donne ». L’homme se représente volontiers la divinité comme exigeante — demandant de la part de la créature des offrandes, des prières, une conduite spécifique — alors que le Dieu vivant et vrai commence toujours par donner, librement, gracieusement, généreusement !
Quand nos filles étaient petites, nous avions un livre pour enfants intitulé « Dieu donne » ; sur chaque page, une simple phrase : « Dieu donne le soleil », « Dieu me donne des parents », etc., pour finir par « Dieu me donne son Fils ». Apprendre à des enfants, dès leur jeune âge, à concevoir Dieu d’abord comme le Donateur, quel privilège et quelle richesse pour eux.Cette pensée les accompagnera leur vie durant.
Anthropologie : ce que Jean 3.16 dit sur l’homme
Dieu a tant aimé « le monde ». Ce mot revêt plusieurs sens dans les écrits de Jean :
– 1° Il peut désigner le « cosmos », l’ensemble de l’univers créé ; c’est le sens qu’il prend quand le Fils parle à son Père de la gloire qu’il avait « avant que le monde soit » (Jean 17.5).
– 2° Il peut indiquer l’ensemble des êtres humains, quels qu’ils soient — et c’est sans doute la connotation la plus présente dans notre verset : Dieu aime tous les hommes et les femmes de la terre, sans exception.
– 3° Le plus souvent chez Jean, il qualifie le système opposé à Dieu, marqué par le péché, dont le diable est le prince (Jean 14.30) et qu’il ne faut pas aimer (1 Jean 2.15).
S’il est utile de distinguer ces trois sens, il convient également de les rassembler : le « système monde » opère par le moyen d’êtres humains et l’action pécheresse du monde a entaché la création qui soupire après sa délivrance.
Dieu aime globalement toute l’humanité ; Dieu aime également chaque individu : c’est ce qu’indique le « quiconque » qui suit. Le côté individuel de son amour s’allie parfaitement avec son aspect collectif.
Et pourtant les personnes que Dieu aime ne sont pas aimables en elles-mêmes ! Contrairement à la forme la plus commune de l’amour humain, l’amour de Dieu ne trouve pas sa source dans les qualités réelles ou supposées de ses objets. Dieu aime des gens « dignes d’être haïs » (Tite 3.3) et entêtés dans le péché, comme Jésus l’indique dans les versets qui suivent : « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » (3.19) C’est ainsi que je dois me voir.
Aussi notre verset établit-il clairement le sort de cette humanité pécheresse : elle est destinée à périr, à mourir, à subir le juste jugement éternel d’un Dieu saint.
Christologie : ce que Jean 3.16 dit sur Jésus
Dieu a donné « son Fils unique » par amour. L’existence de plusieurs « personnes » en Dieu est en pleine cohérence avec la nature d’amour du Dieu trinitaire. L’amour, pour exister, a besoin d’un objet en dehors de lui-même. En un sens, on peut dire qu’un Fils est nécessaire pour que Dieu soit vraiment et éternellement amour. La relation d’amour entre le Père et le Fils est la base et le modèle de toute autre relation d’amour5.
Ce Fils est qualifié ici de « Fils unique ». La filiation de Jésus préexiste à son incarnation (1.18) et se distingue de la filiation dérivée qui est désormais la nôtre, à nous chrétiens, qui recevons le témoignage du Ressuscité : « Je monte vers mon Père et votre Père. » (20.17) Dans notre relation avec Dieu, subsiste, en même temps qu’une proximité réelle (« afin qu’eux aussi soient un en nous », 17.21), une distance liée à l’unité bien plus grande qui existe entre le Père et le Fils, éternellement et ontologiquement « un » (10.30).
Le Fils est celui qui « fait connaître » le Dieu que personne n’a jamais vu (1.18). Tout, dans sa vie terrestre et son ministère — paroles, actes, sentiments — est empreint de l’amour de Dieu.
Jésus, don d’amour de Dieu personnifié, va « mettre le comble » (cf. 13.1) à cette démonstration d’amour par l’offrande de sa vie sur la croix. L’Évangile ne détaille pas la signification théologique de la croix ; ce sera le rôle des Épîtres. Mais le simple rappel que fait le Sauveur d’un épisode de l’A.T. suffit à faire entrevoir les profondeurs de la croix : « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert… » (3.14) Jésus a été « fait serpent », l’animal sous la forme duquel le péché est entré dans le monde. Il s’est identifié au péché même : « Celui qui n’a point connu le péché, [Dieu] l’a fait devenir péché pour nous. » (2 Cor 5.21)
C’était le seul moyen pour réconcilier la théologie et l’anthropologie de notre verset : comment un Dieu qui est amour peut-il montrer son amour envers une humanité pécheresse ? Uniquement par le don de lui-même dans la personne de son Fils.
Sotériologie : ce que Jean 3.16 dit sur le salut
Le don du Fils à la croix procure le salut pour le monde. Jean 3.16 est un modèle de condensé magnifiquement équilibré de la doctrine du salut :
• Le salut est une initiative divine : C’est Dieu qui est acteur, qui a aimé et qui a donné son Fils. Le « il faut » du verset 14 indique cette nécessité morale impérative, seul moyen de concilier l’amour et la sainteté divines dans un acte unique.
• Le salut est offert à tous les hommes : Dieu a aimé « le monde » et nul n’est exclu du « quiconque ». L’universalité de l’offre ne saurait être exprimée plus clairement. Aussi ne pensons pas non plus que l’offre se limite seulement à ceux qui croiront un jour. Etne pensons jamais que quelqu’un puisse être déchu a priori de la grâce de Dieu.
• Le salut réclame une réponse personnelle : Il est nécessaire que l’individu à qui est proposé ce salut « croie »6 . Le salut est offert par le don de Dieu — encore faut-il accepter ce don. Mais cette démarche de foi n’est pas plus méritoire que le regard que l’Israélite malade jetait au serpent d’airain. Elle est la réponse obéissante à l’offre généreuse et toute suffisante de Dieu. Plus encore, celui qui a répondu positivement à ce cadeau réalise ensuite que c’est le Père qui l’a attiré (Jean 6.44).
• Le salut est une volonté de Dieu : La tournure négative (« ne périsse pas ») l’indique. Le verset qui suit le précise : « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (3.17) Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il vive (Éz 18.23 ; 33.11).
Ce verset étaye donc clairement ce que les théologiens ont appelé « l’expiation universelle hypothétique » : l’expiation de Christ à la croix est suffisante pour tous et efficace pour ceux qui croient (cf. Luc 7.29-30).
• Le salut est éternel : Le temps du dernier verbe, le présent, ne laisse planer aucun doute : celui qui croit « a » la vie éternelle (3.36). Aucune restriction n’est rajoutée : la vie que nous recevons n’est pas conditionnée à notre ressenti, à notre fidélité, à des sacrements ; elle est liée à Dieu lui-même, Père et Fils (10.28-29) et il est impossible qu’elle nous soit ôtée. Paul énumérera beaucoup de « choses » menaçantes, mais il conclura glorieusement qu’aucune d’elles ne peut « nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Rom 8.37-39).
Eschatologie : ce que Jean 3.16 dit sur l’avenir
Sous la plume de Jean, la « vie éternelle » est avant tout qualitative : elle est la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils, selon la “définition” de Jésus lui-même (17.3). Et cette relation est déjà actuelle (1 Jean 1.2-3).
Mais, même si cette note est moins présente, la vie éternelle a aussi un aspect quantitatif : une vie sans fin, pour l’éternité, dans la présence bienheureuse de Dieu. C’est pourquoi Jésus la relie souvent à la « résurrection au dernier jour ». Nous attendons le jour où, dans des corps parfaits, la réalisation de notre relation avec les personnes divines sera enfin parfaite, complète, ininterrompue.
Conclusion : ce que Jean 3.16 me dit personnellement
Nous venons d’effleurer quelques-unes des profondeurs théologiques de ce verset. Nous avons pu voir plusieurs facettes de sa richesse. Mais avant tout, ce verset doit rester un appel extraordinaire à notre cœur. J’invite donc chaque lecteur à méditer ce verseten remplaçant le « monde » et « quiconque » par son propre nom. Oui, Dieu m’a tant aimé, moi, le pécheur, qu’il a donné son Fils unique pour moi afin je ne périsse pas mais que j’aie la vie éternelle. J’en bénis Dieu éternellement et dès aujourd’hui !
1 Certains commentateurs estiment que les v. 16 à 21 sont un ajout de l’évangéliste qui ne faisait pas partie de l’échange initial avec Nicodème. Toutefois l’unité de thèmes des v. 1 à 21 incline à penser à une continuité de situation.
2 Adolphe Monod, « Dieu est amour », Pages choisies, G.M., 1982, p. 32.
3 Il est présomptueux de vouloir classer ou peser les attributs divins. Notons cependant qu’il est dit deux fois « Dieu est amour » pour une fois « Dieu est lumière ». Si Dieu avait montré d’abord toute sa lumière, nous aurions été consumés !
4 Voir Donald Carson, « La doctrine difficile de l’amour de Dieu », Promesses 184, p. 1 à 5. Dans cet article, qui résume un de ses livres paru en anglais, l’auteur détaille 5 aspects différents et complémentaires de l’amour de Dieu, tels que la Bible les présente.
5 Voir sur ce sujet l’article du même auteur, « Le carré de l’amour », Promesses n° 164, p. 29 à 31.
6Jean n’emploie jamais le substantif « foi » mais toujours le verbe correspondant « croire ». Le français ne permet malheureusement pas de relier spontanément ces deux mots ; aussi certaines versions traduisent-elle « croire » par « mettre sa foi ».
Qu’est-ce que le royaume de Dieu ?
La notion de « royaume de Dieu » paraît bien floue à certains chrétiens. Face à des interprétations parfois contradictoires, les questions affluent : Est-il actuel ou futur ? Est-il seulement pour Israël ou aussi pour nous ? Peut-on dire que Jésus est notre roi ? Qu’est-ce que « l’évangile du royaume » ? Le royaume de Dieu est-il différent du royaume des cieux ?
Cet article ne prétend pas répondre à toutes ces questions (d’autres articles de ce numéro s’y essayeront), mais il vise à clarifier le sens du royaume et à décrire son développement.
Qu’est-ce qu’un roi ?
Selon le dictionnaire, un roi est : – soit un chef d’état qui accède au pouvoir souverain par voie héréditaire, – soit une personne qui domine un champ particulier (le roi du pétrole), – soit un représentant éminent d’une espèce donnée (le roi des animaux).
Le Nouveau Testament utilise le terme « roi » (basileus) pour désigner l’empereur romain, comme c’était le cas dans la koinè, la langue grecque populaire du 1er siècle (cf. 1 Pi 2.17). Ce terme peut aussi désigner un roi plus local comme Hérode le tétrarque (cf. Mat 14.9), mais aussi Dieu lui-même ou Christ (cf. Apoc 15.3).
Qu’est-ce qu’un royaume ?
Qui dit roi, dit royaume. Selon le dictionnaire, un royaume désigne soit un pays gouverné par un roi, soit les sujets d’un roi.
Et là, le sens biblique prend des acceptions plus larges. Le sens premier de « royaume » (basileia) est abstrait ou conceptuel, plutôt que géographique ; il désigne avant tout la souveraineté, le pouvoir royal, la domination, le pouvoir de gouverner. Ce n’est que dans un sens second, par métonymie, qu’il prend une signification concrète pour désigner le territoire ou le peuple sur lequel règne une personne appelée « roi ». C’est pourquoi plusieurs versions rendent justement le terme par « règne » plutôt que par « royaume », trop connoté en français.
Le parallélisme du Psaume 145 aide à saisir le sens biblique fondamental du « règne » ou « royaume » : « Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » (Ps 145.11-13) Le « règne » répond à la « puissance », à la « domination ».
Cela étant, comme on l’a dit, le « royaume est une des notions les plus complexes de l’Écriture »…
1. Dieu, le roi créateur
La souveraineté absolue de Dieu
L’Écriture affirme que Dieu est roi, en raison de sa nature même de Dieu grand et éternel (Ps 93.1-2 ; 95.3 ; 103.19). La première doxologie de 1 Timothée proclame : « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! » (1 Tim 1.17)
Il est aussi roi parce qu’il est le créateur (Ps 47 ; 29.10) : il domine sur les œuvres de ses mains.
N’ayons donc aucune crainte à appeler Dieu notre roi : c’est reconnaître sa grandeur intrinsèque et ses droits de Créateur.
Dieu et les rois de la terre
En créant l’homme, Dieu lui a délégué une part de son autorité (Gen 1.28). Mais l’homme, par son péché, s’est volontairement assujetti au diable. Satan est devenu le prince du monde, sans être qualifié de roi (Luc 4.6).
Après le déluge, l’homme se voit confier une responsabilité de gouvernement. Le premier roi mentionné est Nimrod (Gen 10.10). Mais si les rois de la terre exercent une autorité déléguée (Rom 13.1-7), Dieu est pourtant toujours au-dessus des rois ; il est « le Dieu des dieux et le Seigneur des rois » (Dan 2.47). Il est aussi le « faiseur » des rois : « C’est lui qui renverse et qui établit les rois. » (Dan 2.21) « Le Très-haut domine sur le royaume des hommes et il le donne à qui il veut. » (Dan 4.32)
2. La royauté de Dieu sur Israël
L’origine de la royauté
Babel et l’histoire humaine subséquente conduisirent Dieu à choisir un peuple particulier, Israël, issu d’Abraham, par lequel la royauté sur le monde serait établie (Gen 12.3). Israël devait être une lumière pour toutes les autres nations : « Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » (Ex 19.5-6)
La théocratie en Israël
Pendant plusieurs siècles, de Moïse à Samuel, le peuple fut sous la domination directe de Dieu : c’est l’Éternel qui dominait sur le peuple (Jug 8.22-23) et ses conducteurs puis ses juges n’étaient là que pour le conduire et le ramener à Dieu.
Mais, lassé de la théocratie directe, le peuple réclama un roi humain (1 Sam 8.4-6). La réponse de l’Éternel indiquait clairement qu’il s’agissait d’un refus déguisé de son autorité : « C’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » (1 Sam 8.7) Désormais la royauté divine deviendrait indirecte, avec la médiation d’un homme comme roi.
3. L’annonce de la venue du Roi
En même temps qu’une royauté humaine se met en place sur Israël, Dieu commence à annoncer la venue d’un roi, de son roi, le Roi parfait et définitif. Cette annonce se fait :
– Par les rois d’Israël : Après Saül (qui représente l’homme incapable de remplir le plan de Dieu), David (le roi selon le cœur de Dieu, qui délivre le peuple de Dieu de ses ennemis) reçoit la promesse d’un descendant dont le « trône sera pour toujours affermi » (1 Chr 17.11-14). Salomon, le fils direct de David, même si son règne fut brillant, ne faisait qu’annoncer un « plus grand » que lui, le Roi glorieux qui règne en justice.
– Par les prophètes : Au fur et à mesure de la déliquescence de la royauté en Israël et en Juda, les annonces prophétiques du royaume se font plus précises. Emmanuel, le fils donné (És 9.7) sera le Roi qui règnera selon la justice (És 32.1), le « germe juste qui règnera en roi » (Jér 23.5), celui qui unira les deux fonctions rigoureusement distinctes sous l’ancienne alliance de la royauté et de la sacrificature (Zach 6.13).
4. La première venue du Roi et son rejet
La naissance du Roi
Les premiers mots de l’Évangile établissent le droit juridique de Jésus-Christ au trône : il est avant tout le « fils de David » promis, enfin là (Mat 1.1). Dès avant sa conception, l’ange annonce à Marie que l’enfant qui va naître est bien le Roi promis : « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. » (Luc 1.32-33)
Les mages qui viennent peu après le reconnaissent comme « le roi des Juifs qui vient de naître » (Mat 2.1-2). À travers eux, la royauté de Jésus dépasse dès sa naissance le cercle du seul peuple d’Israël.
Le royaume prêché
Si le Roi est né, c’est que le royaume s’est approché. Dieu n’est plus seulement le créateur absolu, dominant sur ses œuvres ; le Roi est entré dans sa création pour visiter sa créature. Ce « rapprochement » du royaume de Dieu est le thème de la prédication :
– de Jean-Baptiste, en précurseur : « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » (Mat 3.1-2) ;
– de Jésus, dès le début de son ministère : « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1.14-15) ;
– des disciples, envoyés par le Roi : « Jésus envoya [les douze], après leur avoir donné les instructions suivantes […] : Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. » (Mat 10.5-7)
Les caractères du Roi et du royaume
Et pourtant ce royaume qui s’approchait dans la personne du Roi lui-même ne laissait pas de surprendre beaucoup ceux qui attendaient une manifestation bien plus politique et visible. Ce royaume paradoxal était marqué par :
– la discrétion : Quand « les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » (Luc 17.20-21)
– l’humilité : Montant à Jérusalem, Jésus accomplit la prophétie de Zacharie : le « roi qui vient » à Sion ne chevauche pas un cheval, l’attribut des rois du monde, mais « il est humble et monté sur un âne » (Zach 9.9).
Le Roi partiellement reconnu
À trois reprises, au moins, Jésus fut reconnu comme roi :
– au début de son service, par Nathanaël : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël » (Jean 1.49) ;
– après la multiplication des pains, lorsque les gens rassasiés vinrent l’enlever pour le faire roi — ce que Jésus refusa, car il ne souhaitait pas prendre un rôle politique : le royaume qu’il annonçait était d’un autre ordre ;
– lors de l’entrée à Jérusalem, quand la foule s’écria : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël ! » (Jean 12.13)
Le Roi rejeté
L’annonce de la venue du royaume n’a pas été reçue et le Roi a été rejeté :
– Au cours de son ministère, on attribua la puissance spirituelle indéniable qui se manifestait par des guérisons et des exorcismes à celle du diable (Mat 12). À partir de ce moment, la proclamation du royaume par Jésus prit une forme plus cachée, mystérieuse, au travers de paraboles destinées à révéler et à cacher (Mat 13.34-35).
– Le rejet alla s’amplifiant au cours des mois et fut scellé par le conseil des principaux des Juifs lors de la semaine pascale. Lors de son procès, Jésus indiqua à Pilate, effrayé d’avoir à juger un roi, que son royaume était d’un autre monde (Jean 18.33-37). Mais le procurateur n’hésita pourtant pas à suivre l’avis des Juifs et à condamner leur Roi.
– Le rejet aboutit finalement à la crucifixion du Roi ! Mais sur la croix, Dieu permit qu’un témoignage public multilingue annonce à tous ceux qui passaient que le crucifié était le « roi des Juifs » (Jean 19.19-22), pendu par la volonté délibérée d’un peuple qu’il était venu sauver mais qui le faisait mourir.
Le Roi glorifié
Jésus n’est pas resté dans le tombeau et le Ressuscité peut annoncer qu’il a désormais tout pouvoir dès aujourd’hui. L’Évangile du Roi se termine par cette proclamation : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. » (Mat 28.18) Paul confirme aux Éphésiens que « le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire a fait asseoir le Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir et qu’il a tout mis sous ses pieds. » (Éph 1.20-22)
Pour autant, ce pouvoir n’est pas encore visible et ne s’impose pas pour le moment : « Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » (Héb 2.8) Selon les plans de Dieu, la manifestation glorieuse et publique de la souveraineté de son Fils ne suit pas immédiatement la croix et sa glorification.
5. Le royaume en l’absence du Roi
Depuis le départ de Jésus, le royaume de Dieu prend une forme mystérieuse, paradoxale, temporaire : celle que nous vivons actuellement. Il est déjà là, mais pas encore pleinement établi.
Le royaume prêché
La prédication du royaume de Dieu continue dans la période actuelle. Sa proclamation est au cœur du livre des Actes, où il est mentionné à 7 reprises :
– prêché par le Seigneur ressuscité aux apôtres à qui il parla « des choses qui concernent le royaume de Dieu » (Act 1.3) ;
– prêché par Philippe en Samarie, qui « annonçait la bonne nouvelle1 du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ » (Act 8.12) : les Samaritains crurent Philippe qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus Christ.
– prêché par Paul, en particulier à Éphèse et à Rome (Act 19.8 ; 20.25 ; 28.31).
Chaque fois que le pur Évangile est annoncé, on proclame Jésus comme Sauveur et Seigneur — exactement le message du royaume de Dieu !
Les sujets du royaume
Le règne de Dieu s’étend aujourd’hui à tous ceux qui sont nés de nouveau (Jean 3.3-7). Avant de régner un jour, plus tard, les croyants sont actuellement « un royaume » (Apoc 1.5-6). Chaque fois qu’ils montrent dans leur vie les caractères du royaume — des caractères liés à ceux du Roi et à ce qu’il a montré sur terre — les chrétiens rendent visibles le règne de Dieu sur leur cœur : justice, paix et joie (Rom 14.17), puissance spirituelle (1 Cor 4.20), amour (Col 1.15)…
En l’absence du Roi, les sujets sont invités à « faire valoir » les dons qu’il leur a laissés (Luc 19.12-27), à être des ambassadeurs zélés de leur Seigneur (2 Cor 5.20). C’est aussi sur terre qu’ils préparent leur entrée dans le royaume visible futur : elle sera d’autant plus « largement accordée » (2 Pi 1.11) qu’ils auront été fidèles maintenant (2 Tim 4.1,18), même au travers des persécutions (Act 14.22 ; 2 Tim 2.12).
6. L’établissement du règne du Roi
L’établissement du royaume sur la terre
L’Apocalypse dépeint une scène où les vieillards adorent Dieu en disant : « Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. » (Apoc 11.17-18) L’introduction du royaume sera donc précédé d’une phase de jugements. Elle est liée à la victoire sur la coalition maléfique de l’Antichrist et du faux prophète sous l’instigation de Satan, et à la mise hors d’état de nuire de ce dernier (Apoc 12.10 ; 19.11-20.3).
Les caractères du règne
Les trois mêmes caractères moraux que nous sommes appelés à montrer aujourd’hui (Rom 14.17) seront alors visibles et partagés par une humanité apaisée : la justice (És 32.1-8 ; Ps 45.6 ; 89.14), la paix (Mich 4.3 ; 5.5), la joie (Ps 47.1-2).
La place centrale sera occupée par le Roi des rois qui règnera depuis Jérusalem sur la terre entière (Ps 2.6-7). L’épouse de l’Agneau partagera le règne de son royal époux (Col 3.4). Les apôtres auront une place privilégiée (Luc 22.28-30). Si Israël a une place centrale (És 60 ; Jér 3.17), toutes les nations seront bénies à travers lui (Zach 8.13,23 ; 14.16) — réalisation de la bénédiction faite autrefois à Abraham.
Jésus concentrera en sa personne tous les pouvoirs : selon És 33.22, il sera à la fois juge (pouvoir judiciaire), législateur (pouvoir législatif) et roi (pouvoir exécutif) : plus besoin de constitutions imparfaites pour garantir l’équilibre des pouvoirs : le Roi parfait les concentra tous pour la bénédiction de tous. Les trois fonctions autrefois séparées de roi, de prêtre (Zach 6.13) et de prophète (Apoc 19.13b,15a) seront réunies en lui.
7. Le royaume éternel
La fin du royaume terrestre
Le royaume terrestre est, selon nous, une nécessité théologique : « Il faut qu’il règne. » (1 Cor 15.25) Sur la terre où il a été rejeté, il faut qu’il soit reconnu et qu’il règne. Pour autant, le millénium n’est pas encore l’état final parfait : le péché et la mort seront toujours présents (És 11.4) et la révolte continuera à gronder dans certains cœurs, même de façon cachée (Zach 14.17-19). Aussi ce règne aura-t-il un aspect coercitif : l’autorité de Christ sera exercée avec une verge de fer (Ps 2.9-12 ; Apoc 2.26-27).
La vaste perspective tracée par Paul en 1 Cor 15.20-28 montre qu’au royaume médiatorial du Fils de l’homme succède « la fin », où Christ « remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l’impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance », jusqu’à la dernière, à savoir la mort. L’Apocalypse décrit le diable délié pour un bref laps de temps, la dernière révolte, le jugement final et la fin de la mort (Apoc 20).
Dieu, roi éternel
Alors est introduit finalement le règne éternel de Dieu. L’état éternel est une forme bien mystérieuse du royaume, peu explicite pour nous. « Dieu sera tout en tous. » (1 Cor 15.28) Il habitera avec les hommes « et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu » (Apoc 21.1-3). Ces mots doivent nous suffire pour aspirer à ce « royaume éternel » d’où toute opposition sera définitivement bannie, dans un bonheur, une paix et une harmonie que plus rien ni personne ne troubleront jamais.
Conclusion
Nous avons donc vu que l’essence du « royaume », cette domination souveraine de Dieu, est la même au cours de ces 7 phases ; mais son expression et sa manifestation varient dans l’histoire de la rédemption. Continuité et ruptures marquent l’histoire du règne de Dieu.
Nous vivons aujourd’hui dans une phase paradoxale, magistralement résumée dans l’expression « déjà… et pas encore » : le « siècle à venir » est « déjà » introduit depuis la première venue de Christ, mais il n’est « pas encore » réalisé. Les changements politiques ne sont « pas encore » là, mais les révolutions spirituelles dans les cœurs sont « déjà » en route. La puissance du royaume est « déjà » réelle, mais elle est « encore » résistible. Nous qui « aimons son apparition », qui prions « Que ton règne vienne », cherchons donc, en attendant que notre Roi vienne dans sa splendeur, à faire déjà sa volonté en démontrant dès aujourd’hui les qualités du Roi au travers de nos vies.
1 Litt. « évangélisait le royaume de Dieu », remarquable rapprochement entre le royaume et l’évangile.
1. Travailler : est-ce une malédiction ou un don de Dieu ?
« Le paradis, ce serait de n’avoir rien à faire », entend-on parfois, mais est-ce si vrai ? En Éden, Dieu avait donné un travail à Adam : cultiver et garder le jardin (Gen 2.15). Dieu a créé l’homme avec ce besoin d’activité qui s’exprime par le travail, équilibré par un temps de repos, dont parle le sabbat : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage. » (Ex 20.9-10)
L’introduction du péché dans le monde, à la suite de la désobéissance d’Adam et Ève, a changé le travail : il est devenu pénible : « [Dieu] dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre […], le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » (Gen 3.17-19)
Pour autant, le travail n’est pas à mépriser, ni à considérer comme une malédiction. Ceux qui sont au chômage depuis longtemps savent bien que leur état n’est pas à envier. L’Ecclésiaste disait que « se réjouir au milieu de son travail, c’est là un don de Dieu » (Ecc 5.19 ; cf. 3.13). Les Proverbes ajoutent : « Le précieux trésor d’un homme, c’est l’activité. » (Pr 12.27)
En résumé, dans tout travail, on trouve ce double aspect : d’un côté, donné par Dieu, mais d’un autre, entaché par le péché. Si nous avons du travail, soyons reconnaissants et considérons-le positivement, comme un cadeau que Dieu nous fait.
2. À quoi sert notre travail ?
Chômage contraint mis à part, la norme pour tout chrétien est de travailler : « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » (2 Thes 3.10-13)
Notre travail sert d’abord à assurer notre subsistance et celle de notre famille. L’oisiveté peut conduire à des dérives fâcheuses. À la question, posée un dimanche : « Que feriez-vous si le Seigneur revenait demain soir ? », un chrétien répondait : « J’irais à mon travail demain matin, comme d’habitude. » Ces versets de 2 Thessaloniciens peuvent aussi sans doute s’appliquer à des personnes qui vivent des prestations sociales ou aux crochets d’autrui, alors qu’elles auraient la possibilité de travailler.
Notre travail sert aussi à nous procurer de quoi donner de l’argent à ceux qui en ont besoin, chrétiens d’abord et aussi non-chrétiens : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » (Éph 4.28)
Notre travail est en soi un service vis-à-vis du Seigneur. La Bible ne fait pas la séparation que nous mettons trop souvent entre le travail « séculier » et le travail « pour le Seigneur ». Même les esclaves de l’Antiquité étaient encouragés à considérer leur travail si ingrat comme un service direct pour le Seigneur Jésus ! « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » (Col 3.23-24) Pensons-y, le matin quand nous partons travailler : nous allons servir le Seigneur ! Cette idée transformera notre journée.
En résumé, notre travail a au moins quatre buts : 1° nous permettre de vivre, 2° nous procurer de quoi donner, 3° éprouver de la joie, 4° servir Jésus.
3. Comment faire notre travail ?
Notre travail peut être pénible (en conséquence de la chute de l’homme, comme nous l’avons vu), mais nous sommes appelés à le faire « paisiblement » (2 Thes 3.12). Ne pas s’imposer un stress inutile (l’absence d’une ambition professionnelle démesurée y aidera) sera un témoignage et nous aidera également à être efficaces. Et si les conditions de travail nous oppressent, pourquoi ne pas en changer, si c’est possible ?
Bien faire son travail est aussi une forme de témoignage. Être diligent, en juste exécution du contrat de travail que nous avons signé, c’est « rendre ce qui est dû » (Rom 13.7). Les Proverbes avertissent : « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » (Pr 18.9)
Daniel est un modèle pour notre vie professionnelle : il a connu une carrière en dents de scie, mais a toujours été « fidèle » dans son travail (Dan 6.1-5). Être irréprochable dans son travail donne alors la possibilité de « dire la justice », y compris à ses supérieurs, et d’intercéder en faveur des autres. « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. » (Pr 22.29)
Dieu ne veut pas que nous cloisonnions nos vies : nous pouvons le faire intervenir directement dans les détails de notre travail pour qu’il nous donne la sagesse et les directions nécessaires. Le prophète Ésaïe offre une magnifique description de la sagesse que Dieu donne pour agir au mieux, en l’appliquant aux travaux d’un paysan : « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. […] Cela aussi vient de l’Éternel des armées ; admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » (És 28.24-29) Pour autant, ce n’est pas Dieu qui fera le travail à notre place !
Enfin, dans un monde professionnel où la contestation est si vite venue, rappelons que l’honneur que nous devons à nos « maîtres » (aujourd’hui nos supérieurs) passe par un comportement droit, exempt de critiques déloyales : « Que tous ceux qui sont sous le joug de l’esclavage regardent leurs maîtres comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. » (1 Tim 6.1)
En résumé, nous sommes invités à travailler paisiblement, diligemment, pieusement et droitement.
4. Quel métier choisir ?
Dieu a fait des dons aux hommes et ce qu’il nous dit des dons dans l’Église peut être transposé, dans une mesure, pour ce qui concerne le travail. En tant que créatures, nous sommes responsables vis-à-vis de notre Créateur d’utiliser ce qu’il nous a donné pour le bien-être des autres (au sens large) : « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. » (1 Pi 4.10)
Cela ne veut pas dire pour autant qu’un chrétien doive systématiquement choisir des métiers « sociaux » (par exemple : infirmier), surtout s’il n’est pas doué dans ce domaine ; car on peut accomplir n’importe quel travail pour son profit personnel (sa promotion, sa propre satisfaction, etc.) ou pour le bien des autres ; le bien-être de ceux-ci dépend beaucoup plus de notre manière de travailler que du travail en lui-même. C’est sans doute ainsi que le travail sera une source d’épanouissement personnel.
Le choix d’un métier passe d’abord par l’examen le plus honnête et le plus objectif possible de ses capacités et de ses goûts, dans la recherche de la volonté de Dieu (Rom 12.2b-3). L’examen de nos motivations (pourquoi je choisis cette voie plutôt que celle-là) nous permettra de voir dans quelle mesure nous sommes influencés par « le siècle présent » et nous amènera à ne pas nous y « conformer » (Rom 12.2a). Comme dans tous les choix de notre vie, c’est en recherchant d’abord le Seigneur et en lui abandonnant sa vie qu’on peut connaître sa pensée.
Le prestige des professions plus « intellectuelles » ou plus en vue ne doit pas devenir un mirage. L’utilité réelle d’un métier pour la société n’est, hélas, pas souvent fonction de sa rémunération ou de la considération qu’on lui porte ; nous sommes appelés à ne pas prendre comme norme l’échelle de valeurs du monde (Rom 12.16). Paul, que ses grandes capacités intellectuelles auraient pu appeler à des postes élevés, a exercé un métier manuel, qui lui a permis de rencontrer un couple qui deviendra un foyer pionnier de l’Évangile (cf. Act 18.1-4). De plus, comme le montre Paul, l’exercice d’un métier n’est pas un obstacle à un service actif pour le Seigneur.
Pour autant, il n’est pas forcément selon Dieu de viser une profession en deçà de nos capacités ; ce serait de la fausse humilité.
Récolter des avis sur les diverses professions est sage (Pr 15.22) : à la fois auprès de conseillers pédagogiques et auprès de chrétiens expérimentés, au-delà des parents, qui sont bien sûr les premiers « conseillers », mais qui peuvent faire parfois pression dans une direction qui ne convient pas à leur enfant.
En résumé, le choix d’un métier dépend d’abord des capacités et des goûts qu’on a reçus et il ne doit pas être dicté par les principes du monde, ni être fait sous la pression.
5. Faut-il changer de métier à sa conversion ? Pourquoi changer de métier ?
La conversion n’entraîne pas forcément un changement de travail. Des percepteurs d’impôts, peu estimés à l’époque, et des soldats vinrent se repentir au bord du Jourdain à la prédication de Jean-Baptiste. Perplexes, ils ont demandé à Jean : « Maître, que devons-nous faire ? » La réponse fut claire : inutile de changer de travail (Luc 3.12-14) ! En revanche, la façon dont on accomplira son travail sera modifiée, à la suite de la nouvelle orientation donnée à sa vie, comme le dit Jean Baptiste.
Lorsque le travail risque d’être une entrave majeure à la vie chrétienne, on est encouragé à saisir l’occasion de changer, si elle se présente. « Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète pas; mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. » (1 Cor 7.20-24)
Pour être complet, le travail se définit par : – sa nature (le métier lui-même) : quoi faire ? – son cadre (l’endroit où on l’exerce) : où le faire ? – la manière de l’exercer : comment le faire ?
Ces trois éléments sont importants, en particulier le second. Un croyant peut se sentir « esclave des hommes » dans son travail, si celui-ci est trop prenant, en temps ou en occupation d’esprit (en effet, toutes les entreprises n’ont pas la même exigence) ; si ce chrétien a l’opportunité de changer, Paul l’incite à la saisir.
Pour autant, mieux vaut éviter une trop grande instabilité et ne pas renoncer à un poste à la première difficulté avec sa hiérarchie : « Si l’esprit de celui qui domine s’élève contre toi, ne quitte point ta place. » (Ecc 10.4)
En résumé, il n’y a pas de métier spécifiquement « chrétien » et chacun doit examiner devant Dieu s’il peut continuer à exercer sa profession après sa conversion. Le cas échéant, changeons de travail, ou de lieu de travail, si c’est possible, lorsque nous en devenons esclaves.
6. Que penser du travail rémunéré de la femme mariée ?
Cette question est un luxe de notre société occidentale du xxie siècle : dans de nombreux pays, et en France il n’y a pas longtemps, l’épouse n’avait pas le choix ; elle devait travailler pour qu’il y ait à manger à la maison. Paul écrit à des églises locales où de nombreuses femmes sont esclaves ! Pour autant, la priorité pour la femme chrétienne est donnée par Paul : « [Que les femmes âgées apprennent] aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » (Tite 2.4-5) La profession de la femme (par nécessité ou par choix) doit s’allier avec sa vie de couple, de famille et de maîtresse de maison. Doser ces diverses activités de façon équilibrée est un exercice délicat, mais le Seigneur, par son Esprit, donnera direction et paix, dans une vision de couple partagée.
La Parole donne de nombreux cas de femmes actives et pieuses. Plusieurs versets du chant à la gloire de la « femme de valeur » de Proverbes 31 évoquent le commerce, la finance, l’artisanat, etc. : « Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ; du fruit de son travail elle plante une vigne. Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ; sa lampe ne s’éteint point pendant la nuit. Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures au marchand. » (Pr 31.16,18,24) Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire (Act 16.14), avait sans doute un métier prestigieux, un peu comparable à celui d’un grand couturier aujourd’hui. Priscilla et son mari Aquilas travaillaient ensemble pour faire des tentes (Act 18.1-4).
Certaines peuvent concilier travail et famille, avec des formules à mi-temps par exemple. Chacune est appelée à agir « selon sa force » (Ecc 9.10). Respectons profondément celles qui ont fait le choix, aujourd’hui souvent méprisé, de rester à la maison à plein temps – ce qui est parfois plus fatigant qu’une activité externe !
En résumé, selon la Bible, il est absurde d’interdire aux femmes de travailler. S’il est possible de concilier un travail rémunéré avec le travail domestique (dont le mari n’est pas exclu, loin s’en faut…), il y a toute liberté.
7. Le chrétien peut-il se mettre en grève ?
L’Écriture demande clairement aux « serviteurs » (aux salariés, dirait-on aujourd’hui) de se soumettre à leurs « maîtres » (leurs supérieurs) – et cela que ces derniers soient « bons et doux » ou qu’ils aient « un caractère difficile » (1 Pi 2.18). L’obéissance à l’autorité hiérarchique est un principe biblique général que tout chrétien est tenu de respecter. Néanmoins, la Bible condamne tout aussi fermement l’oppression des pauvres : Jacques rejoint la voix de prophètes comme Amos lorsqu’il dénonce vertement le comportement des riches qui frustrent les ouvriers d’un salaire digne (Jac 5.1-6). Si un croyant peut supporter paisiblement une injustice qui le touche personnellement, il peut aussi apporter une critique justifiée face à un comportement patronal inéquitable qui porte atteinte à son prochain ou à toute une catégorie sociale.
Dans les pays où le droit de grève est reconnu par la législation, lorsque la négociation n’a pas pu aboutir, on peut donc concevoir que le chrétien puisse user de ce droit comme un moyen de « dire la justice » (cf. Ps 40.9). Le danger est alors de glisser vers la défense d’intérêts matériels ou catégoriels, ou bien d’être entraîné dans des mouvements dont les fondements peuvent être diamétralement opposés à l’Évangile. Il est donc impossible d’édicter une règle de conduite générale et uniforme et il convient à chacun de se laisser diriger par l’Esprit pour vivre et montrer l’équilibre toujours délicat entre une soumission dans la douceur (Phil 4.5) et une dénonciation courageuse du mal.
Conclusion
Dieu veut nous bénir dans toute notre vie, en particulier dans notre travail qui en occupe une large partie. Nous pouvons le recevoir comme un cadeau de sa part, nous pouvons le faire comme si nous le faisions directement pour le Seigneur, il peut nous procurer de la joie au travers même de sa pénibilité à laquelle nous n’échappons pas, nous pouvons y trouver de nombreuses occasions de témoignage… Que ce rapide survol nous conduise à remercier le Créateur pour le don du travail !
Articles par sujet
abonnez vous ...
Recevez chaque trimestre l’édition imprimée de Promesses, revue de réflexion biblique trimestrielle qui paraît depuis 1967.
