PROMESSES

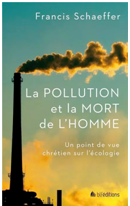
Pourquoi parler d’un livre sur l’écologie, édité pour la première fois en 1971 et réédité fin 2015, au moment où la COP 21 se déroulait à Paris, en France ?
Ce sont les éditions BLF qui ont réédité1 La pollution et la mort de l’homme : un point de vue chrétien sur l’écologie, de Francis Schaeffer, philosophe et théologien évangélique (1912-1984). Leur directeur s’en explique : « Nous apprécions beaucoup l’auteur et le sujet abordé était on ne peut plus actuel. C’est pour cela qu’on l’a pris dans notre catalogue à la veille de la COP21. Entre les climato sceptiques et ceux qui ont une vision très humaniste de la création, il nous semblait pertinent de porter une voix évangélique qui présente une vision biblique de la création. Elle se résume très bien dans la citation de Francis Schaeffer : “Nier la valeur de la création revient à insulter le Créateur.” »
Écrit au moment des premières prises de conscience sur les enjeux écologiques2, La Pollution et la mort de l’homme reste toujours aussi actuel sur un sujet qui n’a jamais cessé de l’être (plus de 40 ans plus tard, les premières alertes se sont malheureusement avérées !), et le relire aujourd’hui se justifie pour ses multiples intérêts : historique, sociologique, philosophique et théologique. Il est également révélateur de l’intérêt des protestants évangéliques aux questions environnementales, et ce, depuis quarante ans, contrairement à ce qu’une vision caricaturale pourrait laisser entendre.
Le titre est explicite : il s’agit d’une question de vie ou de mort ! Car, prévient Francis Schaeffer, « si l’homme est incapable de résoudre ses problèmes écologiques, ses ressources vont disparaître » et même « il n’aura plus tout l’oxygène nécessaire à sa respiration si l’équilibre des océans est trop dérangé » (p. 11).
Or, tout le monde (ou presque) s’en moque : Francis Schaeffer rappelle avec pertinence qu’ « à l’approche de sa mort, Darwin reconnut à plusieurs reprises dans ses écrits que deux choses auraient perdu de leur intérêt à mesure qu’il vieillissait : les plaisirs de l’art et de la nature ». Et Francis Schaeffer déclare être convaincu « que ce qui affecte aujourd’hui toute notre culture n’est rien d’autre que ce que Darwin avait vécu en son temps » (p. 10)3. Les protestants évangéliques, pourtant « attachés à la saine doctrine », ne montrent pas « le bon exemple aux incroyants » en ne se préoccupant pas de nature et de culture.
Dans le même ordre d’idée, Francis Schaeffer soulève, pour mieux la réfuter, une erreur d’interprétation relative au mandat créationnel de l’homme, commise depuis l’universitaire Lynn White en 1967. Le commandement donné par Dieu à l’homme en Genèse 1 de « dominer » signifie-t-il « permis d’exploiter sans mesure » des ressources susceptibles d’être « infinies » ? Le christianisme serait-il responsable de la pollution et de la crise écologique ? S’appuyant sur les Écritures, Francis Schaeffer répond « non » : au contraire même, la foi chrétienne bibliquement fondée, bien comprise et vécue avec authenticité, conduit à garder (protéger) la terre et non à la détruire.
Cette vision juste, bonne et sage de la création reste le meilleur antidote, selon Schaeffer, aux impasses d’autres philosophies et visions du monde non bibliques de la nature ; ces visions ne sauraient être de meilleures solutions pour résoudre les problèmes écologiques. Pas plus qu’un pseudo-christianisme médiocre, désincarné et déconnecté des réalités ne saurait être une vision fidèle à la pensée biblique sur la création.
À l’inverse, selon Francis Schaeffer, « individuellement et collectivement », les chrétiens devraient être de ceux qui s’appliquent dans leur vie pratique à être, par la grâce de Dieu, un facteur de rédemption, de guérison et de réconciliation « entre Dieu et l’homme, entre l’homme et lui-même, entre l’homme et son prochain, entre l’homme et la nature et au sein de la nature elle-même » (p. 77-78). Le chrétien qui connaît et aime le Dieu qui est amour et créateur, est censé agir avec amour, intégrité et respect envers ce que Dieu a créé.
Et à l’heure où le principe de précaution est sans cesse remis en question, quand il n’est pas dénigré4, sous prétexte qu’il serait « un frein à l’innovation », le plaidoyer de Francis Schaeffer prend tout son sens et toute sa pertinence pour notre génération : le chrétien devrait être celui qui accepte de s’autolimiter, c’est-à-dire de « ne pas faire tout ce qu’il peut », pour en tirer un maximum de bénéfices. En toute cohérence, il saura dire « non » ou « stop » à tout abus de la terre, si pure, si belle, comme à toute tentative de traiter un homme « en objet de consommation, destiné à rapporter le plus de bénéfices possibles » (p. 83-85).
Son devoir sera « de refuser aux hommes le droit de violer notre terre », comme il leur est refusé « de violer nos femmes » (p. 80). Loin de toute crainte de perdre, ce choix éthique, inspiré par une vision biblique, permettra au contraire à l’homme de recevoir « bien plus que cela », sur le long terme et de façon durable : l’amour et des relations authentiques, libératrices et porteuses de sens.
En conclusion, j’ai trouvé ce livre stimulant, fluide et facile à lire, quoique parfois répétitif. Mais cela reste un « défaut » mineur. Ceci dit, il me paraît tout à fait recommandable pour qui souhaite, avec « un cœur honnête (loyal) et bon » (Luc 8.15), examiner les bonnes raisons bibliques de se sentir concerné par l’écologie. D’autant plus que l’écologie, c’est la « bonne gestion » responsable et respectueuse de « notre maison commune », non pour notre seul intérêt mais aussi pour le bien des autres, avec le souci de « servir » la terre comme nous servirions ou rendrions un culte à notre
La version anglaise fut publiée en 1971 et traduite en français en 1974 : Francis Schaeffer, La pollution et la mort de l’homme, Guebwiller, LLB, 1974. Réédition BLF, 2015.
- Nous pouvons dater le premier avertissement de la crise écologique, et peut-être le premier déclencheur du mouvement environnemental, en 1962, année marquée par la sortie du livre de la biologiste Rachel Carson, Le Printemps silencieux. C’est à ce moment que sont nés les mouvements comme « les Verts » et que s’est développée une conscience écologique.
- Bien avant lui, Hannah Arendt faisait ce même rapprochement troublant entre la nature et la culture : le mot « culture », d’origine romaine, vient de « cultiver », « demeurer », « prendre soin », « entretenir », « préserver », dans le sens « de culture et d’entretien de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine » (La crise de la culture, Folio essais, 2014, p. 271). Mais alors que « les Romains tendaient à considérer l’art comme une espèce d’agriculture, de culture de la nature, les Grecs tendaient à considérer même l’agriculture comme un élément de fabrication, comme appartenant aux artifices techniques ingénieux et adroits, par lesquels l’homme, plus effrayant que tout ce qui est, domestique et domine la nature ». Les Grecs comprenaient l’activité de labourer la terre-« ce que nous considérons comme la plus naturelle et la plus paisible des activités humaines »-comme « une entreprise audacieuse, violente dans laquelle, année après année, la terre, inépuisable et infatigable, est dérangée et violée. Les Grecs ne savaient pas ce qu’est la culture parce qu’ils ne cultivaient pas la nature mais plutôt arrachaient aux entrailles de la terre les fruits que les dieux avaient caché aux hommes » (op. cit., p. 272-273).
- Le principe de précaution a été intégré dans la Constitution française en 2005, par Jacques Chirac alors que la droite était majoritaire au Parlement. Il y a bientôt vingt ans, le Conseil d’État s’appuyait sur le principe de précaution pour empêcher la culture de maïs transgénique en France. Depuis, le principe de précaution est invoqué pour tenter de freiner la banalisation de produits toxiques, des pesticides aux perturbateurs endocriniens, en passant par les nanoparticules.
Cet article est un large extrait du ch. 3 du livre de Francis Schaeffer, La mort dans la cité, écrit il y a 47 ans. Consacré au livre de Jérémie, l’ouvrage reste toujours actuel par la pertinence de ses propos. Il est disponible à La Maison de la Bible en format papier ou électronique.
Jérémie s’est adressé à une génération très semblable à la nôtre. On a appelé Jérémie « le prophète qui pleure », car il se lamentait sur son peuple. Nous aussi devons pleurer sur l’Église à cause de son abandon de Dieu, et sur l’ensemble de notre culture, qui a suivi dans ce sillage.
Son message, dont Jérémie 1.10 nous donne les grandes lignes, n’était pas facile à délivrer : « Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Notez l’ordre dans lequel ces verbes se succèdent : les négatifs d’abord, les positifs ensuite. Cela correspond aux deux aspects du message, mais ce qui est négatif doit venir en premier lieu et être vigoureusement proclamé. Juda s’était révolté contre Dieu et la vérité révélée, et cette révolte marquait toute la vie de la nation ; le message confié à Jérémie devait être avant tout un message de jugement. Il est impérieux, je le crois, que nous fassions entendre cette note-là aujourd’hui. Le christianisme n’est ni romantique, ni veule, mais au contraire réaliste et rude. Aussi la Bible nous transmet-elle le message de Jérémie dans tout son réalisme, et il incombe à l’Église de prêcher ce même message aujourd’hui si elle veut être de quelque utilité à notre génération. Ne nous étonnons pas des réactions ! La Bible ne nous laisse aucune illusion : ce message ne saurait être bien accueilli par une chrétienté et une culture en révolte. Ecoutez plutôt : « Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d’airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel » (1.18-19). Voilà les difficultés qui attendaient Jérémie dans son ministère. Aussi le chrétien qui rêve d’un ministère facile dans une culture où le christianisme est minoritaire manque-t-il totalement de réalisme. La tâche ne pouvait pas être facile au temps de Jérémie, et il n’y a aucune chance qu’elle soit plus aisée pour nous aujourd’hui.
La multiplication des formes de piété et des activités religieuses ne signifie rien pour Dieu et n’éloigne pas son jugement. La nouvelle théologie, et parfois, hélas, les compromis de certains secteurs de la chrétienté dite évangélique, dépouillent le culte de l’élément même qui le rendait agréable à Dieu. Nous avons vu dans les Lamentations que les Juifs s’étaient détournés de la vérité révélée ; or, précisément, Dieu ne peut pas accepter l’adoration d’hommes qui ont rejeté sa révélation propositionnelle. En parlant ainsi, nous ne jonglons pas avec des notions théologiques abstraites, nous traitons le problème concret de la foi en Dieu et en la vérité révélée.
Mais, à travers le message de Jérémie, Dieu veut encore nous apprendre autre chose. En effet, le prophète ne se contente pas de flétrir la piété formaliste, mais il se lance dans une dénonciation formelle de l’apostasie de son temps. Remarquez, à ce propos, que l’Église, depuis quatre décennies, utilise de moins en moins ce terme ; cela est symptomatique de notre époque et démontre à quel point le relativisme propre au concept hégélien de la synthèse a envahi l’Église moderne. D’aucuns, il est vrai, emploient le mot apostasie d’une façon dure et déplaisante ; c’est sans doute regrettable. Cependant, selon la Parole de Dieu, l’apostasie existe bel et bien, et si nous ne qualifions pas ainsi le fait de se détourner de Dieu, nous sommes infidèles à sa Parole.
D’apostasie, Dieu nous en parle par la bouche de Jérémie, en termes extrêmement forts, sévères, parfois même choquants ! « Lorsqu’un homme répudie sa femme, qu’elle le quitte et devient « la femme d’un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ? Le pays même ne serait-il pas souillé ? Et toi, tu t’es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi ! dit l’Éternel. » (3.1) Dieu nous invite à revenir à lui, mais son invitation exige l’aveu de notre apostasie.
Jérémie ne se contente pas de réprouver l’apostasie religieuse, il condamne également certains péchés spécifiques, et c’est aussi ce que nous devons faire à notre époque. Dans Jérémie 5.7, nous lisons : « Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes enfants m’ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n’existent pas. » Il s’agit encore une fois de péché dans le domaine religieux ; mais remarquez maintenant avec quelle précision la fin du verset évoque les effets de notre société d’abondance : « J’ai reçu leurs serments, et ils se livrent à l’adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. » Leur prospérité les stimule au péché ; n’est-ce pas des plus actuel ? Pensons aux pièces de théâtre, aux romans, aux films, à la peinture et à la sculpture modernes : dans notre société d’abondance, le message de l’art est souvent un appel à la vie hédoniste.
Si, dans notre monde post-chrétien, l’Église ne condamne pas le péché, elle ne suit pas l’exemple de Jérémie et reste en deçà du message qu’il a proclamé de la part de Dieu : condamnation d’une religion purement formaliste, condamnation de l’apostasie, condamnation des péchés sexuels, et, enfin, condamnation du mensonge, car le prophète s’y attaque aussi : « Oh ! Si j’avais au désert une cabane de voyageurs, j’abandonnerais mon peuple, je m’en éloignerais ! Car ce sont tous des adultères, c’est une troupe de perfides … Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité ; ils exercent leur langue à mentir, ils s’étudient à faire le mal. » (9.2,5) Il ressort de ce passage que Dieu attache un grand prix à la véracité. Mais aujourd’hui, où l’on ne croit plus en aucun absolu, il est de plus en plus courant de ne pas dire la vérité, et la tromperie a droit de cité. En affaires, on essaie souvent, dans les limites légales, de ne pas honorer un contrat. Les employeurs ne tiennent pas leurs promesses et les employés le leur rendent bien. De par leur abandon de Dieu, seul fondement sur lequel on puisse établir des absolus en ce qui concerne la vérité et le mensonge, les hommes sont devenus perfides et hypocrites.
Les hommes agissent en général par la force de la tradition et de l’habitude, et non en fonction d’une base chrétienne solide et rationnelle, ce qui est fort laid. Cette écœurante hypocrisie est si patente dans la culture et dans l’Eglise, que les chrétiens auraient dû la dénoncer il y a des années déjà, sans attendre que la présente génération nous la jette au visage. Rappelons-nous que les vertus les plus belles perdent leur éclat si elles cessent d’émaner de la source qui les avait produites.
Jérémie s’en prend également à ceux qui cherchent de l’aide auprès du monde au lieu de s’adresser à Dieu. Ce péché revêtait de son temps une forme bien définie ; les Juifs regardaient du côté de l’Égypte et d’autres grandes nations pour recevoir du secours contre Babylone.
Dieu nous avertit qu’à vouloir chercher de l’aide auprès du monde, nous allons au-devant de pénibles humiliations et d’un échec certain. A notre époque de relativisme, où la nouvelle théologie rabaisse la religion au rang de la psychologie, l’Église doit donner la démonstration de la réalité de sa foi en l’existence de Dieu. Il nous « faut chercher l’aide directement auprès de Dieu, et ainsi nous « accomplirons l’œuvre du Seigneur selon la méthode du Seigneur », comme avait coutume de le dire Hudson Taylor (fondateur de la Mission à l’Intérieur de la Chine).
Pour conclure, quelle était la teneur du message de Jérémie ? S’agissait-il d’un message facile ? Certainement pas, car voici ce qu’il devait dire aux Juifs de son temps : « Vous marchez vers un anéantissement total parce que vous avez tourné le dos à Dieu et refusé de vous repentir. Dieu, qui intervient dans l’histoire, va détruire complètement votre culture. » C’est ainsi que nous lisons : « L’Éternel me dit : C’est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » (1.14) Et encore : « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d’Israël, dit l’Éternel ; c’est une nation forte, c’est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. » (5.15) Leur culture est menacée de destruction totale ; cette prophétie se répète tout au long du livre de Jérémie.
Voici ce que Dieu veut dire par là à notre génération : « Ô peuples, ô culture, pensez-vous que la connaissance que vous détenez aujourd’hui — inadéquate puisqu’elle ne tient pas compte de l’ensemble du réel (où le surnaturel voisine avec le naturel, et où tout ne saurait s’expliquer par le seul jeu des forces horizontales), pensez-vous donc que cette connaissance vous permettra de forger les instruments de votre délivrance ? Sachez-le, tout cela va se retourner contre vous, comme une épée dans la main d’un homme épuisé. Vous vous fiez à votre technologie, toujours plus poussée, mais cette même technologie vous détruira. » Tant qu’il ne se trouvera personne pour prêcher courageusement ce message au monde d’aujourd’hui, l’Église ne sera pas prise au sérieux.
Il faut dire et redire à notre génération qu’on ne se moque pas de Dieu, qu’il jugera notre culture à cause de son rejet délibéré de l’extraordinaire lumière dont elle bénéficiait. Dieu est un Dieu de grâce, mais le revers de la grâce, c’est le jugement. Si Dieu existe, si sa sainteté n’est pas un vain mot (et sans un Dieu saint, il n’y a pas d’absolus), le jugement fondra inexorablement sur le monde.
Pourquoi tant d’inconsistance et de superficialité chez les chrétiens évangéliques de tout âge ? C’est qu’ils passent à côté de la réalité suprême, de la réalité décisive, à savoir que Dieu existe de fait, qu’il est objectivement présent. La Bible est ce qu’elle est parce que Dieu, dans son existence objective, l’a donnée par le souffle de sa bouche, sous la forme de déclarations précises énoncées dans les termes et selon les règles du langage humain.
En dernière analyse, sur quoi notre christianisme est-il axé ? Sur quel pivot repose-t-il ? Serait-ce sur autre chose que sur la réalité même de Dieu ? Dans tout ce qui compose la trame de notre vie, quand nous étudions, quand nous enseignons, croyons-nous que Dieu est là, proche et présent ?
Croyons-nous vraiment à la réalité de son existence, ou nous contentons-nous de vivre avec une croyance propre à notre milieu social ? Si l’existence et la sainteté de Dieu sont effectives, comment concevoir qu’il reste insensible à l’apostasie du monde occidental ? À moins de lui annoncer le jugement de Dieu, nous ne pourrons prêcher avec efficacité à notre génération.
Ce qui va être dit concerne toutes les manifestations artistiques et même la vie chrétienne, qui peut et doit être elle-même une expression esthétique.
Tous les moyens d’expression artistique ajoutent quelque chose à ce qui serait la simple pro-déclaration didactique. Dans les Psaumes par exemple, la formulation poétique ajoute quelque chose à la déclaration doctrinale. Il faut cependant qu’il y ait continuité entre cette pro-déclaration et l’oeuvre elle-même. L’Art doit ajouter quelque chose à la communication; il est un complément à la parole, il doit en augmenter la puissance. Actuellement, avec l’Art moderne, nous avons perdu ce côté additionnel; il y a rupture entre le discours et l’oeuvre. Soit il n’y a plus que l’oeuvre (théorie de l’Art pour l’Art), soit il n’y a plus que le discours (l’art, intellectualisé, devient une déclaration philosophique). Or, les grands artistes du passé ont voulu, eux, créer une oeuvre qui ait une valeur esthétique en elle-même et qui démontre en même temps leur philosophie de la vie, leur vision du monde.
Nous devrions créer une oeuvre d’art d’abord parce que l’Art sert à quelque chose, dans le sens le plus large, le plus élevé, le plus profond du terme. Dieu a créé le monde et le monde parle de Dieu. Il est évident que Dieu s’intéresse à la beauté, et qu’il nous a créé de sorte que nous y soyons réceptifs. Cette beauté possède une valeur en elle-même et elle est un argument de l’existence de Dieu. Ainsi, en négligeant la dimension esthétique, l’artiste chrétien crée en fait des oeuvres contraires au message biblique, et des traités anti-évangéliques. La beauté participe de la personne de Dieu. Ce n’est pas parce qu’un chrétien exprime sa vision du monde qu’il va créer une oeuvre d’art. Trop souvent, les chrétiens oublient que l’oeuvre d’art a une valeur en elle-même; ils se soucient trop du message: c’est la raison pour laquelle c’est souvent mauvais. Ils se désintéressent de l’Art, pensant faire quelque chose seulement quand ils produisent un traité évangélique.
Je propose trois critères pour juger d’une oeuvre d’art:
1. L’excellence technique: par exemple, Salvador Dali. Une mauvaise qualité esthétique réduit le message, une bonne l’intensifie.
2. La «validité»: l’honnêteté du créateur envers son message et de l’artiste produisant une oeuvre d’art. Il faut éviter cet opportunisme artistique qui consiste à faire «ce qui plaît» plutôt que «ce qu l’on ressent», souvent dans un but de profit. D’autre part, cela implique une certaine cohérence message-oeuvre. Si Dali, par exemple, peignait comme Rembrandt, il serait malhonnête, car sa vision du monde est différente de celle de Rembrandt. Imiter un tel, c’est parfois profitable sur le plan technique, mais c’est souvent pire sur celui de la «validité». On doit peindre ce que l’on est, ce que l’on pense réellement.
3. Le message: ce n’est pas parce qu’il s’agit d’Art que le message est sacré. L’artiste, comme le scientifique, n’est pas hors de l’autorité de l’Ecriture. Ainsi, le message qu’il dispense doit être jugé par rapport à l’enseignement des Ecritures, indépendamment de la qualité esthétique qui l’accompagne. On doit rendre justice à l’artiste pour ce qui est de sa technique, de sa «validité» mais, pour ce qui est du message en tant que tel, l’Art ne le rend pas sacré. Si, comme il a été dit, le moyen d’expression artistique augmente la puissance du message, alors si un message destructeur est bellement exprimé, sa puissance destructrice en sera décuplée (comparaison poésie beatnick/poésie Zen). Une négation comme celle contenue dans la philosophie Zen artistiquement exprimée, c’est ce qui tue.
Les moyens d’expression artistique peuvent tout exprimer: la vérité, l’hérésie, la moralité, l’immoralité. Ils peuvent véhiculer tous les messages et tous dispensent des messages propositionnels, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Ils ne sont pas liés à un seul domaine, ils se caractérisent par leur neutralité.
Pour devenir un grand artiste chrétien, celui-ci devra porter son effort sur deux fronts:
– chercher comment créer la beauté, étudier, travailler.
– comprendre le message chrétien, l’étudier. Si celui-ci n’est pas compris, l’artiste peut créer de très belles images mais, le message étant incorrect, cette beauté ne conduira les gens qu’à des déviations.
Tout comme le langage, le style et les systèmes symboliques qui lui sont propres changent. Il faut se tenir au courant de ces changements. Quand nous faisons une peinture, il faut qu’elle s’adresse à notre culture, à notre siècle. Il nous faut utiliser le système symbolique contemporain. Ainsi, la relation de notre oeuvre avec le consensus environnant s’établira sur trois niveaux:
– l’époque
– le pays
– le système symbolique propre à la vision du monde, à la philosophie traduite dans l’oeuvre d’art.
Par exemple, pour un jeune japonais chrétien, son oeuvre devra comporter ces trois caractéristiques: elle devra appartenir au XXème siècle, être japonaise et être chrétienne. Ce point de vue ne se veut pas perfectionniste.
Les notions de thème majeur et de thème mineur:
a) Thème mineur: mineur parce que moins fort (ce n’est pas au sens musical). Dans le christianisme, le thème mineur est que les hommes sont perdus et vont en enfer. Ils sont morts à présent et, même dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas parfaits. Ce n’est pas un problème d’existence: la situation est telle à cause de la rébellion spatio-temporelle de l’homme. Le dilemme de l’homme – si présent dans la pensée contemporaine – n’est pas que l’homme soit petit, limité, mais qu’il soit sous l’effet de la chute. Ceci est présent dans l’Art, peut-être plus qu’ailleurs. Ce thème mineur ne vient pas de ce que l’homme intrinsèquement est, ni de ce qui existe de façon intrinsèque, mais du fait que l’homme est anormal à cause de cette chute spatio-temporelle. Cependant, Dieu, dans son amour, fournit la solution au dilemme par l’oeuvre rédemptrice de Christ.
b) Thème majeur: il y a un but à l’existence, parce que Dieu existe. C’est un dieu personnel. L’homme est créé à son image et, par conséquent, a un but, une signification à sa vie. Remarquez que le thème majeur de la vie chrétienne ne trouve pas son origine, n’est pas enraciné dans le salut; il a pour source le fait que Dieu existe et que l’homme est créé à son image. Le thème majeur se trouve premièrement dans ce qui est là et qui existe. C’est la pré-condition humaine.
Ces deux thèmes étant précisés, nous dirons que l’Art chrétien doit démontrer ces deux thèmes à la fois. Si il n’y a que le thème majeur, c’est romantique: ce n’est pas vrai par rapport à ce qui est et par rapport à ce que vous êtes. L’Art chrétien doit être un art réaliste! Il en est de même pour la conversation, pour la vie chrétienne. Si beaucoup se détournent de l’Art chrétien, c’est parce que celui-ci se veut toujours majeur, dans beaucoup de cas. Les gens regardent les vies de ceux qui le créent, et c’est évident que ce n’est pas vrai, que ça répugne…
A l’inverse, il ne faut pas donner constamment dans le thème mineur, du côté noir. Il faut veiller, lorsqu’on devient chrétien, à ne pas continuer à produire dans le noir de sa vie passée. Le thème majeur doit à présent apparaître, et dominer le thème mineur. Un chrétien ne devrait pas créer quoi que ce soit qui ne soit pas une aide à notre pauvre monde. L’art moderne ne donne quasiment que dans le thème mineur. L’artiste chrétien, lui, doit fonctionner selon l’amour et la vérité. Il doit dire la vérité sur l’homme, le monde et lui-même, mais il doit le dire avec amour, en créant un art véritable (non un traité chrétien). Il faut sauver ce monde et non le tuer par une production romantique, ou finissant sur le thème mineur. Il ne faut pas non plus se montrer trop intellectuel, ni trop doctrinaire. Si on ne remplit pas ces conditions, on n’est pas un artiste chrétien.
Pour celui qui écrit un sermon comme pour celui qui exécute une oeuvre d’art, le dilemme est qu’on ne peut donner le message en entier en une seule fois. Il ne faut pas prétendre à l’exhaustivité avec une seule oeuvre, un seul sermon. Si on le fait, d’une part c’est l’éparpillement, et d’autre part, on s’aperçoit que le sermon est toujours le même, ce qui fait qu’il est nul. Il faut avoir le courage de ne pas tout dire dans un sermon et en peinture, où on est encore plus limité. On distingue là une hiérarchie dans les possibilités du dire: roman – sermon – poésie – peinture, photo – gravure – musique. Il faut accepter cet état de chose, vivre avec le moyen d’expression artistique pour lequel Dieu a donné un vrai talent. Il faut nous astreindre à ne pas faire une oeuvre seulement dans le ton mineur, mais à la compléter par le thème majeur, pour que la vue d’ensemble, éclaire le but que nous nous proposons et le style qui est le nôtre. La plaquette sous un tableau permet de verbaliser toutefois, de traduire en paroles l’image, ajoutant un «deuxième oeil» à la perspective du message exprimé dans l’oeuvre d’art.
Ainsi, il faut donc, en créant une oeuvre, avoir à l’esprit l’ensemble que l’on veut créer, qui doit fournir aussi bien le thème majeur que le thème mineur, aussi bien l’amour que la vérité dans son dynamisme final. Le thème majeur doit présider à l’ensemble, dominant le thème mineur.
En introduction, je voudrais faire remarquer que les priorités dont je vais parler ne concernent pas la totalité de la vérité et de la vie chrétiennes. Pour le faire, il faudrait certainement inclure les priorités suivantes: la pureté doctrinale la nécessité de démontrer l’existence et le caractère du Dieu de sainteté et d’amour; la nécessité d’être fidèle en communiquant aux non-chrétiens une vérité se rapportant a toute la réalité ; l’obligation de ne pas faire, même ce qui nous paraît juste, par notre propre sagesse et notre propre énergie, ce que j’appellerai notre enthousiasme charnel, mais de regarder plutôt au Christ vivant afin qu’il puisse porter son fruité travers nous moment par moment ; la nécessité d’une vie de prière vivante ; pour terminer, il faut nous souvenir que la fin de toutes ces choses est notre amour du Seigneur, la nécessité de l’aimer de tout notre coeur, de toute notre âme et de toute notre pensée.
Que sont donc alors ces priorités pour 1982 ? Je voudrais mettre l’accent sur ce qu’il nous faut faire, si nous voulons rester fidèles au Christ en tant que Seigneur de tous les domaines de nos vies. Quelles sont les priorités qui doivent être respectées si nous voulons être la lumière et le sel de notre culture en assumant nos responsabilités civiques au milieu des réalités quotidiennes des années quatre-vingts ?
Nous avons en Suisse un voisin qui, lui, a une grande priorité: la haie qui sépare nos propriétés ne doit pas dépasser la hauteur fixée par la loi. En Suisse, une haie marquant la limite entre deux propriétés ne doit pas dépasser une certaine hauteur. C’est la priorité que cet homme s’est fixée. On peut le voir examinant attentivement notre haie en estimant la hauteur. Si elle a le malheur de pousser quelques centimètres de trop, vous pouvez être certain qu’il viendra vous dire: « Il vous faut trouver quelqu’un pour tailler cette haie. » L’horizon de ses priorités est bouché par cette haie. Il est parfaitement aveugle aux transformations de la culture suisse qui l’entoure.
La Suisse passe par de profonds bouleversements. Sa jeunesse n’a jamais vraiment connu les changements des années 1960 et 1970. Elle se trouve soudainement au milieu du monde. Les dix dernières années en Suisse ont provoqué des changements tout simplement inimaginables.
Prenons, par exemple, l’éducation sexuelle qui est donnée dans les écoles. Certains de nos petits-enfants vont à l’école en Suisse. Un professeur d’éducation sexuelle est venu de Lausanne donner ses cours dans l’école d’une de nos petites-filles dans la vallée. Il s’agit de cette éducation sexuelle moderne donnée dans un esprit parfaitement relativiste. Lors de la discussion, une des élèves demanda, en mentionnant le nom de ma petite-fille: « Nous avons, elle et moi, un désaccord profond. Ma copine dit qu’elle ne veut pas avoir de rapports sexuels tant qu’elle n’est pas mariée. Moi-même, j’en ai déjà eu de nombreux par pure curiosité. Qui des deux a raison ? » Et le professeur de répondre: « Vous avez toutes deux également tort, parce que, d’une part il ne faudrait pas faire de telles choses simplement par curiosité et, d’autre part, vous aurez toutes un certain nombre de rapports sexuels avant le mariage. »
Une réponse si relativiste ne peut que profondément me choquer, car je sais ce qu’était la Suisse il y a encore vingt ans. La Suisse était ce qu on nomme en Europe archibourgeoise. Tout s’y faisait d’après des règles ; tout était très strict. Que l’on donne maintenant un tel enseignement dans les écoles du pays représente une révolution incroyable. Malgré tout cela, notre vieillard continue à scruter la hauteur de notre haie. Nous pouvons terriblement nous tromper sur nos priorités.
Pensons, par exemple, à ce qui s’est passé sur la si sérieuse Bahnhofstrasse de Zurich, l’une des rues les plus belles de Suisse, si chic et si correcte. De nombreux jeunes s’y sont promenés complètement nus. Ils y manifestaient pour réclamer un centre autonome d’où la police serait entièrement exclue et où ils pourraient en conséquence être absolument libres. Quand on voit de telles choses, on ne peut tout simplement pas imaginer ce qu’était la Suisse d’il y a dix ans. Mais notre voisin âgé garde ses yeux fixés sur sa haie. C’est là sa priorité.
Mais cela n’est pas tout. En traversant les magnifiques villes de Suisse, vous pouvez voir d’immenses A sur les murs des cathédrales ainsi que sur d’autres monuments anciens. A représente le mot autonome. Il s’agit en fait d’un mouvement véritablement anarchiste d’un type que nous ne connaissons guère aux Etats-Unis. La seule comparaison possible serait avec les paroles – je ne pense pas à la musique – du punk rock. Habituellement, on ne prête pas attention aux paroles de cette musique. Elles expriment une vision du monde entièrement dépourvue de sens, sans espoir, sans but. Les anarchistes en Suisse, en Allemagne, en Hollande, dans les pays scandinaves et ailleurs n’ont absolument aucun programme politique ni le moindre idéal social. Ce sont de purs anarchistes; pour se faire remarquer, ils peignent leurs immenses A d’une telle laideur sur les cathédrales et ailleurs. Et penser que ces gens-là vont déposer leurs bulletins de vote dans les urnes ces dix prochaines années. Mais notre vieillard regarde toujours pousser la haie.
Où se situent nos fausses priorités à nous, aujourd’hui 7 En voici un exemple. Serait-il judicieux que les chrétiens se battent devant les tribunaux pour avoir le droit d’enseigner, a côté d’une Terre déjà ancienne, l’hypothèse d’une terre relativement jeune qui serait l’oeuvre d’un créateur ? Je ne crois pas, car il s’agit d’une bataille dont l’enjeu est la liberté d’expression, qui, tout commandants le bloc soviétique, n’existe pas dans nos écoles américaines, où il est défendu par décret gouvernemental, même de proposer comme possibilité qu’il existe un créateur. Certes, la plupart de nos écoles ne sont pas – fort heureusement -marxistes. Cependant, nous n’avons pas la liberté d’enseigner que l’origine de l’univers soit dû à un Créateur plutôt qu’à une matière éternellement préexistante qui fonctipeutcontesterpeutcontesteronnerait selon les seules lois du hasard. Si l’on essaie à l’intérieur du système scolaire public d’exercer son droit à la liberté d’expression garanti expressément par la Constitution, en affirmant: « Non, l’ultime réalité n’est pas la seule matière, mais un Créateur vivant », on est passible de passer en tribunal. Il s’agit en fait d’une interdiction légale à enseigner un point de vue intellectuel autre que celui du matérialisme officiel. Remarquez qu’il ne s’agit pas ici d’une défense touchant à l’expression religieuse, mais d’une défense d’exprimer publiquement des positions intellectuelles contraires à l’orthodoxie matérialiste officielle. Aux chrétiens, je voudrais dire: la dégradation de la situation est bien plus avancée que la plupart d’entre eux ne l’imaginent. Introduire dans les procès en cours, que ce soit dans l’Arkansas, en Louisiane ou ailleurs, la controverse scientifique sur l’âge de la terre, manifeste une méconnaissance totale des priorités.
Ce n’est pas qu’un tel débat soit sans intérêt ou sans importance dans le contexte qui lui est propre. Mais introduire de telles considérations lorsque nous nous battons pour la liberté d’expression dans le système scolaire public, témoigne d’une méconnaissance radicale de l’enjeu véritable du combat actuel.
Suite à l’envahissement de nombreuses églises par une théologie libérale, le consensus humaniste a tout emporté et domine aujourd’hui de façon écrasante notre société tout entière. Le gouvernement de notre pays, le droit, les mass média et une très grande partie du système individuel de valeurs des citoyens, tous sont aujourd’hui presque entièrement imprégnés de relativisme moral. Dans une telle situation, on peut se poser la question: Quelles devraient être nos priorités pour les années quatre-vingts ?
Sans aucun doute, la prière est prioritaire. Il ne faut jamais la minimiser. Mais la sagesse est également nécessaire, et il nous faut la demander à Dieu. Ce que nous réclamons dans ces domaines, c’est cette liberté d’expression que la Constitution garantit à tout citoyen américain. Nous avons été privés de cette liberté d’une manière quasi totalitaire, tant dans les écoles publiques de notre pays que dans la plupart de nos médias, qui exercent une censure secrète à l’endroit de toute perspective chrétienne. Il est toujours plus difficile de surmonter une censure camouflée qu’une censure ouverte, parce que la dernière repose sur des règles juridiques que l’on peut àson àson àson àson contester. Il est presque impossible d’attaquer une censure cachée, Les chrétiens se trouvent devant une censure dissimulée presque totale sur les grandes chaînes de télévision et dans les autres médias. Cette censure cachée est absolument écrasante.
Ainsi donc les chrétiens doivent faire face, non seulement à une censure ouverte exercée par les tribunaux au sujet de leur liberté d’expression dans les écoles publiques, mais aussi à une censure cachée indirecte dans les médias. Nous devons continuellement garder à l’esprit que ce que nous voulons, c’est le droit à une vraie liberté d’expression. Disons-le sans ambages.
La toute première des priorités, sur laquelle je voudrais fortement insister, est la priorité de la vie humaine elle-même. Je mettrais cette question-là avant toutes les autres. C’est le problème crucial sur lequel les chrétiens doivent absolument prendre position.
Il nous faut comprendre que la vie humaine a un caractère tout à fait unique, parce qu’il existe un lien indissoluble entre l’existence d’un Dieu personnel et infini et la dignité unique et intrinsèque des hommes. Si Dieu n’existe pas et s’il n’a pas créé les hommes à son image, il n’y a aucun fondement pour l’affirmation d’une dignité unique et intrinsèque des hommes. Ni les Bouddhistes ni les Hindous ne la connaissent, et les Grecs ne la connaissaient pas non plus. Pour nous, le concept de la dignité de la vie humaine, concept qui conduit à une compassion réelle pour les hommes, va de soi. Il est enraciné dans notre héritage judéo-chrétien, dans le fait même qu’il existe un Dieu personnel et infini. Si ce Dieu personnel et infini n’existait pas, le fondement même de la dignité de toute vie humaine, la vôtre y comprise, disparaîtrait. L’attaque est ici dirigée dans deux directions à la fois, car si l’on détruit la dignité intrinsèque de l’homme, on détruit du même coup la croyance des hommes en l’existence d’un Dieu infini et personnel.
Par conséquent, la dévalorisation actuelle de la vie humaine est inacceptable par principe. Et si de telles questions de principe ne vous touchent pas, songez qu’en réalité c’est votre propre vie qui est dévaluée. Il ne s’agit pas seulement de la dévalorisation de l’enfant à naître, mais de celle de toute vie humaine. L’avortement ne devrait jamais être dissocié de cette dévalorisation générale de la vie humaine. L’histoire n’est jamais figée. D’abord, on accepte l’avortement. L’avortement à son tour conduit à l’infanticide. On en est très rapidement venu à laisser mourir de faim le nourrisson qui ne satisfait pas aux normes arbitrairement fixées de ce qu’est ou n’est pas une vie digne d’être vécue. En fait, pourquoi pas ? Si une mère peut supprimer la vie de son propre bébé, et cela uniquement en vue de son bonheur et de son confort personnel, malgré l’affirmation catégorique de la biologie qu’il s’agit d’un être entièrement humain, pourquoi ne le ferait-elle pas ? Aucun critère sépare logiquement l’avortement de l’infanticide.
Lorsque le Dr. C.E. Koop, Franky, mon fils, et moi-même avons commencé à travaillé sur le livre et le film « Whatever Happened to the Human Race? »*, nous disions que l’infanticide suivrait de très près la législation sur l’avortement. La plupart des gens pensaient certainement que nous exagérions. Mais des procès concernant l’infanticide sont maintenant dans nos tribunaux. Un tribunal a déclaré qu’il était parfaitement légal de laisser un bébé mourir de faim, si tel était le désir de ses parents. Le tribunal a décidé que si le fait d’avoir un enfant mongol ou souffrant du syndrome de Down (maladie guérissable par une opération relativement simple) était pénible pour ses parents, ils avaient le droit légal de laisser mourir leur enfant.
Ne comprenez vous donc pas ce qui est entrain de se passer? C’est la valeur même de la vie humaine, qui est remise en question, et non seulement la pratique de l’avortement, quelque puisse en être l’horreur. Mais ce n’est pas tout. On passe rapidement à l’étape suivante. On propose très sérieusement aujourd’hui d’avoir la liberté de faciliter l’élimination des vieux qui deviendraient une charge sociale, économique ou familiale. Si vous pensez qu’ici j’exagère à nouveau, observez ce qui se passe à présent en France, où le livre qui s’est le mieux vendu ces deux derniers mois avait pour titre: « Comment aider les gens à se suicider ». De même en Angleterre, où un groupe vient de publier un livre spécifiquement adressé aux personnes âgées leur indiquant la meilleure manière de se suicider. Il y a environ une année, je regardais à la télévision américaine l’émission populaire « 60 minutes ». Des deux sujets traités, l’un présentait un homme qui avait comme vocation de faciliter le suicide des personnes âgées. Selon l’habitude de ce programme qui s’incline devant la notion moderne d’une pluralité des valeurs, la vocation de cet homme a été présentée sans le moindre commentaire. Non, je n’exagère aucunement. Le fléau de l’euthanasie ne vous atteindra peut-être pas aussi rapidement que celui de l’infanticide, mais les événements se suivent avec une rapidité effrayante. Ne soyez donc pas stupidement aveugles! Il s’agit de votre vie à vous! Cela ne me touchera guère personnellement, vu que j’ai 70 ans. Mais si vous en avez 25, je peux vous assurer que si nous continuons à dévaluer la vie humaine à l’allure où nous le faisons, quand vous parviendrez à mon âge, votre situation sera dramatique. L’équilibre démographique aura été rompu, les personnes âgées deviendront toujours plus nombreuses. Vous serez alors un fardeau économique insupportable pour la partie active de la population. Vous serez broyé par cette machine inhumaine. Et je ne dis pas de telles choses pour jouer au prophète fanatiquement alarmiste. La rapidité avec laquelle nous sommes passés de l’avortement à l’infanticide prouve malheureusement trop bien que je ne me trompe pas.
Je termine en disant que si j’appartenais à un groupe minoritaire dans ce pays, je serais particulièrement anxieux. J’ai pu prendre connaissance de quelques chiffres instructifs. Faire avorter un bébé noir coûte $ 120 environ. Si on le laisse vivre, son éducation coûtera $ 20.000 à la société. Donc, faisons avorter l’enfant noir dans son ghetto. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Ne s’agit-il pas d’un phénomène du même ordre que la prétendue ‘solution finale » de Hitler ? Certains de mes amis noirs, comprenant des médecins et d’autres personnes compétentes, sont particulièrement préoccupés par ces problèmes. Une fois qu’on a enlevé l’obligation de protéger toute vie humaine, quelle qu’elle soit, il n’existe plus de raison pour que le processus s’arrête.
En accomplissant notre vocation prioritaire, qui est d’amener les hommes à Christ, nous ne devons jamais oublier que nous sommes également appelés à être le sel et la lumière de notre culture. Les hommes de notre génération – et personne ne le crDit plus que moi – sont perdus s’ils n’acceptent pas le Christ comme Messie. Non seulement ils sont perdus; ils sont brisés, ils sont blessés, ils sont envoie de perdre leur humanité ; ils se détruisent eux-mêmes, et tant de blessures leur arrachent des larmes et des gémissements. Ils n’ont pas la même notion de leur propre perdition, mais ils connaissent bien leurs propres blessures. Ils savent qu’ils sont une génération en quête de dignité humaine, et ils ne la trouvent pas.
Au milieu de cette culture et de cette société malheureuse en voie de décomposition, je voudrais insister avec la plus grande force possible que la première de toutes les priorités pour les chrétiens, qui sont le sel et la lumière de notre culture, est de défendre l’inviolabilité de la vie humaine par tous les moyens dont ils disposent, tant sur le plan publique que par les médias. C’est là notre première priorité. Et cette priorité, nous devons la tenir avec fermeté à toute épreuve.
Copyright Francis A. Schaeffer, 1982, « Priorities 1982 ». Extrait de deux discours donnés au mini-séminaire de l’Abri en i 982. (Permission de reproduction accordée d’avance>. Traduit et abrégé par J-M. Berthoud et J-P. Schneider.
F.A. Schaeffer et c. Everett Koop: « Whatever Happened to the Human Race? » (Mais que se passe-t-il dans la race humaine?) Fleming H. Reveil lOld Trappan N.J.),1979
Cher Jean-Marc,
Je voudrais d’abord m’excuser de répondre si tardivement à votre lettre si pleine d’égards. Elle est arrivée juste après notre départ pour les Etats-Unis où Edith et moi-même avons donné une série de conférences.
J’ai lu votre lettre avec un grand intérêt et je suis très impressionné par votre argumentation. Il me semble que sur le fond nous sommes entièrement d’accord.
Dans le début sur le rôle précis joué par le christianisme dans la fondation des Etats-Unis, nous trouvons, en fait, trois éléments différents:
1) Il y a d’abord une fausse idée de ce qu’est la spiritualité. Cette erreur conduit les chrétiens à croire que tout intérêt pour le monde qui nous entoure et toute activité y relative, et cela plus particulièrement dans le domaine politique et civil, sont inévitablement suspects.
2) Plus inquiétante encore est l’apathie incroyable de la plupart des gens. Il ne faut surtout pas déranger les habitudes de nos concitoyens. Les chrétiens réagissent malheureusement de la même manière.
3) Et il existe une école d’historiens chrétiens qui défendent un point de vue peu équilibré.
La discussion actuelle implique plus spécialement ce troisième groupe. Ils sont cependant peu nombreux comparés à ceux qui ont été influencés par « A Christian Manifesto » ou d’autres écrits semblables et qui comprennent à quel point le Christ et les Ecritures ont influencé la culture, non seulement des Etats-Unis, mais de toute l’Europe du nord, ce qui inclut, bien sûr, la Suisse. Malheureusement, certains de ces derniers sont tombés dans une autre erreur. Ils ont, pour ainsi dire, baptisé toute l’histoire, et en particulier celle des pays protestants, du nom de chrétien. Ils ont en conséquence tendance à oublier que les fondateurs des Etats-Unis, par exemple, ou les chrétiens engagés dans les partis politiques en Angleterre au XIXe siècle n’ont pas toujours été ce qu’ils auraient dû être, pour la simple raison qu’ils n’étaient tout simplement pas des chrétiens. C’était le cas, par exemple, du déiste Jefferson. Mais il serait facile de démontrer que même un déiste comme Jefferson possédait une culture biblique que l’on trouve difficilement aujourd’hui.
Une autre faiblesse provenait du fait que ceux qui ont fondé les Etats-Unis avaient indubitablement une philosophie politique chrétienne beaucoup moins complète qu’un Abraham Kuyper (1). Ainsi, les historiens chrétiens de cette école ont tendance à comparer les théories politiques relativement peu élaborées des pères fondateurs des Etats-Unis à la pensée politique plus systématique d’Abraham Kuyper. En conséquence, ils réagissent très fortement, allant jusqu’à prétendre que dans la fondation des Etats-Unis toute influence chrétienne était absente. Lorsqu’on lit les écrits de ces historiens, on n’y trouve aucune indication de l’immense différence de fait entre les conséquences de la révolution américaine, qui partait d’un consensus chrétien général, et celle des Révolutions française ou russe, où l’influence de la pensée chrétienne était entièrement absente.
La gravité d’une telle position ne provient pas simplement d’une analyse théorique peu équilibrée, ce qui ne serait qu’un problème académique. Non, le résultat d’une telle attitude – tant aux Etats-Unis qu’en Europe, où de tels livres sont lus – est de diminuer l’immense différence entre la situation qui prévalait aux Etats-Unis et dans le nord de l’Europe il y a seulement quelques années, et la situation actuelle. Une telle attitude historique diminue l’énergie et le sens des responsabilités de ceux qui doivent affronter la situation que nous connaissons aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une simple discussion théorique, mais d’une attitude dont les effets sont pernicieux, d’autant plus que cette interprétation de l’histoire tend à renforcer les deux autres aspects du problème: d’une part, il y a ce faux piétisme qui considère tout ce qui n’est pas « spirituel » comme suspect d’autre part, cette a pathie épouvantable des non-chrétiens aussi bien que des chrétiens eux-mêmes. A la lumière de cette situation, j’étais très heureux de lire votre analyse, qu’il m’a semblé important de poursuivre.
Cette interprétation mène à des résultats destructeurs dans des domaines où autant vous que moi-même avons été conduits à appeler les chrétiens à assumer toutes leurs responsabilités devant le Seigneur vivant, et cela dans tous les aspects de la vie il s’agit particulièrement de s’opposer à la terrible désintégration culturelle que nous constatons aujourd’hui. Pour prendre un exemple, dans le dernier numéro de la revue « His » publiée par l’lnter-Varsity Fellowship (2) aux Etats-Unis, nous trouvons un article intitulé: « Qui a peur de l’humaniste sécularisé? » En voici la conclusion: « Il nous faut tout simplement vivre comme nous le devons, utilisant nos dons pour assumer nos responsabilités de citoyens et de consommateurs chrétiens. Si nous le faisons, ce croque-mitaine qu’est l’humaniste sécularisé disparaîtra peut-être de lui-même ». L’article traitait constamment l’humaniste sécularisé de croque-mitaine. Il est évident que c’est tout le contraire qu’il nous faut. Nous savons bien qu’un immense effort est nécessaire pour amener les chrétiens à faire quelque chose, et voici qu’on les encourage à suivre leur petit bonhomme de chemin, espérant que le croque-mitaine disparaîtra de lui-même. Ce qu’il nous faut, c’est voir s’il nous est possible d’amener les chrétiens d’aujourd’hui à agir sur la place publique ou si leur apathie permettra une décomposition encore plus grande de notre culture, notre société et des autorités qui nous gouvernent.
Comme vous le savez, je me suis plusieurs fois référé à Witherspoon (4) dans mon livre. Quiconque se donne la peine de lire ses sermons, en particulier les sermons devant le Congrès continental (5), se rendra compte sans peine que sa pensée politique était beaucoup moins élaborée que celle d’un Kuyper. Mais il est impossible de ne pas remarquer également l’immense culture chrétienne non seulement d’un Witherpoon lui-même, mais des hommes auxquels il s’adressait et avec lesquels il travaillait. Pour ceux qui connaissent la puissance de ‘Evangile et la façon dont fonctionne l’intelligence humaine, il serait bien naïf d’imaginer qu’une telle prédication n’ait point porté de fruits. Le fruit en est évident quand nous comparons l’esprit de la révolution américaine à celui des lumières du XVIIIe siècle français.
Il est instructif de relever en passant que malgré le fait que la Hollande d’Abraham Kuyper pouvait se prévaloir d’une pensée politique chrétienne beaucoup plus élaborée, elle se trouve aujourd’hui dans un bien pire état que les Etats-Unis. Il serait utile de se demander pourquoi.
Certains historiens, non contents d’avoir fait disparaître toute influence chrétienne de l’histoire des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et d’autres pays, vont jusqu’à prétendre que la Réformation elle-même n’était rien d’autre qu’une des manifestations de l’esprit de révolte de la Renaissance contre toute autorité. On entre alors non seulement en contradiction avec la vérité historique, mais on s’oppose aussi à la vérité que Dieu ressuscita pendant la Réformation, et aux conséquences de cette réforme pour nos pays d’Europe du nord.
A la page 12 de votre lettre, vous écrivez que le « thème principal de l’histoire de l’Occident depuis 250 ans est celui de l’érosion graduelle de cette base chrétienne de nos diverses sociétés. » C’est cette affirmation-là que nient ces hommes.
Me référant à la fin de votre lettre, je dirais que la pensée de Witherspoon n’était, en fait, pas vraiment rationaliste, bien que, comme je l’ai déjà dit, sa réflexion politique n’était certainement pas aussi clairement développée que celle de Kuyper.
Que je termine cette lettre en disant à quel point j’ai été touché par la fin de la votre. Je suis heureux que mes travaux aient pu vous être utiles. Nous devons prier les uns pour les autres au fur et à mesure que nous avançons dans le combat qui est devant nous. Je suis vraiment reconnaissant de l’aide que j’ai pu vous apporter.
Edith se joint à moi pour vous envoyer, à Rosemarie et à vous-même, nos salutations les plus chaleureuses.
Francis A. Schaeffer
1) Abraham Kuyper: théologien, philosophe et homme d’état hollandais (1837 – 1920).
2) Equivalent des G.B.U. (Groupes Bibliques Universitaires).
3) Université évangélique prés de Chicago.
4) John Witherspoon: président de ce qui est l’actuelle Princeton University (1723 – 1794).
5) Les Congrés continentaux furent les rassemblements des représentants des colonies américaines lors de la Guerre d’indépendance contre l’Angleterre.
Dernier entretien de Francis Schaeffer avec la journaliste du MOODY MONTHLY, Melinda Delahoyde
Qu’est-ce que vous appelez « la grande catastrophe évangélique » ? (1)
| Une section importante des évangéliques, au lieu d’employer la Bible pour juger l’esprit du monde d’aujourd’hui, s’y est tout simplement adaptée. L’esprit de notre époque réclame l’autonomie, c’est-à-dire la liberté des contraintes de toute loi, de tout absolu, même de la nature humaine. Dans un monde pareil, il n’existe plus le moindre absolu moral. Chacun fait et dit uniquement ce qui lui plaît. Lorsque les évangéliques s adaptent ainsi à cette façon de penser qui a son origine dans le siècle des lumières, ils finissent par tordre l’Ecriture afin de l’accorder aux vents changeants et mouvants de la culture ambiante, au lieu de juger celle-ci à partir des absolus que nous donne l’Ecriture. Quand les chrétiens cèdent à cet esprit du monde qui ne cherche que l’autonomie de l’homme et son droit à ne faire que ce qui lui est agréable, esprit qui rend purement subjective toute spiritualité, il est temps de leur dire: « Réveillez-vous! Vous avez été pénétrés par l’esprit du monde. Vous êtes devenus mondains. » La Bible elle-même a été assujettie à un compromis de ce genre. Nous trouvons un nombre considérable de professeurs évangéliques dans les facultés de théologie et dans les universités chrétiennes qui, en optant pour une méthodologie existentialiste, adaptent leur conception de la Bible à celle de la théologie ambiante. Il s’agit là tout simplement d’une néo-orthodoxie se donnant le nom d’évangélisme. |
Pouvez-vous nous donner d’autres exemples où les évangéliques avaient compromis la foi?
| Les évangéliques se sont compromis à tous les points cruciaux de la vie culturelle. Nous avons confondu le royaume de Dieu avec des programmes politiques à tendances socialistes. Les structures injustes de la société ou le système capitaliste rie sont pas la cause du mal qui prévaut dans notre monde. La transformation des structures économiques qui aboutit par exemple à l’établissement d’un genre nouveau de redistribution des biens, ne peut aucunement arrêter le mal. Cette fa on de penser n’est rien d’autre que du marxisme. Quand les évangéliques adoptent une telle interprétation de la vie sociale et économique, ils démontrent tout simplement qu’ils veulent s’adapter au monde. Un autre exemple se trouve dans le féminisme outrancier qui influence tant d’attitudes dans notre société. Dieu a créé l’homme et la femme pour être égaux en dignité, mais cette égalité tient compte des différences. Les deux sexes se complètent mutuellement. Mais aujourd’hui, bien des gens, y compris des évangéliques, cherchent à faire disparaître cette merveilleuse différence. Emportés par cet esprit d’accommodement, certains d’entre eux n’hésitent pas à tordre la Bible afin qu’elle puisse approuver par exemple le divorce par consentement mutuel, l’homosexualité et l’égalité totale des hommes et des femmes. L’avortement est l’exemple le plus frappant de cet accommodement. Nous, les évangéliques, avons eu de la peine à entrer dans la bataille contre l’avortement, soit parce que nous pensons qu’il ne faut pas légiférer sur des questions de morale, soit que nous considérons sincèrement que la vie humaine ne débute pas à la conception. Une vision quelconque du monde qui nous interdirait de promouvoir publiquement la moralité biblique s’est complètement fourvoyée en s’accommodant au mythe sécularisé de la neutralité. Sur la question de l’avortement:, personne ne peut rester neutre. Tout le monde légifère à partir de valeurs (2). Mais pour le chrétien, il n’existe qu’une seule position possible: la vie humaine commence à la conception. C’est ce que la Bible enseigne. Si nous ne défendons pas la vie des hommes dès avant leur naissance, nous nions de façon pratique la vérité de la Bible. |
Vous dites souvent que « la vérité conduit à la confrontation ». Qu’est-ce que cela signifie pour le chrétien qui croit à la Bible ?
| Il s’agit d’abord d’une question d’attitude. John Wesley employait une expression qui m’a été très utile. Quand les gens qui l’entouraient se mettaient à s’exciter sur un sujet ou un autre, il appelait cela « une excitation impie ». Lorsque je me trouve impliqué dans des questions controversées, je me demande d’abord: « Ton sentiment reflète-t-il uniquement ta loyauté à l’égard de Dieu et de l’Ecriture, ou t’es-tu laissé prendre par une excitation purement charnelle ? » Est-ce que je fais des chrétiens qui se trouvent dans l’autre camp mes adversaires, ou mon but est-il uniquement de voir la situation s’améliorer ? Tout en m’exprimant clairement et sans ambages, je dois rester assez courtois pour pouvoir inviter mes adversaires à prendre une tasse de thé chez moi afin de continuer la discussion. Mais, cela étant dit, il nous faut affirmer que là où se trouve la vérité son contraire est nécessairement une non-vérité, une erreur. On ne peut pas déclarer: « Je crois en la vérité de la Parole de Dieu », et puis prendre ses aises en laissant tout le monde croire tout ce qui lui plaît. Notre loyauté envers Dieu comporte davantage qu’une simple affirmation de nos croyances. Notre loyauté est envers le Christ et envers Dieu, dont l’existence ne fait aucun doute. Pratiquement, cela veut dire qu’il nous faut dénoncer tout enseignement contraire à la vérité. La vérité invite à la confrontation. Si nous n’avons pas compris qu’il nous faut dénoncer clairement, mais avec amour, ce que condamne la Bible sur le plan tant doctrinal que moral, pouvons-nous vraiment croire que nous aimons Dieu 7 Nous confessons notre foi et nous chantons avec enthousiasme à l’église, mais parfois je tremble en pensant à ce que l’on croit véritablement dans les milieux évangéliques. |
Les évangéliques peuvent être en désaccord sur bien des points, mais où donc se trouve l’essentiel ?
| Bien que toute vérité soit importante, tout n’est pas sur le même niveau dans la hiérarchie de la vérité. Les chrétiens qui croient à la Bible se situent à des points différents de ce spectre. Les choses qui ne nous paraissent pas essentielles se trouvent dans une zone intermédiaire grisâtre où nous constatons des désaccords. Afin de rester dans le domaine pratique, limitons cette question au travail spécifique des différentes dénominations. Allons-nous dans une église qui croit fermement à la Bible pour nous quereller sur nos différentes préoccupations dénominationnelles? Nous devons faire une distinction très nette entre les églises qui croient à la Bible et celles qui n’y croient pas. Croire à l’entière vérité de la Bible est une prise de position essentielle. Par contre, le mode du baptême ou la fréquence de la sainte cène sont des questions secondaires. Beaucoup d’excellentes églises diminuent sérieusement l’efficacité de leur travail en insistant trop sur des différences d’ordre spécifiquement dénominationnel. |
Quels conseils et quels encouragements pouvez-vous donner aux chrétiens qui veulent combattre pour la vérité de Dieu dans l’Eglise ?
| Ils doivent d’abord avoir une relation personnelle profonde avec le Christ. Il ne suffit pas de participer à quelques démonstrations publiques. Nous devons d’abord nous édifier mutuellement dans notre communion avec Dieu. Une relation profonde n’est jamais quelque chose de statique. On peut la voir grandir ou la laisser mourir. En deuxième lieu, ils doivent comprendre que ce que nous enseignons est vrai. Il ne s’agit pas simplement d’expériences religieuses personnelles. Il s agit de vérités objectives. Ce qui se passe dans notre pays avec l’avortement ainsi qu’avec d’autres décisions légales tout aussi arbitraires n’est pas seulement en désaccord avec la Bible, mais en opposition absolue. Nous devons comprendre quel est notre ennemi et quelle est la nature de notre vocation. Dieu nous a appelés à manifester son amour et sa sainteté. Nous devons demander à Christ de nous rendre capables chaque jour, avec l’aide de son Saint-Esprit, d’exprimer en pensée et en action l’existence et le caractère de ce Dieu-là, et cela en contraste radical avec l’esprit du monde qui nous environne. Nous n’avons pas à faire à des éléments épars d’un mal fragmentaire, mais à une vision monolithique du monde, vision qui est carrément opposée à tout ce qu’enseigne la Bible. C’est cette vue antibiblique du monde qui a provoqué la destruction complète de notre civilisation. Nous proclamons l’existence d’un tel Dieu non seulement par-ce qu’il est lui-même la vérité, mais également parce qu’en lui notre vocation d’êtres humains se réalise pleinement. Si Dieu existe et s’il nous a faits à son image, lorsque nous nous opposons à sa Parole, non seulement nous péchons, mais nous allons à l’encontre de notre bien suprême. L’objet de notre combat n’est pas simplement une vérité théologique abstraite ; nous luttons pour préserver notre humanité elle-même. Une fois que nous avons bien compris cela, nous pouvons aller de l’avant. Alors notre position peut être radicale, sans compromis. |
Dans cette bataille, les chrétiens peuvent-ils vraiment renverser le courant ?
| Seul Dieu le sait. Notre tâche n’est pas de savoir si nous allons gagner ou non; notre tâche est d’être fidèles. L’Eglise a traversé de nombreuses périodes où il semblait qu’elle était réduite quasiment à rien. Ceux qui étaient restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ et aux Ecritures ont travaillé petit à petit à faire sortir quelque chose de nouveau de cette situation. Nous devons faire confiance au Christ et au Saint-Esprit pour les résultats. Paul avait-il perdu la bataille lorsqu’il fut décapité? Les premiers chrétiens étaient-ils vaincus parce qu’ils moururent dans les arènes ? Les réformateurs avaient-ils tout perdu quand on les mettait à mort ? Loin de là! Notre tâche est d’être conséquents devant le Seigneur et de mettre notre confiance entièrement en lui. Je ne sais pas si cette nation est condamnée ou non. Je crois que nous sommes à présent sous le jugement de Dieu pour avoir ignoré la lumière qu’il nous a donnée. Si suffisamment de chrétiens résistent et sont fidèles, qui sait, peut-être verrons-nous non seulement l’Eglise revenir à la vérité, mais même la restauration de notre culture. Nous devons être prêts à payer le prix et n’être qu’une minorité. Je ne sais pas à quel moment de l’histoire nous nous trouvons. Mais au fond, l’important n’est pas là. La question essentielle n’est pas de savoir si l’Eglise d’aujourd’hui sera sauvée ou si elle s’est déjà trop avancée dans la voie des compromis. Mais dans un cas comme dans l’autre, notre tâche reste exactement la même. Il nous faut aimer le Seigneur Jésus, aimer les Ecritures, nous attendre au Saint-Esprit pour accomplir son oeuvre dans nos vies; et ensuite aller de l’avant. Je crois, par la foi et en espérance, que nous avons une possibilité très réelle de victoire. |
Vous avez un amour profond pour la vérité de Dieu et pour sa Parole. Pourriez-vous nous parler un peu de vos expériences à cet égard ?
| Je n’aime pas ce livre parce qu’il a une belle reliure en cuir et que sa tranche est dorée! Je ne l’aime pas non plus parce que ce serait un « livre saint ». Je l’aime parce que c’est le livre de Dieu. Par ce livre, le créateur de l’univers nous a fait savoir qui il est, comment nous pouvons venir à lui par Jésus-Christ, qui nous sommes réellement et de quoi est faite la réalité. Sans la Bible, nous ne connaîtrions rien de tout cela. Cela peut vous paraître un peu sentimental, mais souvent quand je prends rua Bible le matin, je passe une main sur la couverture avec affection. Je suis tellement reconnaissant de l’avoir. Si le Dieu qui est là avait créé l’univers et n’avait ensuite pas parlé, nous ne saurions même pas qui il est. Mais la Bible nous révèle le Dieu qui existe, et c’est pour cela que j’aime ce livre. Je n’aime pas la Bible en tant que simple livre. Je l’aime à cause de son contenu et à cause de celui qui nous a donné ce contenu. D’année en année, je ressens cela plus fortement, tant affectivement qu’intellectuellement. |
En réfléchissant à ces cinquantes années passées au service de l’Eglise, quelles paroles voudriez-vous, en conclusion, adresser aux évangéliques ?
| J’ai observé le monde évangélique croître de plus en plus. Etant finalement devenue une Eglise bien établie, les évangéliques, au lieu de combattre le mal, se sont adaptés à l’esprit du monde dans presque tous les domaines. Si aujourd’hui nous ne rétablissons pas, avec amour, les distinctions nécessaires, nous ne le ferons jamais. J’en suis absolument convaincu. A ses débuts, l’Université de Harvard croyait si fermement au baptême des petits enfants qu’un de ses premiers présidents fut démis de ses fonctions parce qu’il n’acceptait pas cette doctrine. Nous nous demandons aujourd’hui: « Etait-ce là une cause valable de séparation ? » Cependant, Harvard était certes attachée de manière plus consciente à l’Evangile à ses débuts que ne le sont aujourd’hui la plupart de nos facultés évangéliques. Ce qu’il nous faut, c’est une séparation des voies. Certains ne suivront pas, mais d’autres doivent absolument parler clair et haut. Les divisions nécessaires que nous devons vivre aujourd’hui sont aussi importantes que celles du passé. Je me souviens très clairement de la cassure de l’Eglise presbytérienne dans les années trente. L’excommunication du Dr. Gresham Machen par l’Eglise presbytérienne des Etats-Unis pour son opposition au libéralisme théologique fut peut-être l’événement historique le plus marquant de la première moitié de ce siècle. Cela signifiait que cette église et d’autres à sa suite avaient cédé à l’esprit du libéralisme. Une barrière qui empêchait la désintégration de la société était tombée. L’Eglise évangélique se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Si on peut faire disparaître cette Eglise en induisant les évangéliques à dire exactement la même chose que le monde, à confondre le royaume de Dieu avec des programmes socialistes, à minimiser l’importance des questions qui concernent la vie ou tout simplement à se taire, je crois que la dernière barrière sociologique contre le mal aura disparu. Ce que nous affirmons ici est crucial pour la cause de Jésus-Christ, pour l’Eglise, pour la bataille qui doit se livrer dans la société. Si nous ne confrontons pas courageusement cet esprit de compromission, si nous ne rétablissons pas, avec amour, les distinctions essentielles dans les églises et dans les écoles, de nombreuses organisations évangéliques seront perdues pour la cause de Jésus-Christ. |
Traduit par J-M. Berthoud et J-P. Schneider et reproduit avec la permission du « Moody Monthly », juillet/août 1984.
(1)11 s’agit du titre du dernier ouvrage de Francis Schaeffer: « The Great Evangelical Disaster », qui n’a pas encore été traduit en français.
(2) Toute législation est inévitablement fondée sur des valeurs, morales ou immorales, peu importe! (Rédaction)
Articles par sujet
abonnez vous ...
Recevez chaque trimestre l’édition imprimée de Promesses, revue de réflexion biblique trimestrielle qui paraît depuis 1967.
