PROMESSES
Si vous demandez à un jeune occidental ce qui peut le détourner de la foi chrétienne, vous obtiendrez des réponses diverses. Certains avanceront l’incompatibilité entre la science et la foi ; d’autres se diront choqués par l’intolérance des chrétiens ; d’autres encore reprocheront aux chrétiens l’absence de cohérence entre leur doctrine et leur pratique 1 . Mais plusieurs évoqueront sans doute l’hostilité de certains chrétiens vis-à-vis de mouvements qui militent pour moins d’injustices, moins d’inégalités, moins de discriminations. Même s’il existe des associations chrétiennes à visée sociale, leurs membres ne semblent pas s’engager dans ces mouvements de lutte et s’y opposent parfois fermement en les affublant du terme de « wokisme », contribuant ainsi à leur rejet de la foi chrétienne.
L’impératif actuel d’être éveillé
Un bref historique
Le terme « woke » signifie « être éveillé ». Dès les années 1930, puis lors de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 1960 (dont Martin Luther King Jr fut un des fers de lance), ce mot désignait un « éveil » au fait qu’il existait des injustices raciales. Le terme s’est largement répandu dans les années 2010 au travers des réseaux sociaux et des cercles militants : « to stay woke » signifie rester vigilant face aux discriminations raciales et sociales. La mort de plusieurs jeunes Afro-américains dans cette période, qui a donné naissance au mouvement Black lives matter en 2013, a popularisé la notion. S’y est ensuite agrégée la lutte contre les abus sexuels portée par le mouvement #MeToo à partir de 2017. Sur un plan universitaire, les études sur la théorie critique de la race, sur le genre ou sur la condition féminine se sont rapidement développées, en partant des grandes universités des côtes est et ouest des États-Unis.
Dans le monde professionnel, nombre de grandes entreprises ont pris des mesures de discrimination positive en faveur des minorités qui les ont fait désigner comme du « capitalisme woke ».
Un mouvement multi-dimensionnel
Aujourd’hui, le wokisme se définit avant tout comme un ensemble de mouvements qui visent à lutter contre :
• les discriminations raciales,
• le colonialisme,
• le patriarcat et la domination masculine,
• les injustices économiques et sociales,
• l’homophobie,
• l’opposition à la théorie du genre.
Il est important de noter que le terme « wokisme » est récusé par les défenseurs de ces différents mouvements de lutte : selon eux, il est péjoratif et stigmatisant et il est employé à tout-va pour les discréditer. Au lieu de se dire woke, ils préfèrent utiliser les termes « éveillés » ou « conscientisés ».
Par respect pour cette sensibilité, nous préférerons donc utiliser le terme « éveillé ».
Un terme fréquemment utilisé dans les débats autour de ces sujets est « l’intersectionnalité » 2 : il désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs types de discriminations.
Par exemple, une femme à peau noire, pauvre et lesbienne.
Une autre expression liée est celle de « cancel culture » ou culture de l’effacement. Elle vise à dénoncer publiquement, pour les rejeter, les personnes, les groupes ou les institutions dont le comportement ou les paroles sont jugés offensants par des groupes discriminés. Cela conduit par exemple à débaptiser des rues portant le nom de personnages historiques ayant soutenu des causes jugées inadmissibles à l’aune des standards du XXI e siècle ou à déboulonner leurs statues.
De graves excès
Comme dans tout mouvement, des personnes ou des groupes « éveillés » sont allés loin, très loin, trop loin dans la dénonciation des injustices et des discriminations, au point parfois de sombrer dans le ridicule ou dans un dogmatisme totalitaire.
Pour certains, les mathématiques seraient racistes et sexistes car les grands mathématiciens étaient dans leur grande majorité des mâles blancs.
Pour des raisons comparables, on récuserait la biologie scientifique, voire la pure logique. Il serait impossible de parler sur le féminisme si l’on n’est pas une femme, sur la pauvreté si on ne l’a jamais connue, etc. Il faudrait changer le titre de livres écrits des décennies ou des siècles auparavant, voire en réécrire certains passages, etc. 3
Sur le genre, certains ne s’arrêtent pas à la dénonciation des discriminations, mais portent un discours normatif sur l’absence de détermination biologique qu’ils voudraient imposer à toute la société.
Des violences injustes qui perdurent
Ces outrances sont faciles à dénoncer — et à juste titre 4 . Il est aussi inquiétant de voir le sectarisme, voire l’intolérance absolue, de plusieurs leaders de ces mouvements 5 — tout comme celui de certains mouvements dits « anti-wokes ».
Cependant, les injustices qu’ils dénoncent ne sont hélas que trop réelles. Oui, le racisme perdure, même dans les pays qui prônent en théorie que tous les humains sont égaux. Oui, il y a des injustices économiques criantes entre les pays et dans un même pays entre nantis et démunis. Oui, beaucoup de femmes subissent des violences physiques ou psychologiques de la part des hommes. Oui, trop de gens s’autorisent encore des propos injustifiables sur des personnes à tendance homosexuelle.
Sans attendre l’émergence de ces groupes dits « éveillés », des hommes et des femmes se sont levés dans le passé avec courage et ont œuvré pour lutter contre ces pratiques. L’actualité médiatique remet aujourd’hui à juste titre au premier plan la dénonciation de ces violences, de ces injustices et des souffrances qu’elles engendrent.
Dieu est « éveillé »
Les points de contact existent entre la notion d’éveil au sens biblique du terme et sa version actuelle — même si des différences majeures demeurent.
Dieu s’intéresse particulièrement aux opprimés
Dans toute la Bible, notre Dieu est sensible aux injustices. Limitons-nous à quelques exemples tirés du début de l’Écriture :
• Dès la Genèse, Dieu au travers de l’Ange de l’Éternel, vient porter secours à Agar en fuite car elle était maltraitée par Saraï sa maîtresse.
• Le chapitre 38 du même livre souligne le machisme injustifiable de Juda.
• Au début de l’Exode, « l’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer » (Ex 3.7-8).
• Etc. !
Dans toute la Bible, notre Dieu est du côté des faibles, des opprimés, des victimes :
• Le Psaume 94 dénonce : « Ils égorgent la veuve et l’étranger, ils assassinent les orphelins. » (Ps 94.6) Et Dieu assure ailleurs qu’il en prendra soin personnellement (Jér 49.11).
• Les prophètes ne cessent de dénoncer les injustices sociales. Les réquisitoires d’Amos sont parmi les plus vigoureux pour stigmatiser des écarts de richesse honteux au sein du peuple d’Israël.
• Dieu s’occupe des victimes. Il va se substituer aux mauvais bergers d’Israël pour être le bon berger des brebis maltraitées de son peuple (Éz 34).
Et dans toute la Bible, Dieu approuve ceux qui sont sensibles aux injustices. À tous ceux qui ont « faim et soif de la justice », Jésus annonce dans la 4 e béatitude du Sermon sur la montagne qu’« ils seront rassasiés ».
Jésus est sensible aux injustices
Jésus, Dieu fait homme, prolonge et personnalise « l’éveil » (au vrai sens biblique !) que Dieu démontrait tout au long de l’Ancienne alliance :
• Ses paraboles valorisent des Samaritains discriminés.
• Le récit du riche et de Lazare est également une dénonciation de la dureté de cœur du premier (Luc 16.19-31).
Dans son ministère, Jésus est lui aussi du côté des faibles, des opprimés, des victimes :
• Son attitude vis-à-vis des femmes tranchait par rapport au machisme ambiant de l’époque. Il suffit de penser à son attitude vis-à-vis d’une femme stigmatisée, la Samaritaine 6.
• Veuves, étrangers, pauvres, sont les objets privilégiés de ses soins, de ses guérisons, de ses consolations.
L’Église n’a souvent pas été éveillée
Des dénonciations à écouter
Les personnes « éveillées » reprochent volontiers à l’Église comme institution d’avoir été plutôt du côté des oppresseurs que des opprimés, des dominants que des dominés.
Limitons-nous à quelques exemples historiques :
• les conversions violentes et forcées de l’expansion du christianisme constantinien à partir du IV e siècle,
• la colonisation des Amériques au XVI e siècle et la position officielle des dirigeants de l’Église pour mettre fin aux missions jésuites au Paraguay 7 ,
• l’étonnante bonne conscience d’industriels chrétiens richissimes face à leurs ouvriers miséreux dans l’Angleterre de la révolution industrielle,
• plus près de nous historiquement, la position officielle de l’Église catholique en Espagne ou en Amérique du sud en soutien à des dictatures,
• l’appui d’une large partie des Églises réformées d’Afrique du sud à l’apartheid,
• tout au long de l’histoire, la justification d’une emprise masculine indue dans le couple en tordant certains textes bibliques,
• etc. !
Les critiques qui nous sont adressées ne sont pas dénuées, hélas, de fondement… Alors qu’allons-nous faire ? Balayer ces heures sombres d’un revers de main ? Faisons plutôt face à notre histoire et reconnaissons que l’Église de Jésus-Christ a trop souvent porté honte à son Chef. Plutôt que d’ignorer ces critiques ou de les discréditer, entrons dans un processus de repentance (cf. Dan 9).
Des avancées indéniables…
Mais, me direz-vous, c’est aussi ignorer tout ce que le christianisme a apporté comme bienfaits et comme améliorations à la société pendant des siècles. Cela est vrai. Déjà, au cours des trois premiers siècles, l’expansion de l’Église est largement due à son souci particulier des personnes rejetées par la société antique, en droite ligne de l’enseignement du Maître 8 . Plus généralement, l’historien anglais Tom Holland a démontré l’impact des chrétiens dans une fresque historique remarquable 9 ; pour lui, « le christianisme est l’événement le plus transformateur de l’histoire de l’Occident. Aujourd’hui, même ceux qui abandonnent en nombre croissant la foi de leurs ancêtres et considèrent la religion comme pure superstition, en portent toujours la marque distinctive. »
Il suffit de citer la création des hôpitaux, la lutte contre l’esclavage, les prêtres ouvriers, les missions de réconciliation, etc.
… mais trop peu souvent à la hauteur du véritable évangile
En effet, pour un William Wilberforce qui a lutté jusqu’à sa mort pour abolir l’esclavage, combien d’esclavagistes « bons chrétiens » qui utilisaient la Bible des esclaves dûment expurgée des passages qui auraient pu conduire leurs esclaves à se rebeller 10 ? Pourquoi tant d’églises cultivent l’entre-soi, alors que l’Église rassemblera éternellement des gens de « toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue » ? Pourquoi tant de dirigeants d’églises, partout dans le monde, continuent à défendre mordicus un statu quo social, économique ou racial à rebours de l’enseignement de l’évangile ? Pourquoi encore tant d’attitudes de supériorité vis-à-vis de nos sœurs, alors qu’elles représentent souvent la majorité et sont les plus impliquées en pratique dans nos communautés ?
Le chrétien se doit d’être « éveillé »… de la bonne manière
Que faire face à ces constats ? Que répondre à ceux qui dénoncent l’apathie des chrétiens pour des causes qui leur tiennent à cœur ? Que le chrétien doit en effet être le premier « éveillé » — au vrai sens biblique du terme et non selon une idéologie d’ « éveil » souvent pernicieuse.
1. Remettons en évidence les nombreux textes bibliques qui vont dans le sens de la justice et de la critique des discriminations
Méditons Ésaïe 58, le prophète Amos, l’Épître de Jacques parmi tant d’autres textes.
2. Insistons sur l’apport unique de l’Évangile
• L’Évangile est universel : Il adresse le même message à tous : d’abord, il nous éveille au péché car « tous ont péché » et sont sous le coup de la juste condamnation de Dieu, les opprimés comme les oppresseurs ; ensuite, « quiconque » est invité, tous sont exactement au même niveau devant Dieu par l’œuvre de Christ (Gal 3.28). • L’Évangile est unificateur : La grande défaillance du « wokisme » est de diviser la société et de mettre les gens dans des cases. D’un côté, les dominés, de l’autre les dominants. Chaque groupe revendique en fonction de ses propres souffrances, quitte à rejeter l’autre ou à méconnaître ses souffrances à lui. Or dans l’Église, il ne devrait pas y avoir (et il n’y aura pas éternellement) la moindre discrimination.
• L’Évangile est restauratif : Non seulement il ouvre vers l’espérance de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre où la justice habite, mais il rétablit dès aujourd’hui chacune et chacun dans son statut de créature unique, porteuse de l’image de Dieu, admise à une relation d’enfant avec le Père.
3. Revoyons notre regard sur « l’autre »
L’altérité nous déstabilise souvent. Comment approcher cette personne d’un contexte social, ethnique, économique, etc. si différent du nôtre ?
Allons plus loin encore : les mouvements d’éveil font la part belle aux idéologies prônant la légitimité de la pratique homosexuelle ou la théorie du genre. Ces courants de pensée hérissent spontanément de nombreux chrétiens qui vont rejeter leurs défenseurs. Mais comment croyez-vous qu’un certain nombre d’homosexuels de Corinthe ont été convertis par Paul (cf. 1 Cor 6.11) ? A-t-il eu un discours stigmatisant, excluant, culpabilisant — ou bien s’est-il approché de ces personnes, en alliant douceur et compréhension avec vérité et non-compromission, pour leur apporter l’Évangile transformant de Jésus-Christ ? 11
4. Mettons en valeur l’approche chrétienne
• Basée sur le pardon et non la vengeance : Les « éveillés » se disent eux-mêmes « en guerre » pour faire triompher leurs idées 12 ; certains veulent tout détruire, y compris leurs oppresseurs. Jésus, qui a subi la plus grande violence, a pardonné à ses bourreaux et nous invite à faire de même. La vengeance ne fera que perpétuer le cycle funeste de l’injustice. Mais la force du pardon est la gloire du christianisme.
• Basée sur une ouverture au dialogue : Les mouvements d’éveil ont tendance à se replier sur eux par communauté, refusant le dialogue avec ceux qui ne subiraient pas les mêmes injustices ; les dominés refusent de parler aux dominants.
Au contraire, le chrétien sait avec une humble assurance que la vérité dont il est le témoin n’a rien à perdre d’une confrontation honnête.
• Basée sur la consolation de Dieu : Même si je n’ai jamais été pauvre, je peux parler à une personne pauvre de la consolation de Dieu (pas la mienne !) car « par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous pouvons consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction ! »(2 Cor 1.4)
5. Plaidons pour une église vraiment accueillante
Qu’elle soit particulièrement accueillante :
• Pour les femmes, trop confrontées à de multiples discriminations, pour qu’elles trouvent leur place, leur rôle, un accueil, une écoute, un soutien.
• Pour les minorités, souvent exclues du mouvement général, à cause du handicap, de la barrière linguistique, des habitudes différentes, .etc.
• Pour les personnes dans le besoin, avec un accueil non empreint de supériorité ou de paternalisme.
• Pour les personnes mal dans leur sexualité ou leur genre : c’est sans doute le plus sensible pour nous, car nous pensons immédiatement à des textes bibliques en opposition, mais cherchons à développer une approche pastorale délicate ; l’Évangile n’est-il pas la meilleure aide pour nous établir dans notre pleine identité de filles et fils de Dieu ? 13
6. Ne nous trompons pas de combat
Notre lutte devrait être avant tout contre les injustices (même s’il peut y avoir place pour une dénonciation étayée des idéologies contraires à la révélation de Dieu) 14 ! Bien sûr, nous savons que seul le retour de Jésus-Christ mettra un terme définitif à toutes les injustices, toutes les discriminations, toutes les dominations indues. Mais, sel et lumière du royaume qui vient, il nous revient d’œuvrer autant que nous le pouvons pour atténuer les tristes conséquences du péché. Ainsi nous ferons honneur à la doctrine que nous prônons (Tite 2.10 ; 3.8,14).
7. Mettons-nous toujours sur un chemin d’éveil personnel
Les auteurs de ces lignes, privilégiés sur bien des plans, sont sans doute mal placés pour percevoir la douleur des discriminations subies par beaucoup, diront certains. Notre prière est que Dieu ouvre dans notre cœur un chemin d’éveil personnel pour plus de compassion vis-à-vis des souffrants, davantage d’ouverture vis-à-vis de l’autre dans sa différence, plus de zèle pour orner l’évangile par nos attitudes.
- D’autres articles de ce numéro traitent de ces sujets.
- Il s’agit d’une notion complexe, parfois mal comprise, qui ne fait pas consensus parmi les spécialistes.
- Le changement du titre du célèbre roman d’Agatha Christie, Dix petits nègres en Ils étaient 10 , a défrayé la chronique.
- Voir Jean-François Braustein, La religion woke, Grasset, 2022.
- Voir Nathalie Heinich, Le wokisme serait-il un totalitarisme ?Albin Michel, 2023.
- Elle cumulait les sources de rejet dans la société juive de l’époque : femme, en concubinage, Samaritaine… (selon le vocabulaire woke, elle était « en situation d’intersectionnalité »).
- Voir le magnifique film de Roland Joffé, Mission(1986) sur ce sujet.
- Voir Rodney Stark, L’essor du christianisme, Excelsis, 2013.
- Tom Holland, Les chrétiens, comment ils ont changé le monde, Saint-Simon, 2019.
- Lire https://www.reformes.ch/religions/2018/11/la-bible-des-esclaves-une-legitimation-de-la-domination-esclavage-bible-etats
- Lire à ce sujet Marie-Noëlle Yoder, Quand genre, culture et foi s’entrechoquent, Éditions Mennonites, 2023.
- Écouter à ce propos les propos de François Cusset, dans le podcast Répliques, « Qu’est-ce que le wokisme ? », https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/qu-est-ce-que-le-wokisme-3619967
- Lire Rachel Gilson, « Sex: Telling a Better Story », in Before You Lose Your Faith: Deconstructing Doubt in the Church, sous dir. Ivan Mesa, The Gospel Coalition, 2021.
- Voir Tevin Wax, Is Wokeness the Greatest Threat to the Gospel?, https://www.thegospelcoalition.org/blogs/trevin-wax/is-wokeness-the-greatest-threat-to-the-gospel/
Le mémorial de Yad Vachem à Jérusalem garde le souvenir des hommes et des femmes qui, avec courage et au mépris de leur vie, ont porté assistance aux Juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils sont appelés des « Justes parmi les nations ». Ils sont l’illustration même de ce qu’on entend communément par une personne « juste » : quelqu’un reconnu comme ayant un comportement juste envers d’autres personnes. La justice s’entend entre humains et devant les humains, dans une dimension horizontale.
En revanche, pour nos contemporains, il semble que la justice devant Dieu soit passée aux oubliettes et que le sens de la redevabilité humaine devant le tribunal divin se soit évaporé.
L’Épître aux Romains traite à la fois de la dimension verticale de la relation de l’homme face à Dieu (la justification 15 ) — fondamentale — et de la dimension horizontale — très importante également. Plus encore, elle démontre comment la seconde est la conséquence logique et importante de la première. Parcourons quelques textes de cette lettre pour clarifier ces points.
Pourquoi la justification est-elle nécessaire ?
Parce que Dieu est juste
Il ne s’agit pas d’une pure affirmation théorique, maintes fois réitérée tout au long de l’Écriture. La justice intrinsèque du Dieu parfait, radiance d’un de ses attributs, se manifeste par des jugements dont personne ne pourra contester l’équité : « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu’il est écrit : “Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu’on te juge.” Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? (Je parle à la manière des hommes.) Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? » (3.4-6) Dieu est ainsi « trouvé juste » lorsqu’il est reconnu comme l’être suprêmement juste, en particulier dans chacune de ses actions (cf. Apoc 15.3 ; 19.2).
Parce que l’homme est injuste
En contraste avec le caractère parfaitement juste de Dieu, les êtres humains sont décrits par Paul comme « remplis de toute espèce d’injustice » (1.29). Affirmation d’autant plus frappante que l’homme, créé à l’image de Dieu, possède un sentiment inné de la justice : qui n’a pas entendu deux petits enfants se disputer et l’un dire à l’autre (ou à un adulte tiers) : « C’est pas juste ! » Mais, hélas, ce sens plus ou moins confus de la justice n’induit pas toujours un comportement juste et l’énumération qui suit (1.29-30) illustre de nombreuses facettes de l’injustice humaine.
Parce que la loi (de Moïse) le démontre
Dieu a donné à Moïse sa loi, sainte, juste et bonne (7.12), reflet de sa justice intrinsèque. « Ceux qui la mettent en pratique seront déclarés justes » (2.13, S21), dit Paul. Sauf que personne ne peut obéir à la loi en tout point ! L’affirmation reste théorique car si la loi permet de connaître la volonté de Dieu, elle ne donne pas le pouvoir de s’y conformer. La loi démontre donc à la fois la parfaite justice de Dieu et l’incapacité de l’homme, pire son péché, son injustice : « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. » (3.20)
Comment la justification est-elle accomplie ?
La justification est parfois illustrée par un tribunal où Dieu siégerait comme un juge devant qui l’homme comparaîtrait. L’image est biaisée, car le juge se doit d’être impartial et ne pas avoir d’intérêt dans l’affaire jugée, sinon il doit se déporter ou il peut être récusé.
Or Dieu est avant tout la partie lésée : c’est lui qui est offensé par l’injustice des humains (cf. Ps 51.6) ; avant d’être le juge, il est le procureur.
La justification par un Dieu juste d’un homme injuste condamné par la loi s’effectue par un double acte objectif et une appropriation subjective :
Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix
Tous ceux qui croient « sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. […] Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » (3.24,26) Le « sang » de Jésus seul peut justifier car le seul Juste a donné sa vie pour des injustes (1 Pi 3.18). Jésus, le Fils de Dieu, la partie offensée, a payé la culpabilité à notre place pour que nous soyons désormais en lui plus que justifiés — la démonstration même de la justice de Dieu (2 Cor 5.21) !
Par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts
« Jésus notre Seigneur a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » (4.24-25) L’injustice de l’homme entraîne sa condamnation qui aboutit à sa mort. Le triomphe de Jésus sur la mort par sa résurrection nous entraîne avec lui dans le domaine de la vie ; sa vie de ressuscité témoigne que nous vivrons avec lui parce nous avons été justifiés par lui.
Par la foi en l’œuvre accomplie de Jésus-Christ
Aux deux faits objectifs précédents, il est nécessaire d’en ajouter un troisième pour que la justification devienne mon partage personnel : la foi. « La justice de Dieu [est] par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » (3.22, S21) La foi est le moyen par lequel la justice de Dieu, « disponible » du fait de la mort et de la résurrection de Jésus, m’est personnellement imputée. Au moment de ma conversion, je change de statut devant Dieu et je deviens juste à ses yeux. J’étais impie et Dieu me déclare non seulement plus injuste mais positivement juste (4.5) !
Quelles sont les conséquences de la justification ?
Une déclaration
Tous ceux qui croient « sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (3.24). Insistons sur le « gratuitement » : Dieu nous donne sans contrepartie, sans mérite de notre part. Dieu donne de façon définitive : nous avons été déclarés justes (verbe au passé, 8.30). Aucune faute, aucune injustice que nous pouvons hélas encore commettre, n’altère notre statut de justifiés ; nous n’avons pas à racheter nos péchés ultérieurs, simplement à les confesser. Cette déclaration nous donne une totale tranquillité quant à la façon dont Dieu nous voit, revêtus pour l’éternité de la justice de Christ.
Une libération
Paul proclame : « Celui qui est mort a été déclaré juste : il n’a plus à répondre du péché. » (6.7, BDS) Alfred Kuen a paraphrasé ce verset : « Un mort est quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité ; le mal a beau l’appeler : il ne répond plus. » (Parole vivante) Notre rédemption (notre changement de maître) est donc étroitement liée à notre justification.
Non seulement nous sommes justifiés devant Dieu, mais Dieu lui-même nous justifie devant le diable, le monde, notre conscience : « Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » (8.33-34)
Nous sommes les « justes de Dieu » ; Dieu est de notre côté et prend toujours notre parti. N’ayons donc plus peur !
Une espérance
Être justifié par la foi, c’est vivre dans l’espérance : « Si par un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » (5.17, S21) Tout en étant déjà pleinement juste devant Dieu, j’attends le règne de la justice (2 Pi 3.13) auquel je participerai.
Comment cela se traduit-il en justice mise en pratique ?
De la justification à la justice en pratique
L’Écriture ne dissocie pas la justification de la justice en pratique. Déjà dans l’A.T., une centaine de versets rapprochent la justice (sedeq) du jugement (mitspat) qui est la mise en œuvre concrète de la justice.
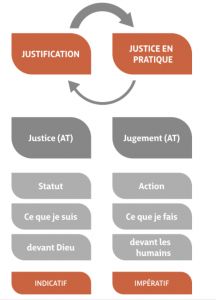
Le chrétien n’agit pas justement pour être justifié devant Dieu mais sa position nouvelle devant Dieu se traduit nécessairement en actions justes envers les autres16 . D’où la flèche épaisse de la gauche vers la droite. Inversement, pratiquer la justice l’affermit dans son statut de justifié, comme l’indique la flèche mince dans le sens inverse.
La justice en pratique se montre de trois manières dans la lettre aux Romains :
Par la mise à disposition de nos membres
Au ch. 6, Paul passe de l’indicatif (6.7) à l’impératif : « Une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. — Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. — De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l’impureté et de l’injustice pour arriver à plus d’injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » (6.18-19, S21) Ce que Dieu a fait pour nous est la base et la motivation de ce que nous devons faire pour Dieu.
Dans notre cœur et notre vie de croyant, la vieille domination du péché doit être surmontée chaque jour à nouveau en nous rappelant le changement fondamental qui a été opéré par Dieu pour nous donner un nouveau statut. Cela passe par des actions très concrètes du quotidien, comme Paul l’indique en utilisant le mot membres » : des paroles justes (par notre bouche), des actes justes (par nos mains et nos pieds), etc.
Par le libre accomplissement de la loi grâce à l’Esprit en nous
Nos actions de la vie de tous les jours conduisent à mettre en pratique les commandements de la loi : « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l’Esprit. » (8.4, S21) La loi exigeait mais ne donnait aucune ressource pour remplir ses exigences ; l’Esprit qui habite dans l’être justifié du croyant donne la puissance pour vivre selon Dieu. Et quelle est l’exigence suprême de la loi ? Paul le dit plus loin : « Les commandements […] se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (13.9) L’amour pour les autres dont l’Esprit veut nous remplir (5.5) est la première marque d’une vie juste. Et si nous voulons voir comment cet amour se décline concrètement, lisons les listes d’injonctions du chapitre 12 : aimer, c’est être plein d’affection, hospitalier, patient, attentif aux besoins d’autrui, sympathisant, prévenant, etc.
Par la vie dans le royaume dès aujourd’hui
La dernière mention de la justice dans la lettre aux Romains se trouve au ch. 14 : « Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » (14.17-18) Vivre justement est une marque fondamentale de la vie dans le royaume de Dieu aujourd’hui. Le règne de Dieu n’est pas encore total et la justice ne règne pas partout, mais le royaume progresse aujourd’hui quand des hommes et des femmes se soumettent à Dieu et montrent le fruit de l’Esprit. L’ordre importe : il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de joie sans paix. Vivre justement n’est pas affaire de règles, mais un style de vie qui fait passer le bien de l’autre avant le sien et répand autour de soi une atmosphère paisible et joyeuse.
Car la justice en pratique est avant tout relationnelle.
* * *
« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », enseignait le Maître (Mat 6.33, Darby).
Au lieu de limiter ses préoccupations à des enjeux purement matériels, le disciple du royaume cherchera à faire rayonner la justice selon Dieu dans toutes ses relations, dans la sphère des chrétiens et au-delà. John Stott disait : « Nous nous engagerons dans l’action sociale et nous nous efforcerons de répandre dans la communauté les normes supérieures de justice qui plaisent à Dieu 17 . »
Nombre de nos contemporains ont faim et soif de justice sociale, raciale, économique, entre les sexes, etc. Dans le royaume de Dieu, les barrières établies par les sociétés humaines ne sont plus de mise et les enfants du royaume, justifiés gratuitement en Christ, peuvent répandre autour d’eux les valeurs de justice du royaume, dans l’attente du jour où la justice régnera pleinement.
- L’Épître emploie plusieurs mots de la même famille dikè : des substantifs (justification, justice), des adjectifs (juste, injuste), des verbes (justifier, agir injustement, faire justice). Pour distinguer les deux dimensions, nous réserverons dans le commentaire le terme « justification » à la relation verticale envers Dieu et le terme « justice » à la dimension horizontale entre humains, même si ce dernier désigne aussi notre relation à Dieu dans plusieurs versets.
- Il est important de noter que les chrétiens ne sont pas les seuls à agir justement — et heureusement ! De nombreux hommes et femmes qui n’ont pas la vie de Dieu en eux, voire s’opposent à lui, montrent au quotidien une justice réelle dans leurs actions concrètes. Ils témoignent ainsi qu’ils ont été créés à l’image du Dieu juste (cf. 2.14). Ces actes justes ne les rendent pas justes aux yeux de Dieu car seule la foi en l’œuvre de Christ peut le faire. Toutefois notre Dieu appréciera ces actions de façon parfaitement juste dans son jugement final (2.6).
- John R.W. Stott, The message of the Sermon on the mount, Bible Speaks Today, IVP, p. 172.
Voici une question souvent posée au sein des églises locales ou entre chrétiens : tous les points de « doctrine » [Nous prenons ici le mot « doctrine » au sens le plus large de « point d’enseignement biblique », qui couvre, au-delà des thèmes proprement doctrinaux, les sujets d’éthique et de comportement.] de la Bible sont-ils également importants pour les chrétiens ? Et si la réponse est négative, comment, alors, déterminer quelles sont les doctrines les plus importantes ? Sur quel(s) critère(s) baser cette hiérarchisation ? Y aurait-il des principes herméneutiques pour nous guider ?
1. Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils également importants ?
Des textes bibliques en faveur du « oui »
Un certain nombre de textes semblent conduire à penser que toute la Bible revêt une égale importance :
• La Bible affirme sa propre inspiration dans sa totalité et ses parties : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile… » (2 Tim 3.16).
• Jésus insiste sur l’accomplissement total de toute l’Écriture, à la lettre près : « Je vous le dis en vérité : tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. » (Mat 5.18 ; cf. 24.35)
• Les raisonnements des auteurs bibliques s’appuient parfois sur des détails « infimes » du texte : par exemple, Paul base son argumentation concernant la réalisation en Christ de la promesse faite à Abraham sur un mot au singulier (Gal 3.16).
• Plusieurs textes insistent sur l’unité des chrétiens qui partagent « une seule foi » (Éph 4.5), ou nous exhortent à avoir « une même pensée » (Phil 2.2).
Des arguments en faveur du « oui »
D’autres arguments peuvent être avancés pour considérer toutes les doctrines au même niveau : • « Sélectionner » les doctrines importantes est difficile.
• On peut facilement craindre des dérives qui conduiraient à trier dans la Bible ce qui nous convient.
• Cela risque de remettre en cause l’inspiration plénière de la Bible.
Des textes bibliques en faveur du « non »
D’autres textes bibliques orientent vers une différenciation entre les textes :
• Jésus lui-même, dans sa controverse avec les pharisiens qui lui demandaient quel est le plus grand commandement de la loi, ne se défausse pas en répondant que tous sont également importants, mais il donne les deux premiers selon lui (Mat 22.35-40).
• Paul exhorte à accueillir les personnes d’opinions différentes sur certains points, comme les prescriptions alimentaires, sans discuter leurs opinions (Rom 14.1) — même si lui-même ne s’estime pas lié par des interdits alimentaires.
• Nous trouvons des marqueurs explicites dans les textes bibliques comme : « premièrement », « avant tout », « d’abord »…
Des arguments en faveur du « non »
• La Bible reconnaît que des péchés sont plus importants que d’autres. Par analogie, les textes qui condamnent les plus sérieux ont forcément plus de poids que ceux qui relèvent les moins graves.
• Selon Jean Calvin, « tous les articles de la doctrine de Dieu n’ont pas la même valeur. Certains sont tellement nécessaires à connaître que personne ne doit en douter. D’autres sont en débat parmi les Églises, sans rompre, cependant, leur unité. » (Institution de la religion chrétienne, IV.1.12)
• Selon Henri Blocher, « lorsque des hommes de Dieu scientifiquement compétents, et qui se veulent tout à fait dociles devant l’Écriture, se trouvent en grand nombre dans les deux camps d’une controverse, nous pouvons présumer que l’objet du débat n’appartient pas au cœur absolument vital du christianisme. » (« L’unité chrétienne selon la Bible », Théologie évangélique, 9)
Conclusion
Un « non » nuancé nous semble s’imposer. S’il est fondamental de tenir ferme à l’inspiration totale et entière de toute l’Écriture, il est nécessaire de prendre en compte la hiérarchisation présente dans les textes eux-mêmes.
2. Quels principes herméneutiques permettent de hiérarchiser les doctrines ?
Des expressions explicites
Comme indiqué, les auteurs bibliques (ou Jésus qu’ils citent) n’hésitent pas à préciser les points les plus importants à leurs yeux par des formules explicites.
Relevons quelques exemples :
• « Avant tout » : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures… » (1 Cor 15.3) « Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l’hypocrisie. » (Luc 12.1) « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » (1 Pi 4.8)
• « Premièrement » : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » (Mat 6.33) « La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite… » (Jac 3.17)• « Plus important » : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » (Mat 23.23)
• « Mieux » : « L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. » (1 Sam 15.22) « Il vaut mieux se marier que de brûler. » (1 Cor 7.9)
• « Meilleur » : « [Christ] a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » (Héb 8.6)
Les fréquences
Un mot qui revient à une grande fréquence dans un livre biblique donné — et plus encore dans toute la Bible — a toutes les chances de concerner un sujet majeur pour notre foi. Par exemple, Dieu (ou l’Éternel) et Jésus (ou Christ) sont, de très loin, les mots les plus fréquents de chaque Testament ; or l’Écriture révèle avant tout qui est Dieu et qui est Jésus.
De même, une idée répétée dans plusieurs textes, plus encore sous la plume de différents auteurs, présente vraisemblablement une importance plus grande qu’un point traité par un seul verset. Par exemple, le « baptême pour les morts » (1 Cor 15.29), quel que soit le sens qu’on lui donne, n’aura jamais la même importance que le baptême chrétien que les Évangiles, les Actes et les Épîtres mentionnent à de multiples reprises. Soyons donc particulièrement prudents sur les doctrines évoquées dans un seul texte et qui sont parfois source inutile de tensions, voire de divisions (il suffirait de citer la couverture des femmes en 1 Cor 11 pour faire saisir l’acuité du sujet !).
Le fait que la mort de Jésus soit décrite quatre fois et que chaque évangéliste y consacre une part disproportionnée de sa biographie inspirée suffit à en indiquer l’importance cruciale. De même pour sa résurrection.
La reprise presque mot pour mot des « Dix commandements » au début de la loi de Sinaï (Ex 20) et en tête du développement des lois du Deutéronome (Deut 5) justifie l’intérêt accordé à ce texte.
Le placement des textes
Les auteurs bibliques, sous la conduite de l’Esprit, ont agencé leurs textes avec grand soin, en particulier en utilisant la forme hébraïque importante du chiasme [ Un chiasme est une figure littéraire qui consiste à reprendre des idées de façon concentrique : A B C D C’ B’ A’. A’ correspond à A, B’ à B, etc. En général, lorsque la symétrie est impaire, la section centrale est la plus importante (D dans cet exemple), suivie des sections A et A’.] . Un texte placé au centre d’un chiasme revêtira ainsi un poids plus important.
Par exemple, 1 Timothée peut être structuré sous forme d’un chiasme qui fait ressortir comme centre les v. 14 à 16 du ch. 3. On peut donc penser que ces versets sont au cœur du message de Paul à Timothée.
D’autres structures sont également éclairantes : entre ses salutations et le début de son développement, Paul résume le message de sa lettre aux Romains dans les v. 16 et 17 du ch. 1. Les points évoqués par ces deux courts versets sont donc fondamentaux à ses yeux.
Les résumés
Les auteurs bibliques donnent parfois des « résumés » de leur doctrine. Par exemple, Paul aborde le sujet de la résurrection en indiquant : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures… » En quelques versets, il va donner aux Corinthiens une synthèse de l’Évangile (1 Cor 15.1-11). Toute doctrine y figurant aura donc un poids majeur.
Les thèmes transversaux
Certains thèmes bibliques sont comme des trames qui courent du début à la fin de la révélation divine.
Ils ont comme particularité de ne pas être circonscrits à un livre ou un auteur particulier. Le développement de ces thèmes est cohérent avec l’orientation historico-rédemptrice de l’Écriture et ils trouvent leur résolution et leur finalité en Jésus-Christ.
En voici quelques exemples : les alliances, la gloire, l’expiation, le temple, l’amour, etc.
Le contenu même des textes
Certains textes contiennent dans leur formulation même l’accent de leur importance. C’est particulièrement le cas des versets qui avertissent que, si nous n’y obéissons pas, nous ne pourrons pas être sauvés. Citons, entre autres :
• Confesser Jésus Christ, Fils de Dieu venu comme homme (1 Jean 4.1-3)
• Croire en la résurrection personnelle corporelle de Jésus Christ (1 Cor 15.12-19)
• Croire en la suffisance de l’œuvre de Christ pour le salut (Col 2.4-21)
• Accepter le salut par la foi, sans les œuvres (Act 15.8-11 ; Gal 1.6-9)
• Pardonner aux autres (Mat 18.35)
• S’engager résolument à la suite de Jésus (Mat 10.38-39)
• Renoncer aux œuvres de la chair (Gal 5.19-21)
• Etc. !
Les prédications des apôtres dans le livre des Actes sont aussi un guide intéressant : elles nous indiquent ce qui était, à leurs yeux, essentiel à la foi — en premier lieu la résurrection de Jésus, la repentance ou l’accomplissement en Christ des prophéties de l’A.T.
Conclusion
Sur les points importants, la Bible est claire : nous disposons de plusieurs textes sur le même sujet, sous la plume de différents auteurs ; le sens du texte original n’offre pas d’ambiguïté d’interprétation ; les marqueurs littéraires convergent pour souligner leur entralité.
Sur d’autres points, la Bible semble « volontairement » moins claire. Nous serons donc plus prudents et moins affirmatifs les concernant et nous éviterons d’en faire des sujets de division.
Enfin, n’oublions pas que de nombreux chrétiens ont réfléchi à ce sujet de la hiérarchisation des doctrines au cours des siècles, ont cherché à appliquer soigneusement les meilleurs principes herméneutiques pour discerner les points fondamentaux et ont rédigé des confessions de foi. Quelque imparfaites que restent ces œuvres humaines, elles peuvent aussi nous aider à clarifier les points les plus importants de la doctrine chrétienne.
Que de mots compliqués pour le titre d’un éditorial ! Ce numéro a pourtant pour objectif de présenter de façon simple quelques enjeux de l’interprétation de la Bible. Interpréter les Écritures implique, de façon implicite ou explicite, de mettre en œuvre des « principes d’interprétation » et ces principes sont précisément ce qu’on appelle « l’herméneutique ».
Parmi les nombreux systèmes herméneutiques, nous proposons de retenir une « herméneutique grammatico-historico-littéraire » :
• grammaticale, parce que la Bible se présente comme un texte faisant sens, qui suit les règles du langage écrit de ses originaux hébreu et grec ;
• historique, parce que chaque livre de la Bible a été rédigé à un moment précis de l’histoire et en relation avec des faits et un contexte historiques qu’il convient de comprendre pour interpréter correctement ;
• littéraire, parce que la Bible est un ouvrage littéraire aux styles variés — Dieu nous ayant parlé « de bien des manières » (Héb 1.1) — styles qu’il convient de soigneusement distinguer pour ne pas se tromper dans son interprétation.
Mais ne nous arrêtons pas à ces trois adjectifs fondamentaux, car une herméneutique fidèle se doit d’être aussi :
• christocentrique, car Christ est le point central de la Bible dont la révélation progressive conduit vers lui ;
• pratique, car la finalité de toute interprétation doit être d’orienter nos pensées et nos actions pour glorifier le Seigneur.
Que ce numéro contribue à nous faire mieux aimer et comprendre la Bible, la lettre d’amour de notre Dieu !
2 Corinthiens est une Épître paradoxale, car c’est une lettre à la fois bien connue et peu connue. Bien connue, car nous y trouvons nombre de versets familiers à beaucoup de lecteurs. En voici quelques-uns :
• « Notre capacité vient de Dieu. » (3.5)
• « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » (4.7)
• « L’amour de Christ nous presse. » (5.14)
• « Grâces soient rendues à Dieu pour son don merveilleux ! » (9.15)
• « Ma grâce te suffit. » (12.9)
• « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (12.10)
Et nous pourrions allonger la liste — jusqu’au dernier verset, bénédiction souvent prononcée ou chantée en fin de culte : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! » (13.13).
Toutefois, la trame générale de la lettre reste souvent méconnue : Paul y traite d’abord et avant tout le sujet de la contestation de son ministère par les Corinthiens. Tout en poursuivant ce thème principal plutôt sombre, l’apôtre s’interrompt pour faire un développement annexe, ouvre une parenthèse, fait une application.
Cette trame est discernable y compris dans les parties les plus souvent lues.
Voici un exemple :
« C’est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous ne nous comportons pas avec ruse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » (4.1-6)
Les portions mises en rouge paraissent a priori incongrues et difficiles à interpréter si elles ne sont pas rattachées au thème général de la lettre. En la lisant, il nous faut donc changer de perspective et la voir avant tout comme un plaidoyer de Paul pour son ministère face à ses accusateurs. C’est le seul moyen d’en percevoir la cohérence et de correctement interpréter dans leur contexte nos versets préférés.
La situation de l’église de Corinthe
Les échanges entre Paul et les Corinthiens furent nombreux et complexes, donnant lieu à au moins 5 lettres et 5 visites18. Le tableau page suivante tente de les résumer.
Les suites de la visite rapide de Paul
Lorsque Paul, depuis la Macédoine, rédige 2 Corinthiens, la situation de l’église s’est éclaircie.
Après lui avoir envoyé sa première lettre, Paul avait dû faire une visite rapide à Corinthe à partir d’Éphèse au cours de laquelle il avait fait face à une forte contestation. Qui s’était opposé à lui ? L’incestueux de 1 Corinthiens 5 ? Un des leaders de l’église ? En tout cas, Paul y fait allusion en affirmant qu’il lui a pardonné (2.5,10).
Après la réception d’une lettre sévère de Paul (7.8) et grâce au ministère de Tite, l’envoyé de l’apôtre, la réaction de l’église a été saine : elle a pris les mesures disciplinaires qui s’imposaient envers l’opposant de Paul : « Cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » (7.11)
Les super-apôtres19
Malheureusement, un grave problème subsistait : l’église de Corinthe accueillait des enseignants qui contestaient le ministère de Paul. Il n’est pas facile de cerner avec précision qui ils étaient ni ce qu’ils enseignaient. Dans un sens, ce flou nous profite car il donne à la lettre un caractère général et la rend applicable dans une grande variété de situations, ce qui serait sans doute moins le cas si Paul avait été plus spécifique. Quoi qu’il en soit, l’objectif majeur de l’apôtre est de contrer leur influence toxique et d’avertir l’église.
Notons que Paul ne s’adresse jamais à eux, mais à l’église qui les a accueillis. Chaque église est responsable du leadership qu’elle suit et c’est à elle de prendre les mesures nécessaires.
D’où venaient les super-apôtres ?
• Ils étaient, semble-t-il, originaires de Palestine et non de Corinthe. Ils revendiquaient avec fierté leur judaïté : « Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils Israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham ? Moi aussi. » (11.22)
• Sans doute plusieurs avaient-ils vu le Christ ressuscité et s’en glorifiaient-ils (cf. 5.16).
• Ils disposaient de lettres de recommandation plus ou moins authentiques (cf. 3.1 ; 10.12).
• Leur ministère n’était cependant pas validé par les vrais apôtres : la lettre circulaire rédigée en conclusion du concile de Jérusalem environ 7 ans auparavant précisait : « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n’avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes… » (Act 15.24). Cette remise en cause ne les avait pas empêchés de sévir à Corinthe.
• Ils prétendaient être à Christ de manière spéciale (cf. 10.7). Peut-être étaient-ils les leaders du « parti de Christ » auquel Paul avait fait allusion en 1 Corinthiens 1.12.
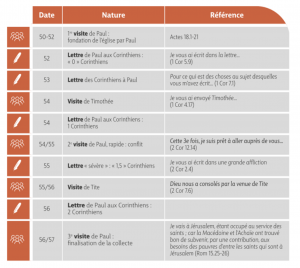
Sous quelles influences étaient les super-apôtres ?
• Des influences juives : ils prônaient un retour vers la loi, méconnaissant le changement introduit par la nouvelle alliance (cf. 3.7-18).
• Des influences grecques : ils accordaient une grande importance à la forme et à la puissance rhétorique et ils méprisaient Paul dont ils jugeaient la présence faible et la parole méprisable (10.10).
• Des influences mystiques : ils se glorifiaient de révélations directes du Seigneur qu’ils auraient reçues (cf. 12.1).
Quelle était la conduite des super-apôtres ?
• Elle était intrusive : ils avaient subrepticement pénétré dans la sphère d’activité de Paul pour la récupérer à leur profit (cf. 10.15).
• Elle était dominatrice : Paul constate : « Si quelqu’un vous asservit, si quelqu’un vous dévore, si quelqu’un s’empare de vous, si quelqu’un est arrogant, si quelqu’un vous frappe au visage, vous le supportez. » (11.20)
• Elle était cupide : dans l’Antiquité, plus un maître faisait payer ses élèves, plus son enseignement était jugé de qualité. Les exigences financières des super-apôtres étaient élevées, face à Paul qui avait annoncé gratuitement l’Évangile (11.7).
Quelle est l’opinion de Paul sur les super-apôtres ?
Le jugement de l’apôtre est très sévère : pour lui, ils sont de faux docteurs qui enseignent un évangile frelaté (cf. 2.17 ; 11.4). Il va même jusqu’à dire que de tels hommes sont « de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ », des ministres de Satan déguisés en ministres de la justice dont la « fin sera selon leurs œuvres » (11.13-15). À la lumière de ce texte, on peut se demander si, pour Paul, ces hommes ont vraiment la vie de Dieu…
La triple occasion de la lettre
En écrivant à l’église de Corinthe, Paul visait un triple but :
• Tout d’abord, il devait régler le problème lié à sa visite rapide et à sa lettre sévère : il devait affirmer qu’il n’avait pas de ressentiment, faire part de sa joie à l’écoute du témoignage de Tite lui rapportant que la situation avait été réglée et défendre son ministère face aux attaques.
• Ensuite, dans le cadre de la préparation de la collecte que Paul voulait ramener à Jérusalem, il devait stimuler les Corinthiens à être généreux, en instaurant une saine émulation entre les églises de Grèce, d’Achaïe et de Macédoine. Il devait également les rassurer sur la bonne gestion de la collecte.
• Enfin, il devait avertir fermement les Corinthiens par rapport aux super-apôtres. Il va ainsi se trouver dans la situation paradoxale d’être obligé de se défendre, sinon il sera accusé de faiblesse. Mais Paul est peu désireux de se mettre en avant, sinon il sera accusé de se vanter. Il est donc sur une crête très étroite et il s’en sort en disant en substance : « Vous voyez, je suis obligé de parler comme un insensé ; vous m’y contraignez parce que je suis obligé de me défendre mais je n’ai pas envie de me mettre en avant. » Grâce à cette astuce rhétorique, Paul met au jour le danger que représentent ces super-apôtres tout en préparant sa venue future, en demandant aux Corinthiens de prendre les mesures nécessaires contre eux.
Cette triple occasion de la lettre permet d’y distinguer trois grandes parties : ch. 1 à 7, 8 et 9 puis 10 à 13 (cf. plan en annexe).
Deux thèmes majeurs de la lettre
La Seconde Épître aux Corinthiens couvre moins de thèmes que la Première. Deux thèmes se détachent néanmoins particulièrement.
Des aspects uniques de Christ
2 Corinthiens présente de façon touchante et parfois unique des aspects de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ :
1. Christ est unique dans son sacrifice :
• Il est la substitution pour nos péchés, comme l’affirme un des textes les plus profonds de toute la Bible : « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » (5.21)
• En lui, nous trouvons ce que John Stott appelle à juste titre « l’auto-substitution de Dieu 20 » : « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses. » (5.19)
2. Christ est unique dans son abaissement volontaire pour nous :
• Il s’est fait volontairement pauvre : « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » (8.9)
• Il s’est fait volontairement faible : « Il a été crucifié dans la faiblesse. » (13.4, NBS)
3. Christ est unique, mais il peut être vu dans les siens :
• Les chrétiens sont transformés par la contemplation de sa personne : « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur. » (3.18)
• Les chrétiens, à la suite de Paul, peuvent suivre son exemple : « Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ » … (10.1).
Le ministère chrétien
Le second thème, trame principale de la lettre, est l’apologie du vrai ministère chrétien. Le vrai serviteur de Christ :
• Imite Jésus Christ en acceptant paradoxes et souffrances sans chercher son intérêt personnel : « Moi, très-volontiers je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes, si même, vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. » (12.15, Darby) ;
• Prêche la pure Parole de Dieu — ce qui, aujourd’hui, signifie rester fidèle à la Parole apostolique (cf. 2.17) ;
• Accepte les responsabilités pour combattre quand cela est nécessaire (10.4-6) ;
• Développe un cœur de berger en s’intéressant au collectif comme à l’individuel : « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber, que je ne brûle ? » (11.28-29) ;
• Est équilibré en tout : humble sans être servile, doux sans être faible, flexible sans être influençable (cf. 4.8-10 ; 6.3-10 ; 10.17).
L’impact de la lettre
Quels furent les effets de la lettre ? Ils sont peu explicites à la lecture du livre des Actes. À tout le moins, la collecte a dû être suffisante pour que Paul la porte à Jérusalem et le climat a dû être suffisamment paisible pour que Paul puisse rédiger l’Épître aux Romains pendant son séjour. Et puis Paul n’a pas jugé nécessaire, semble-t-il, de rédiger un « 3 Corinthiens » !
Au-delà de cet impact historique, 2 Corinthiens aura un impact aujourd’hui si la lecture de cette lettre nous conduit à nous engager hardiment dans le service du Seigneur, en imitant Paul qui lui-même imitait si bien son Maître.
Annexe : un plan pour 2 Corinthiens
Sans rentrer dans tous les détails du plan, il est nécessaire d’indiquer que la première partie des ch. 1 à 7 comporte une grande parenthèse courant de 2.14 à 7.4. En effet, 7.5 semble continuer directement le thème couvert jusqu’en 2.13 :
La défense de la conduite de Paul (1. 11 – 2. 13)
Paul ne trouve pas Tite à Troas et part en Macédoine
2. 12-13 : Or , étant arrivé dans la Troade pour l’Evangile de Christ, et une porte m’y étant ouverte dans le Seigneur, je n’ai point eu de repos dans mon esprit, parce que je n’ai pas trouvé Tite, mon frère ; mais, ayant pris congé d’eux, je suis parti pour la Macédoine.
Parenthèse : La nature du ministère (2. 14 – 7. 4)
La défense de la lettre écrite par Paul (7.5-16)
Paul lutte en Macédoine en attendant Tite qui arrive finalement 7. 5-6 : Car aussi, lorsque nous arrivâmes en Macédoine, notre chair n’eut aucun repos, mais nous fûmes affligés en toute manière : au dehors, des combats ; au-dedans, des craintes.
Mais celui qui console ceux qui sont abaissés, Dieu, nous a consolés par la venue de Tite.
Salutation et bénédiction 1.1-11
Adresse 1.1-2
Bénédiction 1.3-11
A. La défense du ministère 1.11-7.16
1. La défense de la conduite de Paul 1.12-2.13
L’explication du changement des plans de Paul 1.12-2.4
Le pardon du frère offenseur 2.5-11
L’absence de Tite à Troas 2.12-13
2. La nature du ministère 2.14-7.4
La gloire du ministère 2.14-4.6
La fragilité du ministre 4.7-5.10
Le message du ministre 5.11-6.10
L’appel du ministre à l’amour et à la sainteté 6.11-7.4
3. La défense de la lettre écrite par Paul 7.5-16
La rencontre avec Tite en Macédoine 7.5-7
La lettre sévère et la tristesse positive produite 7.8-16
B. La collecte pour les chrétiens de Jérusalem 8.1-9.15
1. La nécessité de la collecte 8.1-15
L’exemple stimulant des Macédoniens 8.1-5
L’exhortation motivée aux Corinthiens 8.6-15
2. La mission de Tite et des deux frères à Corinthe 8.16-9.5
La recommandation de Tite et des deux frères par Paul 8.16-24
L’attente de Paul 9.1-5
3. Les principes de la générosité chrétienne 9.6-15
Le bénéfice pour le donateur 9.6-11
La louange à Dieu par les bénéficiaires 9.12-15
C. L’autorité de Paul face à ses adversaires 10.1-13.10
1. L’autorité de Paul face à ses adversaires .. 10.1-18
Les armes utilisées par Paul 10.1-6
L’attitude cohérente de Paul 10.7-11
L’ampleur du champ d’activité de Paul 10.12-18
2. La supériorité de Paul face à ses adversaires 11.1-12.13
La supériorité de Paul dans sa prédication et sa conduite 11.1-15
La glorification forcée de Paul 11.16-12.13
3. La prochaine visite de Paul 12.14-13.10
Le désintéressement de Paul 12.14-18
Les craintes de Paul sur la situation des Corinthiens lors de sa visite 12.19-21
Les avertissements de Paul sur l’exercice possible de sa discipline apostolique 13.1-10
Exhortations finales, salutations et vœux .. 13.11-13
- L’hypothèse d’une première lettre (« 0 » Corinthiens) et d’une troisième (« 1,5 » Corinthiens) est soutenue par de nombreux commentateurs. Cf. Craig Blomberg, 1 Corinthians, NIVAC, p. 22 ; Thomas Schreiner, 1 Corinthiens, MB, p. 38 ; David Garland, 2 Corinthians, NAC, p. 25-27. »
- C’est ainsi que les versions NBS, S21, BFC, Semeur, etc., traduisent l’expression « les apôtres par excellence » de la NEG (11.5).
- John Stott, La croix de Jésus-Christ , EBV, 1988, p. 127-155.
Le diagnostic
« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel » (Amos 8.11) .
Deux sondages parus ces dernières années montrent que les chrétiens sont en état de famine spirituelle :
• Concernant les protestants français (y compris évangéliques), 13 % lisent la Bible tous les jours ou presque, 6 % au moins une fois par semaine et 81 % moins souvent, dont 29 % jamais. 21
• Concernant les Suisses se définissant comme « protestants évangéliques », seuls 38 % déclarent avoir lu la Bible en entier. 22
Naturellement, les chiffres sont beaucoup plus bas si l’on considère la population totale. Le constat est sans appel : la lecture de la Bible n’est pas une priorité, même parmi ceux qui se disent chrétiens ! Et pourtant la « faim » spirituelle existe bel et bien et on cherche à la satisfaire par d’autres sources… qui ne rassasient pas !
La situation n’est pas sans analogie avec celle du temps du prophète Amos. Ce dernier critique la cupidité de ses contemporains qui oublient Dieu, oppressent les pauvres et négligent les jours de repos pour commercer davantage (Amos 8.4-6). En conséquence, Dieu envoie une famine spirituelle qui touche d’abord les jeunes (Amos 8.13).
Sans noircir exagérément le tableau, on peut constater que, dans nos églises, la lecture biblique personnelle tend à se raréfier, le culte familial à disparaître et le temps dévolu en église à la prédication biblique à se réduire au profit de la louange. Si cela ne va pas forcément jusqu’à la famine, assurément un constat partagé de dénutrition s’impose !
Le remède
« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4).
La réponse de Jésus à la première tentation du diable au désert est bien connue ; elle est devenue un chant familier… Mais qu’en est-il de sa mise en pratique ? Nous prenons soin de nous nourrir physiquement chaque jour, mais pas toujours spirituellement. Les humains, dans leur grande majorité 23 , mangent tous les jours, mais le soutien de la vie physique n’est pas suffisant : le Seigneur insiste sur l’importance de la Parole de Dieu pour vraiment vivre ! Lui-même disait : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4.34).
La citation qu’il fait du Deutéronome rappelle qu’Israël au désert n’a pas souffert de la faim physique : la manne venait quotidiennement le rassasier. En revanche, il a oublié la parole de l’Éternel et une génération est morte (mais pas de faim !) dans le désert.
Manger quotidiennement – lire quotidiennement la Bible : deux activités qui devraient être naturelles, routinières. Chacun a ses habitudes alimentaires : certains privilégient un copieux petit-déjeuner alors que d’autres préfèrent se caler au dîner. Des croyants aiment ouvrir leur Bible dès le réveil alors que d’autres, plus « du soir », savourent la tranquillité des dernières heures du jour.
Et si l’on n’a pas faim ? Il nous arrive de ne pas avoir d’appétit au moment de nous mettre à table : allons-nous sauter le repas ? Peut-être, mais pas plusieurs fois de suite ! Nous allons nous forcer, ou bien choisir un plat que nous aimons particulièrement.
De même, nous pouvons reconnecter avec la Parole par un effort assumé ou en revenant vers un de nos textes favoris.
Et si l’on rate un jour ? Ce n’est pas un drame ! Une règle inflexible nous obligeant à lire au moins un chapitre de l’Écriture sans manquer un jour ne serait pas dans l’esprit de la liberté de la nouvelle alliance. Une chrétienne recommandait : « Deux jours 24 mais pas trois ! » Il ne faut pas que les excuses deviennent une habitude…
Et si l’on n’aime pas tel texte ? Jésus précise : « toute parole » (cf. 2 Tim 3.16). On dit qu’il faut goûter sept fois un aliment avant de l’apprécier vraiment. Notre première lecture du Lévitique ne nous enthousiasmera pas forcément, mais au fur et à mesure que nous saisirons la trame générale de l’Écriture, la progression de la révélation, les correspondances entre les livres, nous en viendrons à apprécier même ceux que nous trouvions a priori quelque peu indigestes !
Ne nous leurrons pas : un combat est en jeu ! Notre sujet relie les deux thèmes de ce numéro : pour vaincre la famine, une guerre se joue. La faim de Jésus au désert était bien réelle, mais sa priorité fut de se conformer à la Parole de son Dieu et il a vaincu le diable. Alfred Kuen a écrit : « Lire la Bible, c’est contrecarrer le plan des forces hostiles à Dieu. Celles-ci ne demeureront pas inactives : elles chercheront par tous les moyens à déranger notre lecture ou à l’empêcher. Notre lecture de la Bible est donc, en premier lieu, une lutte spirituelle. »
La motivation
« Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon » (1 Pierre 2.2-3).
Si la motivation est absente, la régularité le sera bientôt ! Pourquoi ouvrons-nous notre Bible ? Par obéissance ? pourquoi pas. Par devoir ? sans doute quelquefois. Par peur ? j’espère que non… Avant tout, ouvrons-la pour une rencontre personnelle avec son auteur, Dieu lui-même, et avec celui qui est le centre de la révélation écrite, la Parole vivante, Jésus-Christ. Ouvrons-la pour mieux le connaître et ainsi davantage l’aimer et le servir avec plus de zèle. Nos expériences passées avec le Seigneur (ses délivrances, sa protection, ses bienfaits si nombreux dont le Psaume 34 que cite l’apôtre se fait l’écho) renforcent l’envie de nous approcher de lui : puisque 25 nous avons expérimenté sa bonté, nous avons d’autant plus envie de l’écouter.
Le lait est ici le symbole d’un aliment complet 26 et l’image de Pierre est parlante : qui n’est pas réjoui de voir un bébé téter goulûment, avec un sentiment de plénitude et de satisfaction une fois sa faim apaisée ? La lecture de la Parole est indispensable pour grandir spirituellement : elle est à l’origine de la vie nouvelle en nous (1 Pi 1.23-25) et elle est l’aliment de notre croissance, présente dans toutes les étapes d’un salut qui embrasse bien au-delà de la nouvelle naissance.
Pierre, cependant, n’occulte pas les obstacles. Deux d’entre eux sont à relever :
• les tensions relationnelles (méchanceté, hypocrisie, jalousie, médisance, 1 Pi 2.1) annihileront l’effet positif de la Parole : traitons-les vite pour retrouver la joie de notre lecture ;
• les « convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme » (1 Pi 2.11) témoignent une fois de plus de la lutte spirituelle qui est en jeu : si mes pensées et mon emploi du temps sont occupés à satisfaire mes désirs purement terrestres, la lecture de la Bible sera négligée — et les pièges ne manquent pas en la matière, multipliés par les outils électroniques constamment à notre disposition !
La conséquence
« J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur » (Jérémie 15.16).
Dans ce texte, selon la meilleure hypothèse, Jérémie fait allusion au livre de la loi découvert sous Josias.
Longtemps oublié, le Deutéronome a été le guide d’action de ce roi pieux et la joie du prophète.
Le verbe « manger » indique une appropriation personnelle du message reçu. Jésus se comparait lui-même au pain de vie et invitait ses disciples à le « manger » symboliquement. Le remède à la dénutrition passe par une meilleure assimilation des aliments, qui réclame régularité des prises, mastication prolongée, choix approprié des mets.
Le parallèle avec notre assimilation de la Parole est facile à faire !
Pour « trouver » les paroles du Seigneur, les occasions ne manquent pas. Si l’on est isolé, comme Jérémie, on peut, par exemple : télécharger la Bible sur son smartphone y compris sous forme d’audiolivre, compléter par des podcasts ou des messages YouTube choisis avec discernement, se fournir dans une librairie chrétienne de livres d’édification, etc.
La Bible se « trouve » aussi en groupe et se comprend mieux à plusieurs : cherchons un groupe de lecture près de chez nous, profitons des messages bibliques de notre église, suivons des formations bibliques en présentiel ou à distance…
Et surtout, quel que soit le moyen, nous pouvons y trouver notre joie, plus encore, notre « allégresse » car la Parole nous vient du Dieu auquel nous appartenons, qui nous aime et qui nous parle ! Quel bonheur d’ouvrir sa lettre d’amour pour nous, de l’y découvrir toujours plus ! Le psalmiste disait : « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » (Ps 119.162) La joie est communicative, dit-on : c’est en montrant un plaisir sincère dans notre lecture personnelle et collective que nous donnerons envie, aux plus jeunes en particulier, de lire la Parole. La famine se sera transformée en festin !
Le problème inverse
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements » (Jacques 1.22).
Tous les chrétiens ne souffrent pas de famine spirituelle. Certains risquent davantage l’obésité !
On lit beaucoup la Bible (parfois que la Bible !), on assiste à toutes les réunions ou webinaires possibles, on affiche des versets partout… et ce surpoids ne se traduit pas en exercice ! Il peut y avoir une grande régularité dans le culte personnel, de la connaissance accumulée, un vrai souci d’exactitude doctrinale – et peu de souci du prochain, pas d’appréciation des enjeux du moment, de l’indifférence vis-à-vis des besoins autour de soi. Jacques dénonce ce travers en évoquant de faux raisonnements, qui prennent parfois la forme d’un accent exagéré sur la séparation du monde, la pureté extérieure, la fidélité aux traditions reçues, etc. Le résultat en est aussi une vraie pauvreté spirituelle.
La solution à l’obésité spirituelle ? Se mettre à l’œuvre, s’occuper des plus démunis, recommande Jacques (Jac 1.25,27). « Entrer et sortir » disait un frère âgé à de jeunes croyants : entrer dans le sanctuaire de Dieu pour l’écouter calmement dans sa Parole et sortir pour servir activement. L’Écriture nous est donnée pour nous rendre « accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Tim 3.16-17).
« Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » : appliquons ce proverbe populaire et nourrissons-nous de l’Écriture pour œuvrer ensuite de façon intelligente et diligente pour le Seigneur.
- Sondage IFOP pour l’Alliance biblique française et le quotidien La Croix, effectué en France mi-2022.
- Sondage Link pour Christianisme aujourd’hui, effectué en Suisse mi-2020.
- Même s’il reste hélas 828 millions de personnes sur Terre à souffrir de la faim en 2021, soit environ 10 % des humains (source : Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies).
- Sous-entendu sans ouvrir la Bible.
- C’est ainsi qu’il faut comprendre le « si » du verset 3 et que la Bible du Semeur le traduit.
- Dans d’autres textes, il est évoqué avec une connotation négative, comme l’aliment initial dont il faut ensuite se détacher pour avancer vers des nourritures plus solides (1 Cor 3 ; Héb 5). Notons l’intérêt de voir le sens d’un symbole à la lumière de son contexte !
Un être humain naît à Bethléhem sous le règne d’Auguste. On l’a appelé « Jésus ». Ce bébé, extérieurement semblable à tous les autres, s’inscrit dans une lignée qui remonte à Adam et dont tous les membres ont connu le même sort 27 : « Puis il mourut » (cf. Gen 5.5,6, etc.). Va-t-il connaître la même fin ?
Certes, des annonces extraordinaires données à sa mère, à son père et à des bergers lors de sa naissance l’ont déjà singularisé : « saint enfant », « fils de Dieu », « sauveur », « Christ », « Seigneur ». Mais devrait-il
mourir un jour comme les autres ? Comment ce futur roi pourrait-il prolonger son règne indéfiniment (Luc 1.33) s’il partage le sort commun de l’humanité ?
Jésus et la mort… la question se pose implicitement dès le début de sa vie terrestre. Suivons donc les récits historiquement fiables que les Évangiles nous ont laissés pour résoudre cette question !
Jésus est confronté à la mort
Jésus devait mourir
Cela fait quelques jours que le bébé Jésus est né à Bethléhem. Averti de la naissance d’un rival potentiel par les mages venus rendre hommage au nouveau-né, le roi Hérode décide de le tuer et, pour faire bonne
mesure et éviter de le manquer, il ordonne le massacre de tous les bébés de Bethléhem et sa région ! Mais Jésus échappe à cette horrible tuerie grâce à un songe miraculeux qu’un ange donne à son père Joseph (Mat
2.13-20).
Une trentaine d’années passent, sans autre menace de mort. Jésus se lance dans un ministère itinérant de prédication et de guérison autour du lac de Galilée. Quelques temps après, Jésus retourne à Nazareth où il
prêche dans la synagogue. Son discours d’ouverture déplaît tellement que ses compatriotes veulent le faire mourir : ils le mènent au bord de la falaise sur laquelle la ville est bâtie pour l’en précipiter. Mais Jésus ne doit pas mourir : « passant au milieu d’eux, il s’en alla » (Luc 4.30).
Les mois passent et l’opposition des chefs religieux contre Jésus s’intensifie : ce rabbi non autorisé qui guérit les jours de sabbat, qui dénonce leur hypocrisie, qui se prend pour le fils de Dieu et qui rassemble de telles foules, il faut le faire disparaître ! Soit en réaction immédiate (Marc 3.6 ; Mat 12.14 ; Jean 5.18), soit de façon plus planifiée (Jean 7.1,19,25 ; 8.37,40), ils cherchent à le faire mourir. Hérode, le fils du précédent, s’y met aussi (Luc 13.31). Mais tous ces complots échouent : « Personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue » (Jean 7.30 ; 8.20). Serait-il invincible ? miraculeusement protégé ?
Jésus ressuscite les morts
Si Jésus échappe régulièrement à la mort, celle-ci frappe autour de lui. Joseph son père « adoptif » est sans doute mort pendant son enfance 28 .
Plus tard, lors de son ministère itinérant, à trois reprises au moins, Jésus est confronté à la mort et chaque fois il démontre sa puissance en ressuscitant le mort :
• Le fils unique d’une veuve de Naïn se lève sur le chemin du cimetière et se met à parler (Luc 7.15).
• La fille unique d’un chef de synagogue se lève dans la chambre où elle vient d’expirer et peut manger (Luc 8.56).
• Lazare, un ami proche de Jésus, sort du tombeau après quatre jours et s’en va (Jean 11.44).
Que la mort soit le sort inévitable de tout humain n’empêche pas Jésus de marquer son opposition par rapport à elle et sa sympathie pour ceux qu’elle touche : il est ému de compassion face à la veuve éplorée, il encourage Jaïrus, il pleure avec Marie et « frémit en son esprit 29 » face aux ravages de cette conséquence ultime du péché.
Au-delà de ces trois exemples narrés avec détails, d’autres résurrections ont peut-être eu lieu : Jésus fait dire à Jean-Baptiste en prison : « Les morts ressuscitent » (Mat 11.5) ! Aux apôtres qui vont parcourir la Galilée, Jésus ordonne : « Ressuscitez les morts » (Mat 10.8).
Jésus fait l’expérience de la mort
Jésus face à l’ombre de la croix
Si l’être humain ne connaît pas le futur et s’épargne ainsi bien des souffrances, il n’en est pas ainsi de Jésus. Sa venue sur la terre a un but précis ; il sait parfaitement ce qui l’attend au bout de son chemin : la mort. Aussi cette connaissance est-elle pour lui une source particulière de souffrances : l’ombre de la croix s’est progressivement dressée sur son chemin.
• Dès le début de son service, Jésus sait qu’il y a « une heure » pour laquelle il est venu (Jean 2.4).
Mais il garde cette révélation pour lui.
• Dès que Pierre reconnaît sa messianité à Césarée de Philippe, Jésus coupe immédiatement court aux attentes triomphalistes de ses disciples en annonçant qu’il doit aller à Jérusalem pour souffrir et être mis à mort (Mat 16.12-21).
• Au cours de la montée vers Jérusalem, l’ombre de la croix s’allonge sur son chemin : c’est alors qu’il évoque ce baptême de souffrances qui l’attend et dont la perspective serre son cœur (Luc 12.50).
Pourtant il ne se laisse pas détourner de son but : « Il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant ; car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem » (Luc 13.33). Plusieurs fois, il répète que la mort l’attend.
• Malgré ces annonces régulières, les disciples sont troublés et ne comprennent pas : ils sont davantage préoccupés par leur place dans le royaume messianique glorieux. Jésus, lui, est venu pour donner sa vie (cf. Marc 10.32-45). Seule Marie de Béthanie semble comprendre le drame qui va se jouer et oint son Maître « pour le jour de sa sépulture » (Jean 12.7).
• Pendant la dernière semaine, Jésus passe ses nuits dans la montagne des Oliviers (Luc 21.37). L’Épître aux Hébreux lève le voile sur ces heures solitaires : sans doute est-ce pendant ces jours-là plus particulièrement que notre Seigneur a « présenté, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort » (Héb 5.7).
• La pensée de la croix se précise toujours plus : après avoir évoqué le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, le Seigneur ajoute : « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ?… Père, délivre-moi de cette heure ?… Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure » (Jean 12.27).
• Enfin « l’heure » est venue : Jésus, « sachant tout ce qui devait lui arriver » (Jean 18.4), entre dans le jardin de Gethsémané.
Jésus éprouve l’angoisse de l’anticipation de la mort
Dans le jardin des Oliviers, Jésus se met à genoux et prie : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! » (Marc 14.36) Va-t-il renoncer à sa mission ? Non, l’angoisse profonde qui
le saisit alors ne le fait pas reculer, et Jésus accepte en pleine connaissance de cause la coupe des souffrances indicibles de l’expiation : « Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi » (Marc 14.36, Darby).
Il nous faut Gethsémané pour mesurer la singularité de la mort vers laquelle va Jésus. Des humains ont parfois fait face à la mort sans broncher, sereinement, comme Socrate lorsqu’il but la ciguë mortelle. De
nombreux martyrs chrétiens ont étonné par leur calme, voire même leur joie, au moment du supplice, comme Blandine dans les arènes de Lyon. Si Jésus est angoissé au point que sa sueur devienne comme
des gouttes de sang (Luc 22.44), ce n’est pas par manque de courage ; c’est que la mort qui se dresse maintenant, toute proche, est unique : la « coupe » est celle de l’horreur du châtiment pour les péchés et
pour le péché, l’horreur de l’abandon de Dieu.
Jésus subit la mort spirituelle
Jésus, arrêté, passe en procès devant les Juifs puis les Romains. Pour les premiers, « tous le condamnèrent comme méritant la mort » (Marc 14.64). En revanche, pour Pilate, « cet homme n’a rien fait qui soit digne de mort » (Luc 23.15). Mais les cris des premiers l’emportent et Jésus est emmené pour être crucifié, la mort la plus honteuse qui soit à l’époque.
Sur la croix, Jésus passe par un moment unique : « La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15.33-34).
L’homme Jésus subit pendant ces trois heures l’abandon complet de la part de Dieu : comme le dit le Psaume qu’il cite, il est mis par Dieu lui-même dans « la poussière de la mort » (Ps 22.16) — non pas la mort physique (elle viendra plus tard), mais la mort spirituelle, la « seconde mort », l’éloignement absolu de Dieu. Il est le seul homme qui n’aurait jamais eu à mourir, puisqu’il est le seul absolument sans péché (cf. Jean 8.46), le seul qui a toujours entretenu une parfaite communion avec Dieu (Jean 8.29 ; 11.42).
Ainsi la « mort de la croix » est celle par laquelle il porte nos péchés (et non les siens) (1 Pi 2.24), par laquelle notre châtiment éternel (et non le sien) est pris sur lui. « Jésus, l’homme sans péché, est venu pour assumer toutes les conséquences du péché de l’homme pécheur. […] Lui le seul juste, le seul saint, après avoir été l’homme de douleurs, solitaire mais dans une communion ineffable avec Celui dont il faisait toujours la volonté, a connu sur la croix, comme nul n’aura jamais pu la connaître, la plus terrible mort morale : la séparation d’avec le Dieu offensé par nous dont il prenait la place, et qui était “son” Dieu. Qui
sondera le gouffre de cette détresse ? » 30
Jésus passe par la mort physique
La victoire sur « celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable » a été remportée sur la croix pendant ces heures de ténèbres. « Tout est accompli ! », proclame le crucifié ! Mais Jésus doit encore éprouver ce qu’est la mort pour tout être humain (Héb 2.9) et donc passer par la mort physique, la séparation des parties immatérielle et matérielle de l’être.
Contrairement à tout autre humain, Jésus entre dans la mort physique volontairement, triomphalement : « Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. » (Luc 23.46) Tout affaibli qu’il soit après une nuit blanche, des sévices corporels nombreux et les douleurs physiques de la crucifixion, Jésus meurt en vainqueur. Il l’avait annoncé : « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner » (Jean 10.17-18).
L’esprit de Jésus, la partie immatérielle de son être, dans une communion pleinement retrouvée avec son Père, va « dans le paradis », avec le brigand repentant (Luc 23.43), avec les croyants de l’ancienne alliance qui attendent la résurrection. Le corps de Jésus, une fois la mort physique dûment constatée par les soldats romains (Jean 19.33-34) et par l’évangéliste (Jean 19.35), est porté dans le tombeau de Joseph d’Arimathée.
Jésus est victorieux sur la mort
Jésus est ressuscité et ne meurt plus
Le récit des Évangiles ne s’arrête pas au seuil du tombeau : le mort est ressuscité ! Jésus sort de la mort physique au matin de Pâques pour devenir le « premier-né d’entre les morts » (Col 1.18), « les prémices de ceux qui sont morts » (1 Cor 15.20).
Lui seul peut conjuguer le verbe mourir au passé : « J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts » (Apoc 1.18). Désormais il vit « d’une vie impérissable » (Héb 7.16). L’homme Jésus peut recevoir le règne éternel que l’ange avait annoncé lors de sa conception puisque « Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui » (Rom 6.9).
Jésus nous donne la victoire sur la mort
Jésus n’est pas seul dans le chemin qu’il a tracé à travers la mort, mais il associe à lui toute personne qui met foi en sa mort expiatoire :
• Lui seul a subi la mort spirituelle, la séparation complète de Dieu, pour que nous ne la subissions jamais : nous n’aurons jamais à souffrir de la « seconde mort » (Apoc 2.11).
• Par sa mort et sa sortie de la mort en résurrection, nous qui étions morts spirituellement par nos offenses et nos péchés, nous sommes « passés de la mort à la vie » et « rendus vivants avec Christ » (Éph 2.5). Dès aujourd’hui, une relation de vie existe entre Dieu et nous par lui.
• Face à la mort de nos proches, Jésus comme autrefois pleure avec nous, nous encourage et nous console.
• Enfin, même si nous devons nous-même passer par la mort physique, Jésus nous affirme, comme autrefois à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jean 11.25-26) Répondons positivement !
- Seul Hénoc, par exception, n’a pas connu la mort (Héb 11.5).
- Les Évangiles canoniques n’en disent rien. Toutefois l’absence totale de mention de Joseph lorsque sa famille est évoquée laissent supposer la mort précoce de Joseph, tout comme le fait que Jésus soit désigné comme « le charpentier », fils aîné qui a dû prendre la suite de son père à la mort de ce dernier pour subvenir aux besoins familiaux.
- Trois verbes laissent entrevoir à quel point Jésus a été affecté : « frémit » (Jean 11.33,38 ; litt. : gronda de colère, d’indignation ; renâcla — pour un cheval) ; « fut tout ému » (Jean 11.33, troublé dans ses sentiments et pensées, bouleversé, agité intérieurement – cf. Jean 12.27, 13.21) ; « pleura » (Jean 11.35, versa des larmes d’émotion ; le mot est différent pour les pleurs de Marie, lamentations de deuil ou de peine). [NDLR]
- A. Gibert, « Jésus et la mort », Messager Évangélique, 1978, p. 57.
La venue de Jésus-Christ sur la terre a été l’occasion d’une intense activité miraculeuse. Que ce soit directement par lui — surtout — ou par ses disciples — à certaines occasions — guérisons, exorcismes, résurrections même, ont émaillé les trois ans de ministère public du Seigneur. Au point même que certains voyaient en lui un nouvel Élie, le fameux prophète thaumaturge 31 d’autrefois (Mat 16.14).
La mort, la résurrection et l’ascension de Jésus n’ont pas mis un terme à cette activité miraculeuse. Comme l’écrit l’auteur de l’Épître aux Hébreux, un chrétien de la deuxième génération : « Le salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » (Héb 2.3-4).
Le livre des Actes rend témoignage d’un certain nombre de miracles, dans la continuité et en pleine cohérence avec ceux des Évangiles. Nous en examinerons certaines caractéristiques.
Les miracles sont opérés par les apôtres et quelques autres croyants qualifiés
Rien, dans le livre des Actes, n’indique que tous les chrétiens des débuts de l’histoire de l’Église aient accompli des miracles. Luc rapporte que ceux-ci étaient opérés par les apôtres (2.43 ; 5.12), par deux des sept délégués des apôtres, Étienne et Philippe (6.8 ; 8.6) et par quelques autres personnes spécifiquement envoyées, comme Barnabas (14.3 ; 15.12).
Pierre (5.15) et Paul (19.11) sont particulièrement distingués comme ayant eu la capacité d’opérer des « miracles extraordinaires ». Le fait qu’on vienne chercher un apôtre pour opérer un miracle (9.38) démontre à l’évidence que tous n’en avaient pas le don.
Les miracles ne sont pas systématiques
• Quant aux lieux : Les Actes rapportent des miracles opérés en divers endroits (Jérusalem, la Samarie, la Judée, Icone et Lystre, Éphèse…), mais sont silencieux sur d’autres lieux où les apôtres sont pourtant restés un certain temps. Par exemple, Luc n’évoque aucune activité miraculeuse à Antioche, ni à Thessalonique.
Rien n’est dit d’un quelconque miracle de Paul à Athènes, où il y avait pourtant du monde pour l’écouter. À Corinthe, même si Paul indique ailleurs qu’il en a fait dans cette ville (2 Cor 12.12), les miracles sont omis par l’auteur. À tout le moins, ils n’étaient pas la condition sine qua non de l’annonce de l’évangile en tout endroit.
• Quant aux personnes : Pierre a été miraculeusement délivré d’une mort certaine par un miracle dont il a bénéficié quand un ange l’a tiré de la prison d’Hérode. Son ami Jacques, peu de temps auparavant, avait subi le martyre sans bénéficier du même miracle. Paul a passé plusieurs années en prison, à Césarée, puis à Rome, sans être surnaturellement délivré. Et pourtant, qui pourrait dire si Pierre était plus pieux ou avait plus de foi que Jacques ou Paul ? Bénéficier d’un miracle n’est pas le signe d’une foi supérieure.
• Quant aux occasions : Il semble qu’à certaines occasions, une « vague » de miracles ait été opérée, puis que ceux-ci soient devenus plus sporadiques : le début du ministère de Paul à Éphèse fut très actif en prodiges mais rien dans la lettre aux Éphésiens ou dans les deux lettres à Timothée ne laisse supposer qu’ils continuèrent dans cette ville.
Les miracles ne sont pas toujours sélectifs
« La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient guéris » (5.16). Comme du temps de Jésus (Marc 6.56), à cette occasion, tous les malades sans exception sont guéris et tous les possédés sont délivrés (notez que le texte distingue soigneusement entre les deux catégories). Nulle discrimination par rapport à la grandeur de la foi de la personne, à son désir d’être délivrée, à la nature de son mal, etc. Le signe tient aussi à la généralité. À d’autres occasions, « beaucoup » remplace « tous » (8.7).
À ces miracles « de masse », s’ajoutent des miracles plus ciblés. Plusieurs femmes pieuses sont décédées du temps des Actes, mais seule Dorcas a été ressuscitée (9.36-42). Plusieurs infirmes vivaient à Jérusalem, mais seul celui du temple a été guéri. Nous voyons au travers de ces différences la totale liberté d’action de l’Esprit de Dieu qui opère souverainement pour produire l’effet désiré.
Les miracles sont instantanés
Aucun texte des Actes n’indique qu’il ait fallu attendre un certain laps de temps pour que la guérison s’opère ou encore qu’elle ait été progressive. Au contraire, Luc — lui-même médecin, ne l’oublions pas — insiste sur l’instantanéité de la guérison : « au même instant » pour le boiteux du temple (3.7), « aussitôt » pour le miracle de jugement sur Élymas (13.11), « d’un bond » pour l’impotent de Lystre (14.10), etc.
Les miracles font parfois plus que rétablir la situation antérieure
Pour plusieurs des miracles détaillés rapportés dans les Actes, la guérison opérée allait bien au-delà du rétablissement d’une fonction existante jusque-là et devenue inopérante du fait de la maladie. Dieu « reconstruit » ce qui n’avait jamais existé : comme pour l’aveugle-né de l’Évangile (Jean 9.1), il permet que l’infirme de Lystre, « boiteux dès le ventre de sa mère (litt.) et qui n’avait jamais marché » (14.8) acquière une faculté qu’il n’avait jamais eue. La durée du handicap renforce l’extraordinaire d’un miracle : « L’homme qui avait été l’objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans »,
insiste Luc à propos du boiteux du temple (4.22).
Les miracles visent avant tout à ouvrir la porte à la prédication de la Parole
Les guérisons et les exorcismes ne sont pas une fin en soi. S’ils apportaient pour les personnes concernées un soulagement ô combien bienvenu aux conséquences du péché, ils avaient avant tout pour but de préparer les spectateurs à l’écoute de la prédication de la Parole.
• Les apôtres demandent à Dieu de donner à ses serviteurs d’annoncer sa parole avec une pleine assurance, en étendant sa main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de son saint serviteur Jésus, mais c’est pour pouvoir annoncer « la parole de Dieu avec assurance » (4.29-31).
• Les miracles d’Étienne ont ouvert des discussions et au même moment la parole de Dieu se répandait de plus en plus (6.7).
• Ceux de Philippe rendent les foules attentives à ce qu’il disait (8.6,10).
• Le proconsul « voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur »… plus encore que par la cécité de son faux-prophète de conseiller (13.12)
• L’objectif des signes opérés par les apôtres n’est jamais plus clair que dans l’épisode d’Icone : « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu’il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles » (14.3). Ces derniers sont là pour appuyer la prédication, jamais pour la remplacer.
Jamais personne ne sera sauvé par un miracle, si grand soit-il (cf. Luc 16.31). La foi ne vient que de la parole du Christ (Rom 10.17). Un miracle accrédite le porteur de la parole en transformant temporairement les corps, mais seule la prédication authentique de la Parole de Dieu opère une transformation éternelle des cœurs.
Les miracles sont une anticipation du ciel
Ce magnifique déploiement de la puissance miraculeuse de Dieu en guérisons, en rétablissements, en délivrances, est un avant-goût du rétablissement total que l’introduction du royaume éternel de Christ produira. Tous les bénéficiaires de ces démonstrations surnaturelles sont morts, et, entre-temps, ont pu connaître à nouveau la maladie, le handicap. Un jour, la transformation sera définitive, dans des corps et des esprits à jamais délivrés des conséquences du péché. Entre-temps — et c’est ce dont témoigne le livre des Actes — l’évangile a commencé à être prêché avec puissance à partir de Jérusalem (1.8) et s’est étendu jusqu’aux bouts de la terre. Les miracles ont joué leur rôle, gloire en soit rendue à Dieu !
Les miracles s’estompent ?
La lecture cursive du livre des Actes suggère une diminution de la fréquence des miracles. Nombreux aux débuts de l’Église à Jérusalem ou lors des premières annonces de l’évangile en Samarie, au sud-ouest de la Judée, en Asie mineure ou à Éphèse, nous n’en voyons plus lors de la dernière montée de Paul à Jérusalem, ou lors de ses séjours à Césarée ou à Rome.
Le dernier relaté se situe sur une île non encore atteinte jusque-là par la bonne nouvelle, Malte (28.3-9). Il semble que les signes prodigieux aient eu pour but premier d’ouvrir la porte à l’évangile de Jésus-Christ dans les endroits où il était prêché pour la première fois. Une fois celui-ci installé et connu, l’activité miraculeuse s’estompe.
Les « testaments » des deux principaux thaumaturges du livre des Actes, Pierre et Paul (2 Pierre et 2 Timothée), sont muets sur les miracles : aucun appel à opérer des signes spectaculaires, aucune suggestion de prier pour recevoir la capacité de le faire, même pas la plus petite allusion aux grands prodiges qu’ils avaient opérés ou vus dans le passé.
Au contraire, les deux apôtres insistent sur les souffrances à supporter patiemment, sur l’endurance à démontrer dans les épreuves. Ils exhortent à espérer dans la délivrance, mais la renvoient au retour du Seigneur.
En conclusion, rappelons que l’activité miraculeuse du temps des Actes des apôtres témoigne d’une situation historique donnée, qui ne s’est, par définition, jamais reproduite. Dans la suite de l’histoire de l’Église jusqu’à aujourd’hui, les situations ont varié considérablement en fonction des époques et des lieux. Si pertinents que soient les critères relevés dans cet article, nous ne pouvons pas en déduire que toute action miraculeuse les remplisse nécessairement. Dieu est et restera souverain !
Parmi les termes caractéristiques de l’Évangile selon Luc figure le mot « pécheur »32. Les spécialistes hésitent sur le sens exact que recouvrait ce terme à l’époque ; il pourrait désigner :
– soit toute personne qui ne respectait pas strictement la loi et les traditions des pharisiens ;
– soit quelqu’un connu publiquement pour son immoralité ou pour sa profession honteuse — d’où la fréquente association des « pécheurs » avec les collecteurs d’impôts et les prostituées. Quoi qu’il en soit, un « pécheur » était méprisé, rejeté, stigmatisé par les bien-pensants religieux de l’époque. Or ce sont ces pécheurs que Jésus va fréquenter, attirer et sauver.
Nous sommes tous convaincus que Jésus est notre modèle (cf. 1 Pi 2.21) ; mais notre comportement est bien souvent plus proche de celui des pharisiens que de celui du Maître ! Au travers de cinq récits de l’Évangile, cherchons à débusquer les failles de nos raisonnements et de notre conduite.
1. Le festin chez Lévi
(Luc 5.27-32) : Jésus fréquente les pécheurs
À peine a-t-il entendu l’appel de Jésus que Lévi, le collecteur d’impôts, fête ce changement en organisant un grand festin auquel il convie ses proches. Et la polémique ne tarde pas à éclater avec les pharisiens !
- Selon leurs détracteurs, Lévi n’aurait pas dû faire un festin, ni Jésus y participer : notre conception de la pureté nous conduit volontiers à refuser de participer à certaines activités jugées mondaines et à cultiver une séparation stricte d’avec ceux que nous considérons comme des pécheurs33. Peut-être n’en avons-nous jamais invité chez nous ; peut- être avons-nous toujours refusé d’être invités chez eux; peut-être même ne sommes-nous proches personnellement d’aucun. Alors comment auront-ils accès à l’évangile si tous les chrétiens se détournent d’eux (cf. Rom 10.14) ?
- l Les pharisiens s’adressent aux disciples de Jésus et non pas directement à lui : qu’il est tentant de parler entre nous des mœurs peu recommandables de tel ou tel pour les pointer du doigt !
- Les pharisiens sont bien d’accord que les pécheurs du festin sont « malades ». Or Jésus est précisément venu pour ces personnes- là. Si notre propre justice nous suffit, nous n’intéressons pas Jésus.
2. La femme chez Simon (Luc 7.36-50) : Jésus regarde une pécheresse
Elle n’était pas la bienvenue dans la maison du pharisien Simon, cette femme de mauvaise vie !
Mais elle réussit à s’introduire et s’occupe de rendre à Jésus les égards que l’hôte orgueilleux a négligés. Jésus « répond »34 alors aux critiques que Simon se fait intérieurement par une petite histoire et une invitation.
- Par son histoire, le Seigneur demande au pharisien de comparer les situations de deux débiteurs. Nous aimons tellement « quantifier » le péché et « estimer »35 qui est le plus pécheur — en oubliant que nous sommes tous endettés !
- Par son invitation, Jésus dit à Simon de « regarder » la pécheresse. Quel regard porté-je sur ce couple ho- mosexuel assis en face de moi dans le train ? sur l’amie qu’une fille de l’église a invitée et qui détonne avec ses cheveux teints en bleu et ses piercings ? sur ce voisin que sa femme a quitté parce qu’il a eu une liaison extra-conjugale ?
Un regard de méfiance, de rejet, de jugement ? ou bien un regard comme celui de Jésus qui a fait fondre le cœur de l’invitée surprise ?
Simon n’a rien donné à Jésus — ni eau, ni baiser, ni huile. Un cœur sec juge et ne donne pas. Un cœur rempli d’amour donne, à l’image de Dieu (Jean 3.16).
3. Les paraboles de Luc 15 : Jésus va chercher le pécheur
« Tous les collecteurs d’impôts et les pécheurs s’approchaient de Jésus pour l’écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant : Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux » (Luc 15.1-2, S21).
Les bien-pensants religieux reprochent à Jésus « d’accueillir des pécheurs » ! Peut- être auraient- ils voulu que ces derniers se mettent à suivre la loi avant de venir écouter Jésus ? Peut-être aimerions-nous accueillir dans nos églises des personnes qui ont déjà renoncé à leur inconduite sexuelle, qui ont déjà mis leur vie en ordre comme nous le pensons. Mais les pécheurs doivent d’abord « s’approcher pour écouter », tels qu’ils sont, avec leur vie en désordre, pour que Jésus les trouve et qu’ensuite leur vie puisse changer progressivement.
C’est dans ce contexte que Jésus énonce trois paraboles qui, de fait, n’en font qu’une : celle de la brebis perdue, celle de la drachme perdue et celle du fils perdu — pour reprendre les titres de la Bible Segond NEG. Mais à qui Jésus s’adresse-t-il vraiment ? À qui affirme-t-il qu’il y a de la joie dans le ciel et devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent ? Aux pharisiens, d’abord et non aux collecteurs d’impôts ou aux pécheurs ! Et à qui s’adresse la troisième parabole souvent si mal nommée36 ? À ces mêmes pharisiens auquel le fils aîné ressemble si bien… et à nous-mêmes si fiers de « n’avoir jamais transgressé » les commandements de Dieu (cf. 15.29). Alors réjouissons-nous sans arrière-pensée dès que quelqu’un dont le style de vie nous déplaît commence à « s’approcher pour écouter » : Jésus est en train de le chercher !
4. La parabole du pharisien et du publicain (Luc 18.9-14) : Jésus ne méprise pas le pécheur
Pour enfoncer le clou et essayer de les toucher enfin, Jésus raconte encore une parabole « à l’intention de certaines personnes qui étaient convaincues d’être justes et qui méprisaient les autres » (Luc 18.9, Segond 21). C’est la fameuse parabole du pharisien et du publicain. Quel mépris chez ce pharisien pour « le reste des hommes », qualifiés de « voleurs, injustes, adultères » ! Dieu, par contraste, est trop puissant pour mépriser qui que ce soit (Job 36.5). Jésus accueille « quiconque » se reconnaît comme un pécheur.
En lisant cette parabole, nous nous mettrons spontanément plutôt dans la peau du publicain justifié que du pharisien. Après tout, nous sommes héritiers de la Réforme et pleinement persuadés du « sola gratia »une parabole « à l’intention de certaines personnes qui étaient convaincues d’être justes et qui méprisaient les autres » (Luc 18.9, Segond21). C’est la fameuse parabole du pharisien et du publicain. Quel mépris chez ce pharisien pour « le reste des hommes », qualifiés de « voleurs, injustes, adultères » ! Dieu, par contraste, est trop puissant pour mépriser qui que ce soit (Job 36.5). Jésus accueille « quiconque » se reconnaît comme un pécheur.
En lisant cette parabole, nous nous mettrons spontanément plutôt dans la peau du publicain justifié que du pharisien. Après tout, nous sommes héritiers de la Réforme et pleinement persuadés du « sola gratia »37. Et pour illustrer le cas du pharisien, qui se croit tellement juste et qui s’entend reprocher sa piété légaliste, de multiples. Et pour illustrer le cas du pharisien, qui se croit tellement juste et qui s’entend reprocher sa piété légaliste, de multiples noms nous viendront à l’esprit… Mais nos fortes convictions, notre bonne morale, même notre assurance du salut par grâce, peuvent former une carapace de « bon chrétien évangélique » et nous conduire à mépriser les « autres », ceux « du dehors ». Or la vraie piété ne peut pas s’inscrire en opposition avec les autres hommes, si pécheurs ou si pétris de doctrines imparfaites (voire fausses) qu’ils puissent nous paraître.
Mais nous pouvons aussi développer une attitude ouverte vis-à-vis des autres, être attentifs à eux, les écouter… Et tout au fond, une petite voix va alors nous susurrer : « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce frère de mon église, qui est un peu borné, sûr d’avoir raison. Moi, je suis ouvert, je m’intéresse aux autres, je les accueille tels qu’ils sont… » Ainsi, plus nous croyons échapper à la pointe de cette parabole, plus elle nous ramène à nous-mêmes. Il faut accepter le constat : le pharisien, au fond, c’est moi ! Il me faut descendre de mon piédestal (y compris celui de mon humilité, souvent si fausse), pour prendre vraiment la place du publicain. Non pas en justifiant le mal (le publicain ne se vante pas de son péché, mais le reconnaît devant Dieu), mais en recevant la grâce de Dieu, qui nous détourne de nous-mêmes.
5. L’invitation chez Zachée (Luc 19.1-10) : Jésus est accueilli par un pécheur
Ce cinquième épisode amplifie le message des précédents : ce n’est plus un pécheur, mais un « pécheur en chef » : Zachée dirigeait les collecteurs de taxes ; et ce ne sont plus les seuls pharisiens qui murmurent contre le comportement de Jésus, mais « tous » (19.7). Implicitement, le récit ouvre plusieurs questions :
- l Zachée peut-il être sauvé ? Oui, répond Jésus, « celui-ci est aussi un fils d’Abraham ». Toute personne, même celle que nous jugerions a priori la plus éloignée du salut, a accès par la foi à la bénédiction du croyant Abraham. Comme l’exprime un ancien cantique, « il n’est personne qu’il veuille écarter du salut ». Soyons-en persuadés !
- Zachée peut-il accueillir Jésus ?
Oui, c’est même le Seigneur qui le lui demande. Il ne vient pas seule- ment sauver le pécheur, mais il veut « demeurer » chez lui, avec toute la riche palette de sens de ce verbe, si fréquent dans la bouche de Jésus. Lorsque quelqu’un extérieurement éloigné de la foi se tourne vers Christ, il peut nous arriver d’être dubitatifs : n’est-ce pas qu’un feu de paille ? cette foi nouvelle sera-t-elle durable ? Oui, car quand Jésus fait sa demeure dans une âme, c’est pour l’éternité et ce- lui qui a commencé une bonne œuvre la rendra parfaite (Phil 1.6). - Zachée peut-il vraiment changer ? Oui, et il le prouve, en prenant immédiatement des résolutions qui vont bien au-delà des exigences de la loi. Ce voleur de collecteur devient donateur! Nous pensons, à tort, que certaines mauvaises habitudes sont indéracinables. Si l’œuvre de sanctification de l’Esprit dans chaque croyant est progressive, certains changements peuvent être rapides. L’amour « espère tout » !
* * *
« Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs » (7.34, Darby). Jésus se décrit ainsi, rapportant les propos qu’on tient sur lui. Comment me qualifie-t-on ? comme un ami des fêtards et des transgenres ? un ami des dealers et des homosexuels ? La question sonde en premier lieu l’auteur de ces lignes. Le Seigneur nous appelle avant tout à un changement intérieur. Un changement sur la façon dont nous considérons ceux que nous jugeons être des « pécheurs » et sur la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, si confiants dans notre propre justice. Ce changement, son Esprit peut le produire en versant son amour en nous mais il nous incombe aussi de le rechercher. Alors nous serons davantage semblables au Maître, qui était à la fois « séparé des pécheurs » (Héb 7.26) et « l’ami des pécheurs ».
- Le terme grec « amartolos » figure 18 fois dans Luc contre 5 fois dans Matthieu, 6 fois dans Marc et 4 fois dans Jean.
- Notons que Luc les désigne simplement comme « d’autres personnes » (5.29).
- Le verbe traduit par « prit la parole » (NEG, BFC) peut aussi être traduit par « répondit » (Darby, BS).
- C’est ainsi que Darby traduit le verbe hypolambano.
- L’appellation la plus fréquente est « la parabole du fils prodigue ».
D’autres la nomment « la parabole des deux fils » ou « la parabole du père admirable ». Tim Keller a trouvé un titre magnifique pour son livre, Le Dieu prodigue (Éd. La Maison de la Bible, 2013), dont nous recommandons chaudement la lecture. - « Par la grâce seule » : cette locution latine est une des cinq par lesquelles on résume parfois l’enseignement de la Réforme protestante ; elle signifie que le pécheur est sauvé par la seule grâce de Dieu et non pas par des œuvres méritoires.
Timothée était un enfant d’un mariage « mixte » : son père était grec et sa mère juive croyante (Act 16.1). Sa mère et sa grand-mère l’avaient instruit dans l’A.T. (2 Tim 3.15). Converti à Jésus-Christ lors du premier voyage missionnaire de Paul (vers l’an 47), sans doute dans son adolescence, il avait rapidement grandi dans la foi.
Lors de son deuxième voyage (vers l’an 50), Paul l’associe à Silas et lui pour poursuivre sa mission. Ce point de départ est la conjonction d’un don personnel (1 Tim 4.14 ; 2 Tim 1.6), de prophéties spécifiques (1 Tim 1.18), d’un témoignage préalable favorable des deux églises de la région et du discernement propre de Paul (Act 16.2-3). L’appel à un service est bien souvent la résultante de diverses circonstances, rencontres, paroles reçues, textes bibliques… Quand ces indications concordent, comme ce fut le cas pour Timothée, la confiance dans l’appel reçu s’en trouve renforcée.
Timothée va rapidement devenir le collaborateur le plus proche de Paul qui lui confiera une série de missions.
Au travers de celles-ci, nous pourrons trouver plusieurs enseignements utiles sur la collaboration entre un chrétien plus âgé et un plus jeune.
Thessalonique (50) :sa première mission
Le contexte de la première mission
Le deuxième voyage missionnaire de Paul, accompagné de Silas et Timothée, continue. Avant de passer en Europe, ils s’adjoignent Luc puis ils vont évangéliser Philippes avant d’aller à Thessalonique, un port très actif sur la mer Égée. Paul poursuit ensuite vers Athènes mais il est inquiet des oppositions dont sont victimes les jeunes chrétiens de Thessalonique.
L’objectif de la première mission
C’est alors que Paul leur envoie Timothée. Par lui, l’apôtre veut affermir et encourager les Thessaloniciens au sujet de leur foi (1 Thes 3.2). Chrétiens depuis quelques mois seulement, devant faire face à des persécutions, ils ont besoin d’être fortifiés et exhortés.
L’attitude de Timothée
Elle est courageuse : il n’hésite pas à retourner à Thessalonique, un endroit dangereux où des Juifs fanatiques sont prêts à utiliser tous les expédients pour se débarrasser des chrétiens (Act 17.5-9 ; 1 Thes 2.14-16). Le courage pour affronter des difficultés est la marque d’un fidèle serviteur de Dieu (2 Cor 6.4-10).
Timothée ne montre pas de fausse modestie pour un « débutant » de seulement… 20 ans38 ! Paul n’hésite pas à confier au jeune Timothée un rôle important. Qui, aujourd’hui, oserait envoyer un jeune, converti depuis quatre ans, dans un endroit où les chrétiens sont persécutés, avec la tâche d’enseigner et encourager l’église ?
Le résultat de la première mission
De retour auprès de Paul, qui, entre temps, s’est déplacé jusqu’à Corinthe, Timothée lui donne de bonnes nouvelles des Thessaloniciens.
Paul prolonge le travail que son collaborateur a effectué en rédigeant deux lettres à destination des Thessaloniciens et il n’hésite pas à associer Timothée comme co-rédacteur (1 Thes 1.1 ; 2 Thes 1.1). Quel honneur pour ce jeune chrétien ! Si nous avons quelque responsabilité dans l’église, n’hésitons pas à nous associer et à valoriser de plus jeunes qui ont montré de l’intérêt et du potentiel.
Corinthe (54) :sa deuxième mission
Le contexte de la deuxième mission
Nous retrouvons Timothée à Éphèse quelques années plus tard, où il travaille avec Paul. L’apôtre s’est établi dans cette ville, la 5e en importance de l’Empire romain, au début de son troisième voyage missionnaire. De là, Timothée est envoyé en Macédoine, puis à Corinthe avec Éraste.
L’objectif de la deuxième mission
Les nouvelles de Corinthe reçues par Paul n’étaient pas encourageantes. L’église était secouée par des dissensions internes, des désordres moraux, des fausses doctrines… Timothée doit rappeler l’exemple et l’enseignement de Paul : « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j’enseigne partout dans toutes les églises » (1 Cor 4.16-17). Une mission délicate sur un terrain où l’apostolat de Paul est contesté.
L’attitude de Timothée
Les chrétiens de Corinthe ne sont pas des tendres ! Paul lui-même en fera les frais lors d’une visite-éclair quelque temps après. Aussi peut-on comprendre que Timothée soit craintif devant cette mission très délicate. La Première Épître a dû précéder de peu son arrivée et Paul avertit les Corinthiens : « Si Timothée arrive, faites en sorte qu’il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme m o i à l ’œ u v r e du Seigneur. Que personne donc ne le méprise.
Accompagnez- le en paix, afin qu’il vienne vers moi, car je l’attends avec les frères » (1 Cor 16.10-11). Bel exemple d’un chrétien plus âgé qui recommande un plus jeune et assoie son ministère.
Le résultat de la deuxième mission
Ni Paul ni Luc ne donnent les résultats de la mission de Timothée, sans doute par délicatesse, car tout laisse à penser qu’elle n’a pas été un plein succès… En effet, les désordres continuent et Paul doit envoyer ensuite Tite (2 Cor 2.12). Paul néanmoins garde sa confiance à Timothée et l’associe dans la rédaction de la Seconde Épître aux Corinthiens (2 Cor 1.1). Un échec relatif ne disqualifie pas un serviteur !
Philippes (62) :sa troisième mission
Le contexte de la troisième mission
Timothée continue d’accompagner Paul dans son voyage de retour vers Jérusalem avec la collecte (Act 20.4), ce qui témoigne de sa rigueur sur les questions matérielles. Nous le retrouvons ensuite aux côtés de Paul, lors de son premier emprisonnement à Rome et il cosigne les lettres aux Colossiens, à Philémon et aux Philippiens. Belle marque de sa fidélité envers son mentor !
Puis Paul confie à Timothée une troisième mission : il l’envoie « en éclaireur », car il espère être bientôt libéré et revoir les frères et sœurs à Philippes.
L’objectif de la troisième mission
C’est essentiellement un échange de nouvelles : pour Paul, avoir des nouvelles des chrétiens à Philippes et pour eux, en recevoir de Paul : « J’espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d’être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne » (Phil 2.19).
L’attitude de Timothée
Le choix de Timothée est lié à son intérêt personnel pour les Philippiens : « Je n’ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation ; tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ » (Phil 2.20-21). Un père spirituel encouragera non seulement son enfant spirituel à approfondir la doctrine, mais aussi à s’intéresser aux personnes. Les « intérêts de Jésus-Christ » sont ceux des siens !
Le résultat de la troisième mission
Rien n’en est dit, mais le contexte relativement paisible de l’église à Philippes laisse penser que Timothée a pu y être bien reçu.
Éphèse (65) :sa quatrième mission
Le contexte de la quatrième mission
Paul, libéré, retourne sur le bassin de la mer Égée et en particulier à Éphèse où les hérésies se développent. Pour des raisons inconnues, Paul part d’Éphèse et y laisse Timothée pour mettre de l’ordre dans la vie pratique de l’église.
L’objectif de la quatrième mission
Timothée doit avant tout arrêter les mauvaises doctrines et apporter un sain enseignement : « Je te rappelle l’exhortation que je t’adressai à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines » (1 Tim 1.3).
L’attitude de Timothée
À 35 ans, Timothée se retrouve seul dans cette église où Paul avait enseigné pendant trois ans. Si on en juge à la lettre que l’apôtre a envoyé trois ans auparavant depuis sa prison de Rome, le niveau de connaissances spirituelles à Éphèse semble assez élevé. Pour crédibiliser le ministère de Timothée, Paul lui demande avant tout de susciter l’amour, dans une église qui commence à le perdre : « Le but de cette recommandation, c’est un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère » (1 Tim 1.5). L’amour est la priorité de tout service : Timothée l’a vu chez Paul (2 Tim 3.10) et il doit maintenant être « un modèle […] en amour » (1 Tim 4.12). Montrons à ceux qui nous suivent un amour vrai pour le Seigneur et pour son Église — c’est-à-dire pour chaque frère et sœur.
Le résultat de la quatrième mission (65-67)
La mission confiée par Paul est plutôt un échec : la comparaison entre 1 et 2 Timothée montre que la situation à Éphèse a bien empiré en deux ans. L’apôtre encourage alors Timothée par une seconde lettre à ne pas perdre courage et à persévérer dans son service : « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ » (2 Tim 2.1). Timothée a besoin de la grâce de Dieu pour lui-même et pour la communiquer à d’autres. Même si le contexte est difficile, continuons à prêcher la grâce et encourageons les autres à en faire autant.
Tout service, fructueux ou non, est une grâce reçue par Dieu et doit apporter la grâce à ses bénéficiaires. Toutefois, une stimulation est parfois bienvenue : « Je t’exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu », dit Paul à Timothée au début de sa seconde lettre (2 Tim 1.6), puis il développe cette exhortation par les multiples impératifs qui la parsèment.
Timothée obéit à Paul qui lui demande de le rejoindre à Rome pour être à son côté dans les derniers moments de sa vie (2 Tim 4.9,21). L’affection qui relie le vieil apôtre et son disciple transparaît de façon touchante. Timothée a sans doute été lui-même emprisonné à Rome quelque temps (Héb 13.23) et, selon la tradition, il est revenu à Éphèse où il est mort martyr vers 97. Une belle fidélité à la mission reçue trente ans auparavant !
Peu de relations maître-disciple dans le N.T. nous sont aussi connues que celle de Paul avec Timothée. Cette riche filiation spirituelle particulière nous montre :Peu de relations maître-disciple dans le N.T. nous sont aussi connues que celle de Paul avec Timothée. Cette riche filiation spirituelle particulière nous montre :
- un chrétien mature qui sait repérer du potentiel chez un plus jeune ;
- un « père » qui ne ménage pas son « enfant » mais lui confie, même très tôt, des missions importantes ;
- un croyant reconnu qui s’associe un plus jeune dans son service, en particulier épistolaire ;
- un mentor qui donne un droit à l’échec ;
- un exemple de souci des âmes, de recherche de la vérité et de persévérance jusqu’au bout ;
- un ami de cœur, au-delà de la différence d’âge.
Un bel exemple à prolonger dans nos églises !
Articles par sujet
abonnez vous ...
Recevez chaque trimestre l’édition imprimée de Promesses, revue de réflexion biblique trimestrielle qui paraît depuis 1967.

