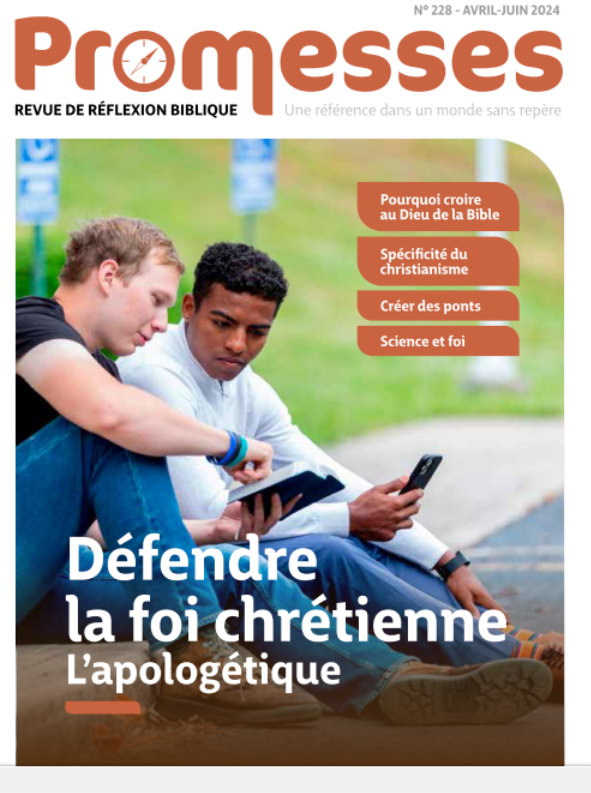Comment réussir à défendre notre foi chrétienne de manière pertinente et adaptée à notre auditoire ? On se voit proposer des « masterclass » partout sur internet ; le principe est simple : un expert dans une discipline nous partage son art et son expérience, dans le but de nous inspirer à sa suite. L’apôtre Paul est assurément un maître en matière d’apologétique. Son discours devant les Athéniens en Actes 17 reste la masterclass la plus inspirante qu’il nous ait laissée. Il réussit à établir un lien avec son public sans diluer la vérité, et à présenter l’Évangile sans abandonner la raison. Parcourons ce discours en essayant de tirer de chaque argument quelques clés applicables à l’évangélisation dans notre contexte.
Pont culturel, religieux ou philosophique (v. 22-23, 28b)
Paul commence par s’intéresser à la culture et à la religion des Athéniens avant de leur témoigner sa foi. Il est d’abord choqué par leur idolâtrie (v. 16) et ne minimise pas sa gravité. Pour autant, il commence son discours à l’Aréopage en soulignant un point positif : ils sont très religieux ! Il mentionne avoir vu un de leurs autels
dédié « Au Dieu inconnu ». Par un coup de maître, il leur déclare que c’est précisément ce Dieu qu’il vient leur faire connaître ! Il cite ensuite un de leurs philosophes (v. 28), reconnaissant ainsi certaines valeurs dans leur vision du monde. Paul réussit ainsi à créer le lien avec ses auditeurs.
Il est primordial de rechercher le bien de celui à qui l’on s’apprête à témoigner de notre foi. Cet amour pour notre prochain devrait nous pousser à essayer de nous mettre à sa place. Il faut donc s’intéresser à son arrière-plan philosophique ou culturel. Quels sont les raisonnements qui peuvent l’empêcher de croire et comment peut-on l’aider à « renverser [ses] forteresses » intellectuelles ou spirituelles ? (2 Cor 10.4) Si je m’adresse à un athée, à un musulman ou à un bouddhiste, le moyen utilisé pour l’aider à « abaisser le pont levis » de son château cognitif ne sera pas le même.
Dieu créateur et cause première (v. 24-26)
L’apôtre des Gentils (non-Juifs) va ensuite décrire ce dieu inconnu aux Athéniens. Il le présente comme le Créateur du monde. Contrairement à leurs dieux, il est complètement autonome et transcendant sur sa création.
On peut avoir vite fait de sauter au message du salut sans avoir expliqué le rapport de Dieu avec notre terre et l’humanité, mais le message risque d’être bancal. Notre explication de l’origine du monde est pourtant bien plus raisonnable que les visions alternatives athées par exemple. Richard Dawkins et Stephen Hawking, deux célèbres scientifiques connus pour leur athéisme militant, ont déclaré qu’ils croyaient que l’univers pouvait s’être créé spontanément à partir du néant. La génération spontanée n’a jamais été constatée pour la moindre molécule ; affirmer alors que l’ensemble de l’univers soit le fruit de « rien » ressemble à un suicide intellectuel. A contrario, la nécessité d’une cause première semble s’imposer par le fait que l’univers n’est pas éternel. L’existence d’un être « nécessaire », éternel et immatériel ayant créé l’univers semble l’hypothèse la plus simple et intuitive. N’importe quel touriste qui regarde la Sagrada Familia 1 sait qu’un architecte de génie l’a d’abord pensée. À plus forte raison, la complexité et la beauté du monde révèlent le divin architecte (Rom 1.20).
Dieu accessible et relationnel (v. 27-28a)
Après avoir présenté un Dieu transcendant, Paul n’en reste pas à une vision déiste du monde qui plaît parfois aux philosophes. Il montre combien Dieu s’intéresse à sa créature et cherche à avoir une relation avec l’homme. Ce Dieu délicat n’impose pas la relation mais a laissé assez de preuves pour se laisser trouver.
Nous n’avons pas qu’une théorie à présenter aux personnes à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Si nous sommes « de la race » de Dieu, faits à son image, nous pouvons mettre au défi nos contemporains de lui demander de se révéler à eux !
Jésus a promis que « celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe » (Mat 7.8). Il ne manquera donc pas de se révéler à toute personne qui le lui demande sincèrement.
Réfutation logique de la position adverse (v. 29)
Une fois que le lien est établi avec l’auditeur, et que les fondements de la vision chrétienne du monde sont posés, Paul juge bon de réfuter logiquement le polythéisme des Athéniens.
Le pont culturel permet à notre interlocuteur d’abaisser de manière pacifique le pont levis de sa forteresse mentale. Après l’avoir franchi, sans utiliser de bélier qui serait contre-productif, il peut s’avérer nécessaire d’inspecter la tour du château. On peut montrer que ses fondations sont instables, comme celles de la tour de Pise. Il faut alors se concentrer sur les points susceptibles de freiner notre auditeur dans sa recherche de la vérité. Le but de l’échange n’est pas de casser la tour nous-même, mais de l’amener logiquement à reconsidérer l’aspect bancal de l’échafaudage de sa vision du monde. Ici encore, notre compréhension et notre réel intérêt pour la position adverse permettront de ne pas la caricaturer. Nous serons alors plus pertinents pour aider la personne à prendre du recul.
Une morale et une justice objectives (v. 30-31a)
Enfin, Paul se dirige vers le cœur de l’Évangile. Il montre que tous les hommes ont un problème avec le péché, qui nécessitera un jour le jugement de Dieu. Les hommes doivent se repentir et mettre leur confiance dans « l’homme qu’Il a désigné ».
Les Athéniens ne semblent pas trop perturbés par cette notion de repentance. Leur conscience, mise dans le cœur de tous les hommes par Dieu, les accuse certainement (Rom 2.15). Faire prendre conscience à l’autre qu’il est sous l’emprise de son péché, comme nous-mêmes, est un défi majeur de l’évangélisation. Réussir à le faire sans se positionner soi-même en juge, mais comme étant sous le même jugement, est une des clés pour ce faire.
L’argument de l’objectivité de la morale est aussi une preuve de l’existence de Dieu particulièrement intéressante pour nos contemporains. Dostoïevski a dit justement : « Sans Dieu, tout est permis. » 2 Des athées célèbres comme Nietzsche et Sartre ont repris à leur compte cette idée. En effet, il est logique de reconnaître que sans grand Arbitre, et sans « mètre étalon », la morale est affaire de subjectivité. Chaque individu devient sa propre référence. Comment mon voisin ou même l’État pourrait alors me dire ce qui est bien ? On voit bien que l’athéisme cohérent devrait pousser à une société sans norme morale, où règne la loi du plus fort. Heureusement, la plupart des athées ne sont pas cohérents sur ce point. Il n’en demeure pas moins que l’on peut questionner les gens sur la légitimité de l’éthique à géométrie variable de la société, qui évolue au gré des envies du peuple ou des dirigeants.
Une foi testable et historique (v. 31b)
Le discours se termine abruptement lorsque Paul affirme que Dieu a donné la « preuve certaine » de l’identité et de la mission de Jésus en le ressuscitant. La résurrection peut sembler irrationnelle d’un premier abord, c’est pourquoi la plupart des Athéniens arrêtent d’écouter et se moquent.
Si l’apôtre le plus habile en parole a été confronté à ce genre de réaction, attendons-nous à y faire face aussi. Pourtant, il n’y a rien d’irrationnel à croire dans la résurrection. S’il existe un Dieu créateur, il n’y a rien d’illogique au fait qu’il puisse suspendre les lois qu’il a lui-même décrétées. C.S Lewis a très bien défendu rationnellement ce point dans son livre Miracles. De plus, les théories imaginées par les historiens athées pour essayer de contourner la résurrection de Jésus ont un degré de probabilité quasi nul. L’hypothèse de l’hallucination collective des disciples n’est pas tenable : les médecins décrivent le phénomène d’hallucination comme étant individuel. Des centaines de personnes ne peuvent décrire la même hallucination avec des détails si précis. Même des opposants à Christ comme Paul ont vu Jésus ressuscité, alors que ça ne les arrangeait pas ! L’hypothèse d’un mensonge des disciples n’a pas de sens non plus : les chrétiens ne se seraient pas laissé persécuter et tuer dès le commencement de l’Église pour un mensonge inventé consciemment ! 3
Les fruits du discours (v. 34)
Comme Paul, nous devons être prêts à défendre notre espérance (1 Pi 3.15). Si ce discours magistral semble avoir eu moins d’impact que celui de Pierre en Actes 2, il a quand même convaincu plusieurs personnes, dont Denys un responsable de l’aréopage qui avait dû entendre toutes les écoles de pensées de l’époque.
Comme l’apôtre, faisons tous nos efforts pour que notre message soit délivré de manière fidèle et adaptée à l’auditeur. Les résultats ne nous appartiennent pas, Dieu poursuivra le travail dans les cœurs.
- Une célèbre basilique de Barcelone dont l’architecte est Antoni Gaudi.
- Paroles condensées de Mitia (Dimitri) dans Les frères Karamazov de Dostoïevski, 4 e partie, Livre XI, chapitre 4.
- Voir Lee Strobel, Jésus l’enquête, Vida, 2015, pour plus d’arguments sur l’historicité de la mort et de la résurrection de Jésus.