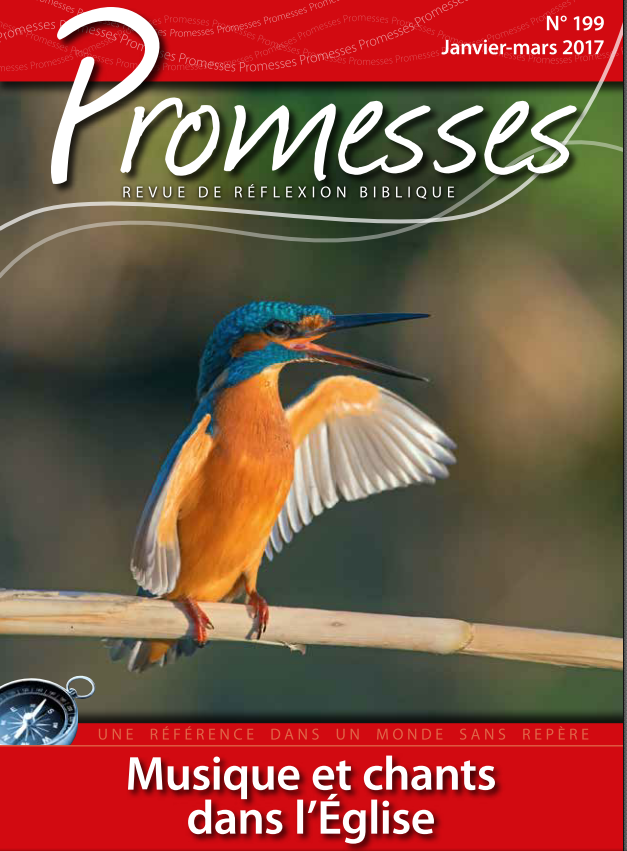1-Les cantiques des premiers chrétiens
Ils étaient inspirés des récits et des enseignements de l’Évangile. Le N.T. s’ouvre par un hymne merveilleux, le Magnificat, dans lequel Marie exalte le Seigneur pour sa grâce imméritée (Luc 1.46-55). De même, lors de la naissance du Sauveur, s’éleva le Gloria :« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » (Luc 2.14) Ces poèmes, qui s’insèrent dans la tradition prophétique juive, ont sûrement été chantés, comme ils l’ont été d’ailleurs pendant des siècles par les chrétiens.
2-Les témoignages des anciens Pères de l’Église
Les anciens Pères de l’Église, Origène, Chrysostome, Clément d’Alexandrie, et Pline, écrivain latin, ont beaucoup insisté sur la valeur du chant des chrétiens. C’était sans doute comme une cantilène, c’est-à-dire un chant sans mesure exacte et sans rythme marqué, un genre de récitatif accentué, où la voix parlée et la voix chantée se confondaient. Les paroles du chant étaient de beaucoup sa partie la plus importante.
Chrysostome raconte que, dans les premiers jours de l’Église, comme encore de son temps, toutes les voix s’unissaient :« Les hommes, les femmes, les vieillards, les jeunes gens ne se distinguent que par leur manière de chanter, car l’Esprit qui dirige la voix de chacun fait de toutes ces voix une seule mélodie. »
3-Au IVe siècle
C’est Ambroise de Milan qui introduisit, dans le chant d’église, les lignes mélodiques égales, correspondant à un même nombre de pieds. Sylvestre 1er, vers l’an 320, fut le premier à fonder une école où l’on formait des chantres. De nombreux cantiques datent de cette époque, plus remarquables par les paroles que par la musique, à peine digne de ce nom.
Jusque-là, les églises apostoliques ne firent pas, ou ne purent pas faire, l’usage d’instruments de musique dans leur culte. On en trouve la raison dans les circonstances de ces temps-là :
– leur pauvreté,
– l’hostilité toujours éveillée de leurs ennemis,
–le fait surtout que la musique était associée aux mœurs et aux cérémonies païennes (dans les temples des faux dieux), aux fêtes populaires (cirque), au théâtre.
Par la suite, leur situation ayant complètement changé, les églises introduisirent la musique instrumentale, qui avait déjà rempli une place considérable dans le culte de l’ancienne alliance.
4-Les cantiques dans l’Église chrétienne avant le Moyen Âge
L’Église des premiers siècles chantait d’abord les Psaumes, puis avec eux les cantiques inspirés par l’Évangile et par les expériences religieuses des croyants. Le grand avantage des Psaumes était d’offrir un texte dont on pouvait être sûr qu’il plairait à Dieu, puisqu’il l’avait inspiré. Les progrès du chant commencent donc avec Ambroise, le pieux évêque de Milan, persécuté en 386. Augustin lui-même, fut vivement impressionné par ce chant encore très simple, que des voix nombreuses et puissantes rendaient majestueux :
« Ô Christ, tu es le vrai rayon qui dissipe les ténèbres.
Tu es le divin rayon et l’heureux éclat de la véritable lumière.
Toi qui es aussi le bouclier de notre âme.
Ne nous abandonne pas, ô Seigneur Jésus Christ. »
Le chant sacré subit son premier grand changement lorsqu’il cessa d’être l’accord des croyants de tous âges et de tout rang. Il fut alors réservé aux seuls choristes. Le mode dit « grégorien »est devenu le chant traditionnel de l’Église dès la fin du vie siècle. Sa caractéristique essentielle est le plain-chant, égal et uni. En 1903, Pie X, en les restaurant, les appela « Chants grégoriens », nom du pape Grégoire le grand (590-604) dont l’influence fut immense durant le Moyen Âge. On fait remonter à ce pape la paternité et la haute et active direction du chant liturgique. Le chant grégorien est conçu sans substrat harmonique, ou trame polyphonique ; il est une mélodie pure, monodique, c’est-à-dire à l’unisson, sans chromatisme, avec, entre les notes, des intervalles des plus simples et des plus naturels. Grégoire 1erl’introduisit :
– soit par besoin d’unité, pour donner à toutes les églises le même rite et le même chant,
– soit pour relever l’importance du chant en en faisant l’apanage des prêtres seuls,
– soit qu’il estimât les mélodies trop mondaines et qu’il voulût réduire la musique d’église à n’être plus qu’une harmonie.
Ce fut le plain-chant, qui fut pratiqué douze siècles durant.
Dès le ive siècle, au début du Moyen Âge, l’essor de la musique est conséquence de la constitution de communautés monastiques. Les moines, dont plusieurs sont de très bons musiciens, créent le plain-chant déjà mentionné. Le répertoire est très divers, montrant l’existence de plusieurs styles de chant grégorien.
Dès le viiie siècle, il y a un grand essor de la musique. Les créations de style monastique sont exécutées par des spécialistes, des chantres. La musique est au service de la liturgie.
5-Au Moyen Âge
Le Moyen Âge, qui a privé le peuple du Livre saint, lui a aussi ôté la joie de chanter, car le cantique a toujours résonné là où la Bible était ouverte. Malgré cela, les couvents, qui eurent leur grande utilité pour la transmission des Saintes Écritures, jouèrent un rôle important en musique : ils abritèrent souvent des poètes et des musiciens. En ces siècles enténébrés, il y eut peu de réveil de la piété ; tous les chants étaient en latin, donc incompréhensibles à la majorité du peuple.
Mais durant cette longue période de nuit, se détachèrent quelques vives clartés : de grandes figures chrétiennes qui nous ont laissé des hymnes d’une grande beauté, connus encore aujourd’hui :
- Bernard de Clairvaux (1091–1153) a laissé plusieurs chants, dont « Chef couvert de blessures » ;
- François d’Assise (1182–1226) « le chanteur de Dieu, le vrai troubadour » ;
- Jérôme Savonarole (1452–1498), de Florence, « le réformateur par les enfants » qui chantait pour faire abandonner le carnaval florentin et qui mourut en martyr ;
- John Wyclif, (1331–1384), le prédicateur évangélique d’Oxford ;
- Jan Hus (1369–1415), le réformateur de Bohême et de Moravie, à qui l’on doit le rétablissement de la vérité évangélique et une réforme du chant chrétien, avec l’introduction du chant de tous les fidèles ; il marcha à la mort en chantant.
6-Dès la fin du Moyen Âge
Avec des compositeurs comme Josquin des Prés ou van Berchem, la musique va devenir un ornement. Ce mouvement s’accentuera avec la Renaissance.
Au début du xvie siècle, il y a un débordement de musique à tendance figurée, représentative, théâtrale. L’Église a peur. Dès le concile de Trente, en 1560, l’Église va s’occuper de musique pour chercher à la purifier, à la protéger d’une certaine mollesse, d’un certain luxe. Elle sollicitera Palestrina à produire une musique qui serait exemplaire. C’est la fameuse Messe du pape Marcel. Mais bien après le concile, on va déborder à nouveau, par exemple avec Monteverdi.
7-La musique protestante
Les changements de la Réforme
Le développement de la polyphonie vocale atteignit son apogée à la Renaissance (xvie siècle), « l’âge d’or de la polyphonie ». La musique dans l’Église catholique romaine restait alors entièrement contrôlée par le clergé, et la congrégation, devenue de ce fait auditrice, restait à l’écart de toute participation possible.
Un des principes de base de la Réforme est le sacerdoce universel, c’est-à-dire que chaque croyant est sacrificateur et peut s’adresser directement à Dieu, a trouvé dans le chant l’une de ses expressions majeures. À côté de Luther qui, lui, a transformé des hymnes latins et composé de la musique, Calvin avait une autre position : il était centré sur l’Ancien Testament, de sorte que jusqu’au xviie siècle, on n’a chanté pratiquement que des Psaumes sans autre accompagnement musical. En résumé, une grande simplicité prévaut, à côté de Palestrina qui, lui, composait parallèlement une musique très complexe.
Les psaumes
Avant la Réforme, les psaumes n’étaient généralement connus en France que dans le texte latin. Ils n’étaient pas à l’usage du peuple dans le culte.
Dès le début de la Réforme, le chant devint en France un acte de culte auquel participa toute l’assemblée des croyants et qui fit la foi et la force de l’Église. Clément Marot(1497-1544) fut éclairé par la lumière de l’Évangile et au cours des années qui suivirent cette vision, se mit à traduire les Psaumes et à les écrire en beaux vers français. Ces psaumes obtinrent une popularité qui dépassa le rêve du poète. Marot quitta Genève après la publication de 49 psaumes. Dans le Recueil français de Strasbourg (1539), Calvin ajouta six psaumes de sa plume aux psaumes de Marot. À cette date, personne ne songeait à autre chose qu’au plus strict unisson.
L’arrivé en octobre 1548 de Théodore de Bèze, réfugié lui aussi, permettra à Calvin de découvrir en lui un versificateur susceptible de reprendre le travail là où il avait été laissé. Le musicien Loïs Bourgeois livra près de quarante mélodies. Le résultat sera un recueil de 83Psaumes.
Les cantiques de la Réforme
Après Calvin, Luther, Zwingli, les choses ont évolué. À part les psaumes, on s’est mis à chanter Noël, Pâques, le Vendredi saint. Au xvie siècle, des cantiques inspirés par la Bible se multiplient sans réussir vraiment à s’introduire dans l’Église (cantiques de Duplessis, cantiques de Louis de Masure, cantiques de Théodore de Bèze), pour y parvenir enfin avec les Cantiques sacrés de Bénédict de Pictet (1705). Dès 1757, Mathurin Cordier publie, avec des mélodies de François Gindron, divers cantiques spirituels d’invention personnelle, non traduits directement des Écritures.
Au xviie siècle, dans les églises réformées de langue française, on chante les psaumes huguenots, déjà décrits, et les chorals luthériens, abondamment chantés depuis longtemps en Allemagne.
Le choral
Le vœu de Luther était que le peuple pût chanter au cours du culte d’autres hymnes allemands que ceux qui étaient venus du Moyen Âge. Luther est l’un des pères de l’hymnologie protestante. En 1524, le premier recueil de cantiques allemands contenait 36 cantiques attribués au réformateur. Très exigeant, il était fortement attaché à la musique polyphonique. Il était un créateur, mais plus fréquemment un adaptateur de mélodies, qui sont souvent de véritables re-créations artistiques.
Le choral luthérien a puisé ses mélodies à diverses sources : au chant grégorien, à la chanson, aux cantiques populaires du Moyen Âge. D’emblée, les recueils de chorals allemands connurent un grand succès et une large diffusion. Le peuple se passionnait pour le chant des chorals. Au xviie siècle, les compositions de Philip Nicolaï (1556-1608), Melchior Franck (1580-1639), Paul Gerhard (1607-1676), ont inspiré aux musiciens les mélodies de chorals qui demeurent parmi les plus belles de la musique protestante. Le travail incessant de plusieurs générations de maîtres musiciens allait contribuer à l’édification d’un ensemble monumental de chorals. C’est ainsi qu’en 1697, un immense recueil de huit volumes, publié à Leipzig en contenait près de cinq mille ! Cet ouvrage faisait partie de la bibliothèque de J.-S. Bach et c’est là qu’il a puisé sans cesse les mélodies de ses plus profondes méditations religieuses. Le développement de cette œuvre immense et sa fécondation reviennent à l’Allemagne seule.
Les évolutions des XVIIe et XVIIIe siècles
Les persécutions dues à la Révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685 eurent tôt fait d’éteindre chez les protestants français une vie artistique et spirituelle organisée.
Quant à l’anglicanisme, qui s’était contenté de traduire en langue vernaculaire les hymnes traditionnelles de l’Église romaine, il ne créa rien d’équivalent aux chorals luthériens ou aux psaumes huguenots.
Vers la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle, on apprit à connaître, en milieu protestant, le concerto d’église venu directement d’Italie, où les instruments venaient se joindre aux voix. En Allemagne, Heinrich Schütz (1585-1672), joua un rôle de premier plan dans cette acclimatation du concert à l’église ; la musique d’orgue atteignait des sommets avec des compositeurs tels que Pachelbel, Buxtehude, Böhm, et bien sûr, Johann Sébastian Bach. Jusqu’au xviie siècle, les églises chantèrent les chorals à l’unisson sans accompagnement harmonique, soutenus par le chœur, chantant lui aussi à l’unisson. Mais, peu à peu, le chant savant du chœur en vint à remplacer, au moins partiellement, le chant de l’assemblée, qui se contenta d’écouter. La musique redevint alors ce qu’elle était avant la Réforme, un ornement du culte pour les initiés.
C’est au cours de la deuxième moitié du xviie siècle que devait s’élaborer le Choral-Styl dont Bach (1685-1750) donna l’exemple d’une réalisation achevée. Abandonnant le style figuré des motets (prières vocales en marge de la messe, à une ou plusieurs voix et souvent avec instruments), le style des entrées successives ou l’imitation fuguée, le chant devint syllabique, et l’orgue put alors s’emparer du choral, remplacer le chœur et entraîner l’assemblée dans un chant de la plus haute tenue artistique.
Participèrent à cette transformation jusqu’à Bach, Hans-Leo Hassler, Melchior Vulpius, Melchior Franker, Michel Praetorius, Johann Krüger. Heinrich Schütz en représente la figure majeure.
Le xviie et le début du xviiie siècle constituent en Allemagne une période extrêmement productive. À part la famille des Bach, on peut citer Georg Friedrich Haendel. Ils écrivirent davantage pour le concert spirituel que pour le service divin. Dans leur production, qui fait place au récitatif parlé et aux airs ritournelles, le choral ne joue plus aucun rôle. Sous l’influence d’un siècle entier de musique de concert, le choral va oublier rapidement ses sources populaires. Après 1675, le choral est en pleine décadence. Seul un grand mystique comme Johann Sébastian Bach saura encore enrichir sa musique de cet inestimable trésor. Après lui, la décadence et l’oubli seront irrémédiables.
8-La musique du Réveil
Le pré-réveil
Riche de chants évangéliques dans les pays où la Parole de Dieu avait libre cours, en Allemagne, en Angleterre, le xviiie siècle est pauvre en cantiques français. Voltaire n’enseigna pas à chanter, mais à rire de tout. Et le cantique, qui aurait dû naître dans la paix relative de la seconde moitié du xviiie siècle, surgit soudainement à partir de 1815.
Zinzendorf avait restauré la communauté fondée par Jan Hus. Il est le plus abondant des poètes chrétiens du xviiie siècle. On dit qu’il composa plus de 2 000 hymnes et poèmes ; le recueil morave en contient encore 240.
Le réveil en pays francophone
Les psaumes de Clément Marot restaient appréciés, mais ne paraissaient plus suffisants pour traduire exactement les sentiments du chrétien d’alors. Il fallut donc créer de nouveaux recueils. Celui de l’église du Bourg-de-Four à Genève, berceau du réveil, le Choix de cantiques chrétiens, est dû à Henri-Louis Empeytaz, Émile Guers et Ami Bost. Parallèlement, César Malan devint le « chantre du réveil » : il a écrit plus de 1000 cantiques, paroles et musique bien souvent, dont un grand nombre fut publié dans les Chants de Sion (1828).
En 1834, les Chants chrétiens apparurent, édités par Henri Lutteroth, qui, avec l’aide de sa femme, innova en choisissant des airs de Haydn, Beethoven, Haendel, Mozart, etc.
Plus tard, dans les années 1870, le message évangélique retentira à nouveau, porté sur les ailes d’un autre recueil, les Cantiques populaires, issus du ministère du pasteur Mac All à Paris. Dans l’évangélisation populaire qu’il pratiquait, le cantique change de caractère. Il n’est plus une prière ou une louange, mais un témoignage et, plus souvent, un appel à ceux qui sont étrangers à l’Évangile. Comme le public n’est pas, en général, musicien, les airs choisis sont simples.
Le réveil en pays anglophone
Les Anglo-saxons ont fourni une foison de cantiques, graves, simples, sans fioritures, sans tristesse.
Dans la dernière moitié du xixe siècle, l’Amérique connut plusieurs mouvements religieux où le chant joua un rôle important et eut partout un caractère populaire marqué. Pour seconder les prédicateurs dans leur action, Dieu utilisa des hommes de piété et de talent, qui réunissaient à la fois des dons de poète, musicien et soliste, comme Philipp Bliss ou Ira-D. Sankey qui accompagnait Moody.
* * *
S’ouvre ensuite le xxe siècle, où la musique chrétienne a connu un très grand développement, marqué par une diversité croissante — et en rendre compte irait au-delà du propos de cet article !