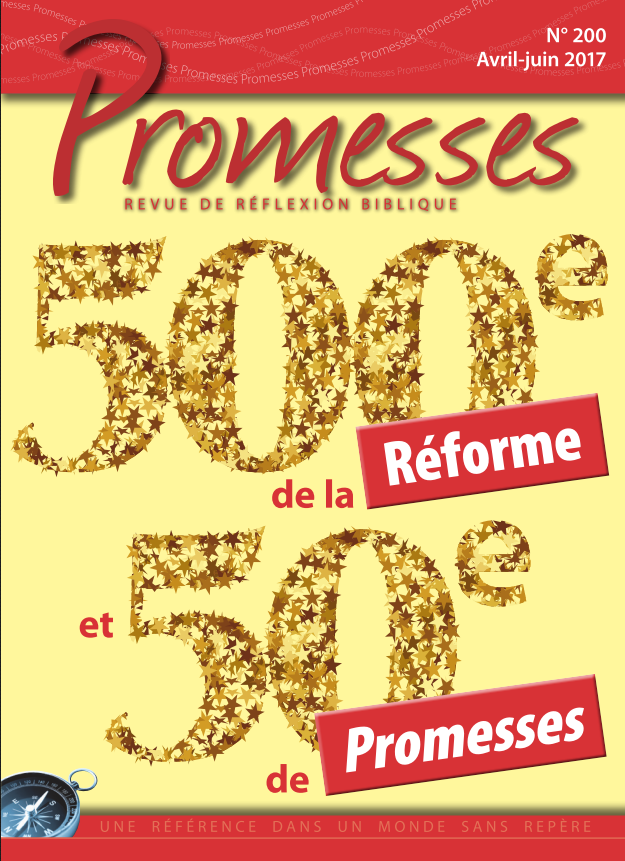Le mot « réforme » se trouve couramment sur les lèvres des politiciens et dans les journaux de notre monde contemporain : tous relayent les sentiments agités du peuple et reconnaissent le besoin de réformer la société à tous les niveaux. Ce besoin universel de réforme au XXIe siècle n’est pas nouveau ! À partir du XIIIe siècle, un sentiment d’insatisfaction commençait à naître ici et là en Europe, dans tous les domaines, jusqu’à l’irruption violente intervenue au XVIe siècle. Mais l’histoire a avancé lentement avec de petits bouillonnements (XIIIe-XVe siècle), puis, lorsque la pression a été à son comble, l’explosion s’est produite (début XVIe). Suivons ce chemin tortueux jusqu’à son apogée : la réforme protestante.
1.Les événements « pré-réformateurs »
La période allant du XIIIe au XIVe siècle révèle une Europe tourmentée par des courants de nature nouvelle, particulière et dissemblable.
- Les Croisades au Proche-Orient, quoiqu’elles aient été un échec total par rapport au but visé initialement, ont fait connaître un monde nouveau, immensément plus avancé que l’Europe dans bien des domaines. Les cités nouvelles et les civilisations anciennes ont ébloui les croisés. Cette admiration transportée jusqu’en Europe a créé la soif de connaître davantage sur tous les sujets.
- Le réveil intellectuel appelé la scolastique : en quelques mots, c’est la conviction intellectuelle que la raison humaine est capable d’élucider les vérités spirituelles en vue de défendre les dogmes de la foi. Résoudre les tensions entre la philosophie d’Aristote et la théologie chrétienne en utilisant « Aristote pour comprendre et pour expliquer Dieu », telle en était la proposition. Les érudits ont commencé à réfléchir tous azimuts sans être limités par la religion catholique.
- Les nouveaux mouvements religieux fleurissent dans et en-dehors de la papauté, par exemple : les Cathares-Albigeois, les Bogomiles et les Vaudois. Ces derniers sont les seuls existant encore au XXIe siècle en petits groupes en Italie, Argentine, Allemagne, Uruguay, États-Unis d’Amérique. Ces groupes mettaient en doute les dogmes de Rome en lisant les Saintes Écritures ! C’est à cause de ces divers mouvements que la terrible Inquisition a été mise sur pied afin d’éradiquer tout ce que Rome considérait comme hérésies. L’Inquisition a ravagé férocement les peuples, même catholiques, en sorte que des milliers de personnes se sont mises à douter de l’autorité romaine qui dominait tous les aspects de la vie.
- La vie religieuse était troublée à la suite de la mise en doute de l’autorité absolue de Rome par certains. Pour contrer la décadence spirituelle rampante, deux mouvements ont vu le jour, les Dominicains et les Franciscains qui exerçaient un pouvoir spirituel afin de confirmer le dogme catholique.
- La création des « universités » où furent enseignées les disciplines – arts, médecine, droit, théologie – qui s’appelaient « facultés ». L’enseignement est fondé sur un certain nombre de textes de référence. Au départ, les « arts mécaniques » et les « sciences lucratives » ont été exclus victimes du double mépris qui frappait le travail manuel et le profit. Les plus fameuses ont été Paris et Oxford (théologie), Bologne (loi civile et ecclésiastique), Salerno (médecine). La grammaire, la rhétorique, la dialectique, l’astronomie, l’arithmétique, la géométrie, la musique, la théologie, la loi canonique, la médecine ont été enseignées, par exemple, à l’Université de Paris. L’apprentissage passait par une double méthode : la lecture des textes et le débat dans le but de s’assurer que l’étudiant possède bien sa matière !
- L’esprit mystique est un terme qui « relève principalement du domaine religieux, et sert à qualifier ou à désigner des expériences spirituelles de l’ordre du contact ou de la communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun1. » Il y avait deux tendances, celle des « bons » (au sens catholique) comme Hugues de St. Victor, Bonaventure (1221-1274), Maître Eckhart (1260-1328), Jean Tauler († 1361). Luther admirait ce dernier à cause de ses nombreuses déclarations « évangéliques ». De leurs influences naquit un groupe d’origine allemande et suisse, autoproclamé « Amis de Dieu », qui eut aussi une certaine influence sur Luther. Il appréciait particulièrement un livre, Theologia Germanica, lequel se situe bien dans la tradition mystique catholique. Calvin et la tradition réformée fustigent cette théologie ! Soulignons, en ce qui concerne la seconde et « mauvaise » tendance, que beaucoup des mystiques allemands penchaient vers le panthéisme2. Le résultat a été de préférer une lecture et une interprétation personnelles des Écritures, qui ont été réduites à une place très secondaire, comme guide de la vie spirituelle.
- Les luttes pour les pouvoirs royaux, religieux, économiques entre les papes et les rois des États. Chaque groupe voulait contrôler tout et tous. Les papes se voyaient exclusivement investis par le pouvoir divin dans tous les aspects de la vie de chaque individu ! Les rois n’existaient que pour implémenter la volonté souveraine, comme simples servants des papes, serviteurs exemplaires du Christ ! Ces luttes sans merci ont affaibli papes et rois ; les peuples en ont subi malheureusement les conséquences : petites rebellions, mécontentement, augmentation de la pauvreté, injustices de toutes sortes, manque de libertés personnelles. Le cas de Jean de Paris († 1306) est particulièrement intéressant, il enseignait que les pouvoirs papaux et royaux dépendaient uniquement de la souveraineté du peuple, chaque pouvoir n’ayant aucun droit de s’ingérer dans la sphère de l’autre ! William d’Occam († 1350) et Dante († 1321) croyaient pareillement, et par leurs œuvres ont accompli beaucoup en vue de la réforme protestante deux siècles plus tard.
- La période papale déchirante et très humiliante appelé la « captivité babylonienne » (1309-1377) à Avignon en France, avait entamé la sainte réputation de la papauté :
- La population à Rome nourissait un vif ressentiment contre la papauté à cause de son absence et à cause d’une fiscalité onéreuse ;
- L’anarchie régnait dans les États pontificaux ;
- La fracture en Europe entre les partisans de la France et ceux de l’Angleterre pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453) ;
- La situation absurde et très déstabilisante où la papauté, qui vivait dans le luxe, avait eu, pendant une période, deux ou trois papes régnant simultanément, soit à Rome, soit à Avignon, situation qui l’on appelle le « Grand Schisme d’Occident » (1378- 1417).
- L’image désastreuse offerte par la papauté schismatique (voir ci-dessus) allait expliquer le grand succès de deux grands « pré-réformateurs » : l’Anglais John Wyclif, appelé « l’Étoile du Matin de la Réforme » (1320-1384) et le Tchèque Jan Hus (1369-1415). Leur importance pour amorcer à cette époque le démarrage de la réforme protestante future (1517) est formellement reconnue par les historiens et les érudits théologiques catholiques modernes.
- Wyclif enseignait à l’Université d’Oxford et au travers de son étude personnelle du Nouveau Testament, il avait compris que les Saintes Écritures, la Bible, étaient la seule autorité spirituelle incontestable pour l’Église. Ce constat, évident lorsque le lecteur sincère lit la Parole de Dieu, poussa Wyclif à commencer sa carrière en critiquant Rome pour ses richesses et sa puissance politique sur une base biblique, allant même jusqu’à appeler le pape qui nageait dans le luxe, « l’Antichrist ». Convaincu que le peuple anglais avait besoin de la Bible latine traduite dans sa propre langue, lui et d’autres s’attelèrent à la tâche. Il envoya des « pauvres prêtres » (appelés « Lollards ») avec les Écritures partout dans le pays. Le vrai peuple de Dieu formait la communauté des prédestinés, ceux qui avaient une relation personnelle avec Christ : appartenir à Rome n’était donc pas important et n’avait aucun sens. Il rejeta la fausse doctrine de la transsubstantiation et la présence physique de Christ dans l’eucharistie. Il attaqua les abus explicitement démontrables du clergé, des ordres religieux, des indulgences et du sacerdoce. Les résultats ont été époustouflants, mais seulement pour un temps. Hélas, la persécution fit pratiquement disparaître cette mouvance évangélique. Dieu avait toutefois préparé la suite !
- Pendant la période de liberté de Wyclif, des étudiants tchèques vinrent étudier à Oxford où ils furent « contaminés » par la vérité biblique. En retournant dans leur pays, la Bohême, ils partagèrent les vérités bibliques avec un certain Jan Hus qui devint le plus grand avocat de cet enseignement biblique. Un feu traversa la nation, mais la papauté et le pouvoir séculier de Bohème œuvrèrent par subterfuge pour présenter Hus au Concile de Constance (1414-1418) en Allemagne afin d’y alléguer ses doctrines. Il fut faussement accusé d’hérésie, condamné et brûlé vif en 1415[3]! En dépit de sa mort, la mouvance qu’il avait initiée, devint nationale avec les hussites. Ils demandèrent à l’Empereur Sigismond en 1420 d’accepter leurs quatre articles : la liberté de prédication, la communion des éléments (pain et vin) distribués à tous, l’interdiction aux prêtres de posséder des biens temporels et des sanctions publiques contre des péchés considérés comme mortels, surtout la simonie3 ! Il les rejeta ultérieurement. Les descendants conservateurs des hussites formèrent l’Église morave en 1457, laquelle existe encore en de petits groupes en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
- La Renaissance italienne peut être définie comme l’ère d’une réorientation culturelle et intellectuelle par laquelle les hommes ont remplacé l’approche spirituelle médiévale et une vie où le respect des règles de la société limitait la responsabilité individuelle par une conception séculière et individualiste. La vision théocentrique de la vie a cédé la place à une vision anthropocentrique dans laquelle l’homme est la mesure de tout. L’accent a été mis sur la gloire de l’homme et de ses accomplissements. Ce changement graduel a surtout été initié par la fuite des érudits, pénétrés par la culture gréco-romaine du Proche-Orient, avant la chute de Constantinople en 1453. La sagesse gréco-orientale, avec la redécouverte de Platon et Aristote, a créé un ferment intellectuel où l’on cherchait des réponses aux questions existentielles de la vie chez les auteurs païens. On se passionnait pour la sagesse antique et la beauté des formes physiques, littéraires et artistiques du passé, avec une approche humaniste, optimiste et expérimentale où la religion était réduite à du formalisme. Au nord des Alpes, c’est le retour vers des études de la Bible à cause des manuscrits en hébreu et en grec amenés par les érudits. Le premier livre imprimé par Gutenberg en 1455 fut la Bible qui commença alors à être consultée par un plus grand nombre.
- La peste noire : On estime que la peste noire (bubonique) a tué au total entre 30 et 60% de la population européenne, faisant en cinq ans (1347-1352) environ vingt-cinq millions de victimes, et jusqu’à 50 millions pour tout le siècle. Cette épidémie, un des faits les plus importants de l’histoire démographique de l’Occident, eut des conséquences durables sur la civilisation européenne. Elle était surtout transmise et transportée par les puces des rats noirs, également appelés les « rats de maison » et « rats de navire », aimant à vivre près des gens. Cette qualité même le rend dangereux (en revanche, le rat brun ou gris préfère garder ses distances, se cantonnant dans les égouts et les caves).
L’aboutissement de la Réforme
À l’aube du XVIe siècle, à cause de deux siècles de maladresses, d’erreurs et de scandales frappant de la papauté, l’opinion publique est dans l’attente d’un renouveau religieux. La papauté était vraiment la seule autorité régnante en Europe ! Un immense appétit pour l’intervention du divin se faisait sentir partout et la papauté tenait à elle seule la clé d’une réforme générale. Les abus religieux suivants rendent évidents cette nécessité :
- Le poids de la fiscalité papale exigée de tous. Tout droit ou privilège devait aussi s’acheter.
- La vente par l’Église, propriétaire d’immenses domaines, au plus offrant (souvent aux plus indignes), le droit de « profiter » des richesses des évêchés et abbayes.
- La médiocrité spirituelle, intellectuelle et morale d’un bas clergé totalement inculte.
Dans le même temps, on assiste à une évolution des idées où tout a été remis en cause :
- À partir du XIe siècle, la scolastique4 est en vogue dans l’église papale pendant les XIe-XIIIe siècles. Les théologiens employaient les syllogismes5 pour débattre sur la relation entre la foi et la raison. La révélation de Christ est-elle compatible avec la raison humaine ? Si elle est compatible, laquelle a la priorité ? Thomas d’Aquin (1225-1274) estimait la raison humaine capable de discerner la vérité au sujet de Dieu. Un but important fut de défendre à tout prix le système papal rigide des dogmes. Or, ce « monument » philosopho-théologique fut attaqué par le phénomène du mysticisme qui est « la croyance que l’union avec ou l’absorption dans la divinité ou l’absolu, ou l’appréhension spirituelle de la connaissance inaccessible à l’intellect, peut être atteint par la contemplation et l’abandon de soi ». Puis Guillaume d’Occam (1285-1347) troublant encore davantage les eaux de la controverse, affirma que les conceptions moralo-théologiques n’avaient rien à voir avec la raison, car elles dépendaient uniquement de la Révélation et de la foi. Toute cette ébullition sur la validité des dogmes et de l’autorité papale, ces controverses intellectuelles sur la priorité entre raison et foi, ont été des précurseurs des réformes du XVIe siècle.
- L’humanisme qui privilégie le libre examen en rejetant les institutions papales, minimise l’importance des sacrements, libère la culture des restrictions de la pensée religieuse, l’homme devient donc autonome vis-à-vis de l’autorité spirituelle.
- La spiritualité devient individualiste et anti-intellectuelle.
- Les théories conciliaires qui mettent directement en cause la supériorité suprême de la papauté augmentent l’aspiration à des « églises nationales » assez indépendantes.
Enfin, il est nécessaire de souligner les mutations profondes dans toute la société, voire dans les mentalités, suite à des événements exceptionnels :
- La découverte de l’Amérique (1492).
- L’invention de l’imprimerie (1454).
- L’apparition de l’économie monétaire : la monnaie fiduciaire est la représentation de la valeur qui se substitue à la valeur elle-même. La valeur réelle cède la place à une valeur fondée sur la confiance du public, la monnaie se dématérialise. La « monnaie de papier » est celle qui est émise par des échangistes privés à la réputation solide. Les parités des différentes monnaies en circulation dépendent de la réputation respective de chaque émetteur de monnaie.
- La volonté d’indépendance des princes allemands par rapport à l’Empire.
- L’exaspération des paysans par rapport à leurs propriétaires terriens.
Ainsi le XVe siècle, fédérant tous les courants d’insatisfaction des XIIIe-XIVe siècles, débute avec un ferment qui n’attend plus que l’étincelle qui enflammera tous les secteurs de la vie européenne. Le « fourrage » prêt à recevoir l’étincelle a été le trafic d’indulgences. Ce phénomène, établi juridiquement au XIIe siècle par la papauté, est la prorogation d’une « peine » éternelle qui acquitte des conséquences futures d’un péché. Cette relaxe était garantie par un échange d’argent. On achetait son acquittement devant Dieu Juge. L’indulgence remplaçait des pénitences très sévères imaginées et imposées par la papauté.
Un moine augustinien allemand, Martin Luther (1483-1546), totalement insignifiant, mais très indigné par la vente des indulgences, réagit d’une manière publique le 31 octobre 1517. Il cloua ses « 95 Thèses » en latin sur la porte principale de l’église de Wittenberg, uniquement en vue de provoquer un débat public sur la validité des indulgences et sur l’autorité papale. Les 95 thèses ont été rapidement traduites en allemand, largement copiées et imprimées. Dans les deux semaines, elles avaient été répandues dans toute l’Allemagne et dans les deux mois dans toute l’Europe ! Luther n’a jamais eu d’autre intention que de voir une petite réforme à l’intérieur de l’église catholique ; créer un déchirement total n’était pas son désir. Malgré son souhait innocent de corriger certaines erreurs, la réforme protestante était en marche, sans possibilité de retour. Évidemment, en comprenant l’importance de son rôle de pionnier, il assuma totalement et fidèlement son implication dans la Réforme. Gloire à Dieu !
- Wikipédia, consulté le 26.02.2017
- Dieu est en toute la création, le sauvé ne peut plus pécher étant « intégré en Dieu », le Saint-Esprit est tout, l’âme devient une avec Dieu.
- La simonie est, pour les catholiques, l’achat et la vente de biens spirituels, tout particulièrement d’un sacrement. Ce terme vient de Simon le magicien qui souhaitait acheter aux apôtres le pouvoir de remplir du St-Esprit ceux à qui il imposerait les mains (Actes 8.9ss).
- Définition : voir plus haut
- Le syllogisme est un raisonnement logique à deux propositions conduisant à une conclusion qu’Aristote a été le premier à formaliser