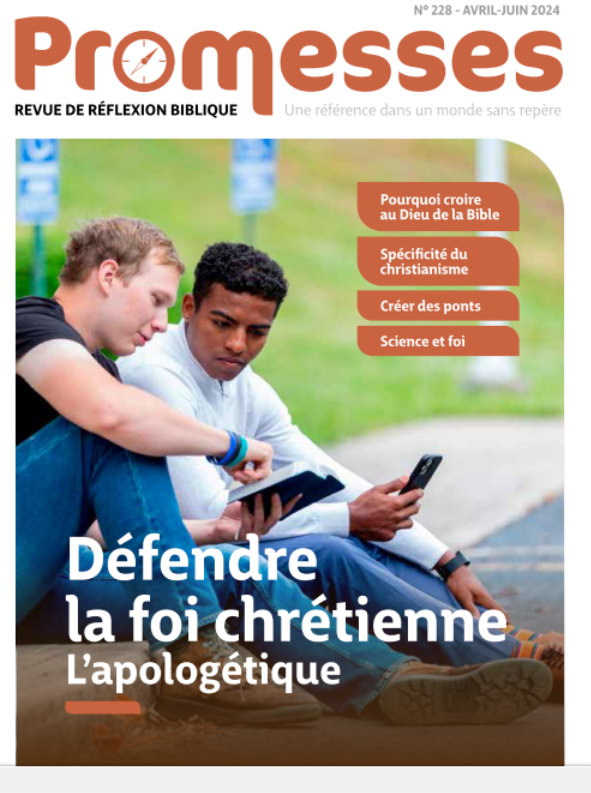Beaucoup aujourd’hui considèrent que science et religion s’opposent, et que la science a largement prouvé qu’il n’est plus possible de croire en Dieu — du moins pas dans le Dieu que les chrétiens proclament. Et bien sûr, s’il y avait opposition, ce serait la science qui serait le guide le plus sûr vers la vérité. Or, comme nous allons le voir, 1° la science ne peut pas embrasser toutes les facettes de l’expérience humaine et 2° la pratique de la science a besoin d’un fondement qui doit lui venir de l’extérieur, et la foi en Dieu, Créateur de l’univers, permet de lui assurer ce fondement.
1. Les limites de la science
Les réussites extraordinaires de la science ne doivent pas nous rendre aveugles. La science s’impose à elle-même des limites sévères. Elle exige comme preuve une expérience répétable. Par une démarche analytique, le scientifique cherche à isoler des situations expérimentales simples, qu’il peut maîtriser tout en gardant une distance critique par rapport à l’objet de son étude. Cette pratique s’est avérée extrêmement féconde. Mais ce cadre ne permet pas de rendre justice à toute la richesse de l’expérience humaine. Voici quatre exemples de domaines où la démarche scientifique ne convient pas.
La rencontre personnelle
Au début d’une relation interpersonnelle, il peut y avoir place pour une certaine « mise à l’épreuve ». Mais une attitude détachée d’expérimentateur ne peut, en fin de compte, que détruire une relation. Celle-ci implique un engagement de la personne et une confiance réciproque.
Les règles éthiques
La science ne permet pas de fonder l’éthique. La science décrit ce qui est, l’éthique ce qui doit être.
Il est impossible de déduire des règles morales de la science. On a cherché à fonder l’éthique dans la théorie de l’évolution, mais en vain. La société n’est pas prête à renoncer à des règles de conduite objectivement valables, comme : « il est moralement condamnable de torturer des enfants », ou : « les nazis ont eu tort de vouloir exterminer les Juifs ». La science ne permet pas de fonder de tels jugements.
Plus encore, la science ne permet même pas de justifier sa propre existence : pourquoi serait-il souhaitable de comprendre le comportement de la nature ?
L’expérience esthétique
Pratiquement tous les humains sont réceptifs à l’expérience de la beauté, même si, suivant les personnes, la sensibilité varie, tout comme les critères de ce qui est ressenti comme beau divergent. Il est possible de décrire scientifiquement un tableau (longueur d’onde de la lumière reflétée aux divers endroits du tableau), ou un morceau de musique (longueur d’onde du son). Mais l’expérience esthétique transcende la description scientifique. Le diagramme qui donne les chiffres représentant les longueurs d’ondes de la lumière (ou du son) ne permet pas d’exprimer la beauté ressentie.
La pensée
Même si l’argument est controversé et sans nier les liens étroits entre la pensée et le cerveau, il me semble que la science n’épuise pas ce qu’est la pensée. Car si on réduit l’intelligence humaine à des processus qui suivent un déterminisme « aveugle », on ne voit plus comment elle peut arriver à des conclusions vraies (ou fausses) sur la réalité. Descartes avait déjà souligné que « la compréhension critique de la vérité, ainsi que la juste évaluation des arguments, ne peut être qu’une action libre et volontaire » 1.
Ainsi la science ne peut pas — ne doit pas — avoir la prétention de rendre compte de l’ensemble de la réalité. Contrairement à l’impérialisme scientifique prêché par certains (qui est plutôt du scientisme que de la vraie science), il y a donc place pour d’autres pratiques humaines que la science — par exemple la religion. Cela seul ne suffit pas pour légitimer la religion comme une pratique humaine, mais montre qu’on ne peut pas invoquer la science pour détruire la religion. Il existe d’autres démarches à côté de la science, et il faut les considérer toutes ensemble si l’on veut espérer rendre justice à la richesse de la réalité.
2. Les présupposés de la démarche scientifique
La foi dans le Dieu Créateur permet de rendre compte de plusieurs présupposés fondamentaux de la science.
L’ordre régissant la nature
Le mathématicien et philosophe Alfred Whitehead écrit : « Il ne peut exister de science vivante sans une profonde foi instinctive en l’existence d’un ordre des choses, et en particulier, d’un ordre de la nature. » 2Pour l’homme moderne, l’affirmation que la nature suit un ordre bien établi paraît l’évidence même. Mais cette confiance largement partagée de la pratique de la science moderne n’existait guère dans l’Antiquité. Par exemple, les Babyloniens avaient réalisé des observations astronomiques précises, sans jamais tenter de « construire des modèles géométriques susceptibles de rendre compte des mouvements célestes » 3 . La conviction d’un ordre naturel universel est à l’origine de la science moderne, avant que ses succès ne justifient cette conviction après coup. Il faut croire à un ordre naturel, descriptible en termes mathématiques, pour scruter patiemment des mesures astronomiques en vue d’y déceler des lois.
Sans une telle conviction, Kepler n’aurait jamais pu établir les trois lois qui portent son nom et décrivent le mouvement des planètes. Pour faire de la science, il ne suffit pas de penser qu’une partie des phénomènes naturels suivent une certaine régularité approximative. Tous les hommes de tous les temps en ont certainement été convaincus. On s’attend à ce que le soleil se lève le lendemain, à ce que la moisson tombe à peu près à la même époque l’année suivante ; mais seules des observations précises et des calculs serrés montrent que l’année solaire ne compte pas 365 jours. L’approche scientifique présuppose un ordre précis s’étendant à tous les phénomènes naturels.
Comment peut-on alors en arriver à la conviction de l’universalité des lois de la nature ? La réponse spontanée à cette question se réfère à l’observation : il suffit de bien regarder pour s’en rendre compte. C’est le mérite de David Hume (1711-1776) d’avoir mis en avant le caractère illusoire d’une telle réponse : au mieux, l’observation peut constater certaines régularités statistiques mais elle ne permet jamais d’en déduire une loi universelle.
La dinde nourrie généreusement tous les jours jusque-là peut, certes, formuler l’hypothèse qu’il en sera toujours ainsi ; mais cela ne lui garantit pas de survivre à la veille de Noël, bien qu’elle ait raisonné d’après toutes les règles de l’art de l’induction !
La foi au Créateur fournit un fondement à ce présupposé de la science. Dieu est un Dieu d’ordre, qui a tout créé avec sagesse et dont l’action providentielle garantit l’ordre naturel (cf. Ps 119.89-91 ; Job 28.25-27).
L’universalité des lois naturelles découle en fait directement du monothéisme biblique. Comme le Seigneur seul est Dieu, rien ni personne ne peut se soustraire à son règne. Ni les étoiles (souvent divinisées chez les voisins d’Israël), ni la mer (symbole des forces du chaos à cause de son mouvement d’apparence irrégulière) n’échappent au contrôle divin. De plus, le Dieu unique réunit en son sein des attributs ordinairement dissociés dans les religions polythéistes. Il est à la fois sage et puissant. Ainsi, aucun obstacle ne peut l’empêcher d’instaurer l’ordre qu’il a décidé dans sa sagesse.
L’ordre intelligible pour l’homme
Einstein a dit : « Ce que le monde a et aura toujours d’inconcevable, c’est qu’il soit concevable. » Pour que la science soit possible, il ne suffit pas qu’il y ait un ordre dans la nature, il faut en plus que cet ordre soit accessible à l’homme qui doit pouvoir le saisir et le décrire, pour communiquer ses résultats à d’autres.
La connaissance de la nature n’est possible que si l’être humain entretient avec elle une double relation : il doit en être à la fois solidaire et distinct.
D’un côté, aucune science n’est possible sans point de contact. Comment l’homme serait-il capable de saisir quelque chose de l’ordre naturel, si rien dans la structure de son intelligence n’y correspondait ?
Comme Dieu a créé la nature et l’esprit humain, leur origine commune garantit que l’homme peut comprendre au moins certaines facettes de la nature. La vision biblique explique l’harmonie entre la raison humaine et la nature, nécessaire au savoir scientifique.
D’autre part, il faut aussi poser comme principe une certaine distance entre l’homme et la nature. Car la connaissance présuppose un vis-à-vis entre sujet connaissant et objet connu. Si la raison humaine était entièrement déterminée par les lois physico-chimiques, on ne verrait pas pourquoi elle devrait être capable d’arriver à des conclusions qui seraient de surcroît vraies. Ainsi le philosophe Karl Popper affirme : « Le déterminisme “scientifique” rend illusoire la rationalité. C’est ainsi qu’il implique la réfutation par elle-même d’une évaluation trop optimiste de la raison humaine. » 4
Genèse 2 exprime cette capacité d’une manière imagée quand on voit l’homme donner des noms aux animaux (v. 20). Donner un nom, c’est décrire le caractère d’un être. Peut-être trouve-t-on ici le prototype de l’activité scientifique.
La vision biblique établit la possibilité de la connaissance scientifique ; mais elle récuse le scientisme : la science n’explique pas l’ensemble de la réalité. La connaissance scientifique reste donc partielle. Et comme toutes les entreprises humaines, la science est faillible, provisoire, appelée à se réformer à la lumière de nouvelles expériences.
L’approche expérimentale
Dans la science d’inspiration grecque, qui domine encore tout le Moyen-Âge, les expériences servent à étayer des positions déjà adoptées, en référence à la tradition et sur la base d’arguments spéculatifs.
Elles n’ont pas pour objet de faire évoluer les convictions, de faire accepter de nouvelles idées.
Mais, depuis le XVII e siècle, la science confère à l’expérience un rôle décisif dans l’élaboration de nouvelles théories.
On peut relier l’approche expérimentale à la création par trois aspects et montrer ainsi qu’elle convient au croyant :
1. La liberté du Créateur
D’abord, l’idée de création met en lumière la souveraineté et la toute-puissance divines, contrairement à d’autres conceptions de l’origine du monde. Pour le croyant de la Bible, Dieu peut faire tout ce qu’il veut. Dieu n’était pas obligé de créer le monde, ni de lui donner la forme qu’il a décidé de lui donner. Du coup, la pure spéculation rationnelle ne peut pas découvrir les lois qui régissent la nature, comme si la création n’était affaire que de pure logique. L’homme doit rester « à l’écoute » de la nature, pour découvrir l’ordre que Dieu a décidé librement de créer. Mais liberté ne veut pas dire volonté arbitraire ; la souveraineté divine n’est pas un despotisme aveugle. Dieu crée avec sagesse, de sorte que l’homme peut découvrir un ordre naturel, qui lui paraîtra cohérent. La science vit de ces deux éléments : l’expérience et la réflexion. Seule leur union permet d’enfanter la compréhension scientifique de la nature.
2. L’esprit de conquête
L’attitude moderne est essentiellement active, non contemplative. Le savant n’attend pas que la nature lui révèle quelque chose, mais il planifie des séries d’expériences ; il pose, pour ainsi dire, des questions précises à la nature.
Certes, il est des domaines où le savant rencontre des limites techniques ou éthiques, comme en astronomie ou en médecine. Mais même dans ces domaines, il essaie d’élargir activement sa connaissance. Par exemple, il affine les moyens techniques (jusqu’à envoyer des instruments de mesure dans l’espace) ou encore il remplace les expériences prohibées d’un point de vue éthique par des expériences analogues, moins délicates (par exemple les autopsies). L’esprit de conquête, plus que la contemplation, caractérise définitivement l’attitude du chercheur moderne devant la nature.
Il est évident que l’attitude active du savant face à la nature n’est guère possible si la nature est considérée comme divine, comme c’est le cas par exemple dans l’animisme ou le panthéisme.
Si la nature (et les forces qui s’y déploient) est divine, l’homme ne peut pas se dresser en juge pour l’interroger. Mais lorsqu’il reconnaît le monde comme la création de Dieu, il refuse de voir dans la nature une divinité. Et alors le savant peut faire des expériences.
3. L’appréciation du monde matériel
En Grèce antique, beaucoup opposèrent esprit et matière et méprisèrent le monde matériel et, avec lui, le travail manuel. La conception biblique valorise au contraire le travail manuel ; car il façonne la création divine et répond à la vocation adressée à l’homme dès avant la chute (Gen 2.15).
La Réforme, en réhabilitant la valeur du travail « séculier », a favorisé la naissance de la méthode expérimentale moderne.
Conclusion
Comme la Bible et la création trouvent toutes deux leur origine en Dieu, il est exclu qu’elles se contredisent. Dieu est véridique ; ce qu’il annonce dans le livre de ses paroles est en parfaite harmonie avec ce qu’il dit dans le livre de ses œuvres. En théorie, il ne devrait donc pas y avoir de conflit entre science et théologie.
Mais il ne faut jamais oublier que la théologie repose sur notre interprétation de la Bible et que la science est notre interprétation de la nature.
Ainsi, théologie et science sont des entreprises humaines, et donc provisoires, partielles, faillibles, voire, à certains égards, fausses. Il n’est donc pas étonnant que des conflits surgissent. Il est possible de les limiter si, à chaque fois, nous revenons sur les arguments qui appuient nos affirmations, pour en évaluer la solidité. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte d’erreurs, ou simplement de lacunes qui nous obligent à suspendre notre jugement. Mais on ne peut pas s’attendre à résoudre tout conflit : notre théologie et notre science ne participent pas de la perfection divine ! Il en va pourtant de notre dignité d’hommes et de femmes créés « en image de Dieu » de n’abandonner ni la démarche théologique ni la démarche scientifique. Ne nous dérobons pas à la responsabilité qui est la nôtre de rechercher la vérité par tous les moyens mis à notre disposition. Ce n’est que lorsque nous sommes en route que nous pouvons avancer — dans notre relation à Dieu et dans notre compréhension du monde.
- René DESCARTES, Les principes de la philosophie, I, 36-39.
- Alfred North WHITEHEAD, La science et le monde moderne , 1994, p. 20.
- Geoffrey E.R. LLOYD, Magie, raison et expérience : origines et développement de la science grecque, 1990, p. 236.
- Karl POPPER, L’univers irrésolu : plaidoyer pour l’indéterminisme, 1984, p. 72.